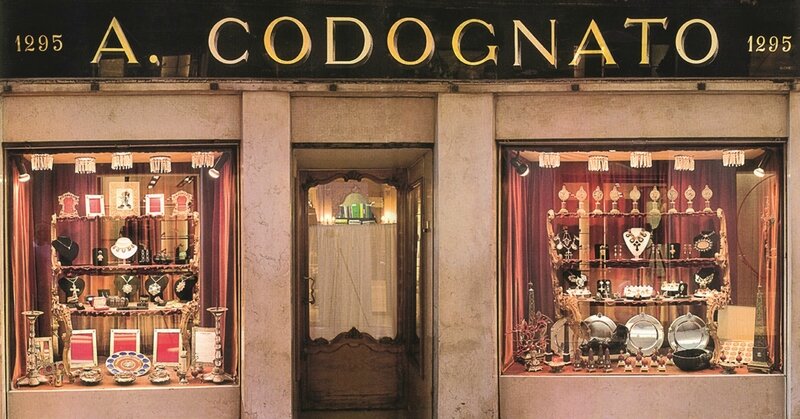A partir du 13 décembre 2014, les engins de pêche s’affichent sur l'étiquette du poisson vendu dans les poissonneries...
Cliquer Ici pour en savoir plus sur la nouvelle étiquette de poisson...
Cliquer Ici pour en savoir plus sur la nouvelle étiquette de poisson...
Y aurait-il des engins de pêche plus vertueux que d’autres ? Au Canada, baleines et marsouins seraient les victimes des pêcheries aux casiers de homard et de crabe des neiges, selon le dernier rapport de l'Onge NRDC : Net Loss: The Killing of Marine Mammals in Foreign Fisheries
A partir du 13 décembre 2014, le poissonnier sera dans l’obligation d’afficher la catégorie d’engin de pêche utilisé pour la capture des poissons, coquillages, crustacés et autres céphalopodes... La réforme de l’organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (OCM) retient 5 grandes catégories d’engin de capture : sennes, chaluts, filets, lignes, dragues et casiers.
Au moment où le poisson d’élevage prend de plus en plus de place sur les étals, mettre en concurrence les poissons sauvages selon l’engin de capture pourrait avoir des conséquences sur l’ensemble du secteur de la pêche fraiche, l'affaiblir face à un secteur aquacole industriel de plus en plus concentré...
 D’autre part, les grands perdants de cette nouvelle classification sont les petits métiers. Depuis des années, la petite pêche mène une politique de différenciation à l’étalage comme les ligneurs de la pointe de Bretagne ou le merlu de ligne en Aquitaine. Avec la nouvelle réglementation, tous les poissons de ligne sont classés dans la même catégorie qu’ils soient issus de la pêche artisanale ou de la pêche industrielle...
D’autre part, les grands perdants de cette nouvelle classification sont les petits métiers. Depuis des années, la petite pêche mène une politique de différenciation à l’étalage comme les ligneurs de la pointe de Bretagne ou le merlu de ligne en Aquitaine. Avec la nouvelle réglementation, tous les poissons de ligne sont classés dans la même catégorie qu’ils soient issus de la pêche artisanale ou de la pêche industrielle... Décryptage
Dans le cadre de la réforme de la Politique Commune de la Pêche (PCP), cette nouvelle politique d’affichage met en compétition les pêcheries non pas en fonction de l’entreprise (artisanale/industrielle) mais en fonction de l’engin de capture utilisé par les pêcheurs. Y aurait-il des engins de pêche plus vertueux que d’autres ?
Le matériel utilisé par les pêcheurs est regroupé en 7 catégories d’engin de capture : sennes, chaluts, filets maillants et filets similaires, filets tournants et filets soulevés, lignes et hameçons, dragues et casiers (et pièges). Face à la très grande diversité des engins de pêche, la Commission européenne nous donne une grille de lecture pour faciliter cette répartition...
Prenons l’exemple de la pêche à la crevette à cheval, pêcherie ancestrale au même titre que la senne de plage placée tout en haut du tableau "Information sur les engins de pêche".
Dans quelle catégorie d'engin de pêche, classeriez-vous cette pêche à la crevette à cheval ? La Commission indique la pêche en boeuf mais pas celle à cheval !
Prenons l’exemple de la pêche à la crevette à cheval, pêcherie ancestrale au même titre que la senne de plage placée tout en haut du tableau "Information sur les engins de pêche".
Dans quelle catégorie d'engin de pêche, classeriez-vous cette pêche à la crevette à cheval ? La Commission indique la pêche en boeuf mais pas celle à cheval !
Belgique : à Oostduinkerque, on pêche la crevette à cheval !
C'est une tradition, à Oostduinkerque, sur la Côte belge, c'est avec un cheval de trait que l'on pratique la pêche à la crevette.
Source : France3 Nord-Pas-de-Calais par Hélène Tonneillier (14 janvier 2014)
La pêche à la crevette à cheval
Un reportage de Myriam Schelcher et Antoine Morvan
Depuis le XVIème siècle, on pêche la crevette avec un cheval de trait des côtes anglaises au littoral des Pays-Bas. A l'époque, fermiers, livreurs de charbon...avaient leur monture et s'en servaient pour récupérer les crustacés, nommés ici "caviar de la mer du Nord".
Mais avec l'industrialisation, les machines ont progressivement pris la place des équidés, sauf à Oostduinkerque. Là-bas, Dominique perpétue la tradition. A marée basse, le cheval traîne une lourde chaîne, qui fait sauter, sur son passage, les crevettes enfouies à quelques centimètres sous le sable. Une manière de pêcher, devenue rare, aujourd'hui classée au patrimoine immatériel de l'humanité, par l'UNESCO.
Y aurait-il des engins de pêche plus vertueux que d’autres ?
Le décryptage d’Alain Le Sann après lecture de l’ouvrage de Callum Roberts « Océans » paru fin 2013...
Adieu filets, palangres, sennes, dragues et chaluts : Pêcheurs, sortez vos cannes à pêche.
Callum Roberts est un biologiste anglais, spécialiste de la conservation marine, particulièrement des coraux. C’est un scientifique rigoureux et influent qui est à l’origine, en 2010, de la création du premier réseau mondial de réserves intégrales en haute mer. Il a bénéficié comme beaucoup d’autres du programme Pew fellows et il est très lié aux ONG environnementalistes où il a une très grande influence. Il est l’ambassadeur officiel du WWF de Grande-Bretagne.
Dans « Océans », il analyse longuement toutes les menaces qui pèsent sur les océans, maintenant et dans l’avenir. Il nous fait découvrir certaines menaces méconnues, mais sa critique principale s’adresse à la pêche qui représente pour lui la menace la plus ancienne et la plus grave. La pêche intervient comme un facteur aggravant des autres perturbations. Sont analysées, les menaces classiques bien connues : le réchauffement, l’acidification, la hausse du niveau des mers, les pollutions liées au pétrole et aux produits chimiques. De manière plus originale, il évoque des perturbations moins connues comme le développement de virus qui mettent en péril des espèces, les pollutions sonores qui perturbent sévèrement les mammifères marins, la multiplication des espèces invasives qui s’installent loin de leur écosystème d’origine. L’argumentation est basée sur les travaux scientifiques, mais on peut regretter que la traduction soit parfois erronée, ainsi on est étonné de découvrir des marais salants en Ecosse alors qu’il s’agit de marais maritimes naturels, ou encore la confusion entre les crevettes et les langoustines.
Une charge virulente contre la pêche
Tout au long du livre, m^me dans les chapitres qui ne sont pas consacrés à la pêche, il ne peut s’empêcher de revenir sur le rôle négatif et destructeur de la pêche. Il n’attaque pas seulement la surpêche mais des pratiques millénaires. Ainsi il considère que la pêche est la principale responsable de la mortalité des oiseaux marins. Il cite d’ailleurs un cas étonnant de pêche à la palangre où les hameçons ont accroché, grâce aux appâts, bien plus d’oiseaux que de poissons. Il en tire la conclusion que la palangre est un engin à proscrire. Si les cas qu’il cite sont tout à fait réels, son analyse est uniquement à charge, car il pourrait aussi indiquer que la pêche a favorisé le développement de certaines espèces d’oiseaux attirés par les rejets des bateaux de pêche (poissons et résidus de l’étripage). Callum Roberts remet également en cause les filets, qu’ils soient dérivants ou calés, car ils ont le tort de prendre également des poissons non désirés, des tortues ou des mammifères marins. Il a l’honnêteté d’aller jusqu’au bout de la critique des filets alors que les ONGE se sont contentées jusqu’à présent de demander l’interdiction des filets dérivants. Evidemment, il s’acharne contre les engins comme les dragues et chaluts accusés de la destruction des fonds marins et de captures accessoires qui génèrent des rejets. Pour lui, tout atteinte à l’intégrité des fonds marins est nécessairement négative alors que, suivant les milieux touchés, les effets sont très différents. S’il y a des effets négatifs, il y a aussi des effets positifs pour la pêche et, certaines espèces, comme le montrent des études récentes sur l’impact du chalut sur la production de poisson .
Par ailleurs, les pêcheurs ont depuis longtemps constaté qu’après de fortes tempêtes, les pêches étaient plus fructueuses, car les fonds remués avaient mis plus de nourriture à la disposition des espèces démersales. Les sennes sont aussi largement critiquées du fait des risques de captures accessoires sauf pour les sardines, l’anchois et les harengs.
C. Roberts est, à juste titre, fasciné par la beauté des coraux, la richesse de la biodiversité marine, la productivité des milieux marins peu impactés par les activités humaines. Nul ne niera que les océans étaient plus riches avant que diverses activités humaines, comme la pêche, ne viennent les transformer de diverses manières. Il en était de même des espaces continentaux avant que des milliards d’hommes ne viennent les transformer pour assurer leur existence. mais pour renforcer sa charge contre la pêche, l’auteur en vient à oublier certaines réalités comme la variabilité dans le temps de la productivité des océans, en fonction des modifications environnementales tout à fait indépendantes de l’action humaine. Il va jusqu’à écrire que « dans le passé, ils (les pêcheurs) étaient au moins sûrs de faire bonne pêche ». Ce fut loin d’être toujours le cas, avant même l’intensification de la pêche, puisque, tout au long de l’histoire de la pêche à la morue à Terre Neuve, il y eut des périodes, parfois longues, où la morue avait déserté ses zones habituelles. L’histoire des pêches sardinières est marquée par de longues décennies de disparitions des bancs de sardines qui ont entraîné une misère effroyable pour les pêcheurs bretons. Aujourd’hui encore, les stocks d’anchois dans le Golfe de Gascogne ou a large du Pérou varient considérablement en fonction des conditions environnementales. Un film comme « The Silver of the Sea » décrit avec finesse l’attente angoissée des macareux en Norvège. Si les bancs de harengs n’arrivent pas, leurs poussins vont mourir, et cela arrive fréquemment. Bien sûr, cette variabilité est aggravée par la surpêche, mais, indépendamment de celle-ci, les stocks de poissons varient considérablement et cela rend d’ailleurs très difficile, et aléatoire, une gestion scientifique de la pêche.
Même un phénomène comme la pollution est plus complexe qu’on l’imagine puisque des chercheurs viennent de découvrir que la pollution des animaux marins par le mercure est pour une bonne part liée à des processus naturels et aux conditions environnementales. La mer n’est donc pas toujours l’Eden dont on rêve.
Si Callum Roberts s’inquiète pour l’avenir à cause de la forte pression démographique et des bouleversements de l’environnement, il ne fait pas partie de ces biologistes ultra-réactionnaires, comme Garret Hardin, qui souhaitent une extermination par la famine ou les maladies de milliards de pauvres pour sauver la biodiversité. Roberts est un vrai humaniste qui s’inquiète, à juste titre, de la dégradation de l’environnement et veut éviter le malheur à l’humanité. Cependant sa vision du monde est profondément marquée par le souci de préserver et promouvoir la « Wilderness » sur les océans, d’écarter l’homme du maximum d’espaces marins. Il semble regretter que les hommes aient transformé la nature pour assurer leur subsistance parce qu’une forêt primaire est plus riche en biodiversité qu’un pâturage ou un champ de blé : « Le fait est que les herbages offrent moins de moyen de subsistance que les bois… » S’il a du mal a admettre que l’agriculture ait pu modifier la nature pour répondre aux besoin des hommes, on comprend qu’il ne puisse accepter que les pêcheurs transforment le milieu marin en appauvrissant sa biodiversité, certes, mais pour répondre à leur besoin du moment. De ce point de vue, les océans sont d’ailleurs bien moins altérés que les milieux terrestres et la pression sur la biodiversité marine est bien inférieure à celle qui s’exerce sur les continents ; ceci ne justifie pas bien sûr de poursuivre l’exploitation des mers sans prendre en compte cette biodiversité.
C. Roberts propose ainsi de mettre en réserves intégrales 35% des océans. L’objectif de 10% fixé par l’ONU ne peut être qu’une étape. Il assure évidemment que ces réserves permettront d’accroître les ressources disponibles pour les pêcheurs. Cela est parfois vrai et les pêcheurs eux-mêmes ont mis en place des réserves dans ce but. Mais les réserves marines sont loin d’avoir toujours des effets sociaux positifs, contrairement à ce que prétendent Roberts et de nombreux biologistes, d’abord intéressés par la biodiversité. Tarik Dahou, un chercheur de l’IRD, le constate : « La création d’une AMP (aire marine protégée) se fait le plus souvent sans tenir compte des usages locaux d’exploitation du milieu marin, et en se focalisant uniquement sur la conservation. De plus, il y a un déficit de compensation économique pour les secteurs les plus touchés par les mesures de protection, en particulier, les pêcheurs artisanaux ». Il poursuit : « Si l’on exclut la pêche d’une zone protégée, les exploitants artisanaux sont doublement perdants face aux armateurs plus importants, qui ont les moyens de partir au large, et aux promoteurs de l’écotourisme qui vont profiter des effets de la conservation »
Certains chapitres du livre contiennent de curieux passages qui paraissent dédouaner les grandes entreprises polluantes de leurs responsabilités. Mieux même, l’auteur vante parfois leur action. Ainsi, à propos des compagnies pétrolières : « On diabolise facilement ces compagnies, mais les principaux responsables de la pollution des mers ne sont pas les déversements accidentels des pétroliers, ni les forages pratiqués avec négligence : ce sont les gens comme vous et moi », et il poursuit : « le pétrole a valu quelques bienfaits à la flore et à la faune marine. Les effets délétères des marées noires ont contribué à la création de quelques-uns des premiers parcs marins, de même que l’exploitation des forêts avait encouragé celle des parcs nationaux au XIXè siècle ».
Le chapitre sur la pollution chimique se conclut ainsi : « Il est facile de s’indigner de l’ubiquité de la pollution chimique et de se répandre en injures contre la rapacité des firmes qui colportent ces produits, mais c’est oublier les milliers, peut-être les millions, de vies qu’ils sauvent ». Il y a une part de vérité dans ce constat, mais cela signifie clairement qu’un représentant du WWF ne va pas se répandre en injures contre la rapacité des multinationales de la chimie ou du pétrole. Le WWF, comme beaucoup d’ONGE, a trop besoin des gros financements de ces multinationales pour financer leurs parcs, leurs campagnes sur la pêche, leur bureaucratie et souvent, le train de vie de leurs dirigeants. Les pêcheurs, par contre, n’ont pas le droit à ces considérations positives, ils ne sont que des ravageurs et ils n’ont même pas l’excuse de faire vivre des millions de gens, à la différence des multinationales de la chimie et du pétrole. Contre eux, tout est uniquement à charge, curieuse distorsion…
Une vision libérale de la conservation.
Comme beaucoup d’ONGE, C. Roberts est un fervent partisan d’une privatisation des ressources halieutiques pour assurer leur durabilité. Il propose ainsi une adjudication des droits de pêche au plus offrant. On peut facilement imaginer qui en bénéficiera. La pêche et la conservation passeront sous le contrôle des milliardaires, financeurs des environnementalistes qui seront aussi leurs conseillers, Ils iront même jusqu’à acheter des droits de pêche pour que la pêche disparaisse de certaines zones, comme c’est déjà le cas parfois aux Etats-Unis. George Holmes, dans un récent article a bien analysé ce phénomène et les liaisons entre grandes entreprises, fondations et ONGE pour la défense de la biodiversité. De cette manière, la défense de la biodiversité vient conforter le capitalisme libéral , marginalisant totalement les pêcheurs, au point de les condamner à une quasi-disparition.
S’il ne préconise pas une interdiction immédiate des méthodes de pêche qu’il juge destructrices, ses propositions finales aboutissent à la programmation de cette interdiction. Il faut ici citer C. Roberts dans ses conseils au consommateur. « Choisissez des animaux capturés avec le mnimum de dégâts pour l’environnement. Les espèces « attrapées à la main », « pêchées à la ligne » (attention, cela peut vouloir dire à la palangre), « à la canne » ou « à la nasse » sont généralement recommandables. Evitez ce qui a été pêché au chalut, à l’aide de dragues, de filets maillants, de palangres ou de filets dérivants ». Pour aboutir à ses objectifs, il aurait dû ajouter qu’à la main, à la ligne ou au casier, on peut très bien réduire à néant des stocks de coquillages ou de poissons.
Avec « Océans», C. Roberts nous offre une analyse alarmante et salutaire de l’état actuel et futur de nos mers et de nos ressources marines. On voit pourtant clairement les dérives qu’entraînent ses analyses et surtout ses propositions. La pêche constitue pour lui la pire des menaces, alors que les multinationales de la chimie et du pétrole compensent leurs destructions par des éléments positifs. Il est certain que les pêcheurs doivent tenir compte de leur impact sur la biodiversité. Beaucoup en sont d’ailleurs conscients et ils sont souvent les premiers à se mobiliser lorsque les milieux côtiers et marins sont menacés. Ils sont également soucieux de changer leurs pratiques lorsqu’elles mettent en péril des ressources vitales pour leur avenir. Mais C. Roberts ne se contente pas de cela, il rêve du retour à un Eden océanique où des pêcheurs à la ligne viendraient parfois capturer quelques poissons. Pour lui, ils seraient plus nombreux qu’aujourd’hui ; peut-être, mais avant que cela se produise, la majorité des pêcheurs actuels auraient été sacrifiés au nom de la protection de la biodiversité. Même avec des lignes et quelques sennes pour les pélagiques, les pêcheurs du Sénégal sont déjà trop nombreux pour les ressources existantes, ce qui justifie leur opposition à l’intervention de chalutiers étrangers. Les réalités de la pêche sont différentes selon les lieux et sont le produit d’une histoire. C’est en fonction de ces réalités et non en fonction d’une vision idéalisée du futur possible que les adaptations doivent être conçues, en prenant en compte les réalités sociales comme l’état de la biodiversité. La senne, que préconise C. Roberts pour la pêche à la sardine, était critiquée par les pêcheurs bretons partisans du filet maillant. Aujourd’hui, seule subsiste, cette pêche à la bolinche avec une vingtaine de bateaux, le retour au filet maillant est impossible et de plus il poserait le problème des dauphins friands de sardines dans ces filets. Le chalut et la drague ont un impact sur les fonds, mais il est variable suivant la nature de ces fonds, une condamnation généralisée déstabiliserait totalement l’économie fragile des zones côtières au profit d’autres activités qui seraient sans doute aussi dangereuses pour la biodiversité. Il faut donc analyser les situations au cas par cas et travailler avec les pêcheurs pour améliorer leurs pratiques, voire changer d’engin si cela leur est possible. Mais les pêcheurs se méfient des solutions simplistes prônées par de nombreux écologistes ; beaucoup leur conseillent aujourd’hui d’utiliser les palangres au lieu du chalut , mais quand ils auront lu Callum Roberts, ils les dénonceront sans doute parce que les palangres capturent aussi des oiseaux et des requins. Les bons conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Les pêcheurs risquent à l’avenir d’avoir à faire face à de redoutables campagnes qui ne manqueront pas de financements.
Article publié le 20 janvier 2014 (1799)
Autres articles :
Adieu filets, palangres, sennes, dragues et chaluts : Pêcheurs, sortez vos cannes à pêche.
Avec la publication en français du dernier ouvrage de Callum Roberts , il y a de quoi alimenter les diatribes des médias et de la presse contre les pêcheurs, si du moins ils ont le courage de lire un livre de 500 pages, un peu plus long et plus sérieusement argumenté qu’une petite BD.
Callum Roberts, un scientifique très influent.
Callum Roberts est un biologiste anglais, spécialiste de la conservation marine, particulièrement des coraux. C’est un scientifique rigoureux et influent qui est à l’origine, en 2010, de la création du premier réseau mondial de réserves intégrales en haute mer. Il a bénéficié comme beaucoup d’autres du programme Pew fellows et il est très lié aux ONG environnementalistes où il a une très grande influence. Il est l’ambassadeur officiel du WWF de Grande-Bretagne.
Dans « Océans », il analyse longuement toutes les menaces qui pèsent sur les océans, maintenant et dans l’avenir. Il nous fait découvrir certaines menaces méconnues, mais sa critique principale s’adresse à la pêche qui représente pour lui la menace la plus ancienne et la plus grave. La pêche intervient comme un facteur aggravant des autres perturbations. Sont analysées, les menaces classiques bien connues : le réchauffement, l’acidification, la hausse du niveau des mers, les pollutions liées au pétrole et aux produits chimiques. De manière plus originale, il évoque des perturbations moins connues comme le développement de virus qui mettent en péril des espèces, les pollutions sonores qui perturbent sévèrement les mammifères marins, la multiplication des espèces invasives qui s’installent loin de leur écosystème d’origine. L’argumentation est basée sur les travaux scientifiques, mais on peut regretter que la traduction soit parfois erronée, ainsi on est étonné de découvrir des marais salants en Ecosse alors qu’il s’agit de marais maritimes naturels, ou encore la confusion entre les crevettes et les langoustines.
Une charge virulente contre la pêche
Tout au long du livre, m^me dans les chapitres qui ne sont pas consacrés à la pêche, il ne peut s’empêcher de revenir sur le rôle négatif et destructeur de la pêche. Il n’attaque pas seulement la surpêche mais des pratiques millénaires. Ainsi il considère que la pêche est la principale responsable de la mortalité des oiseaux marins. Il cite d’ailleurs un cas étonnant de pêche à la palangre où les hameçons ont accroché, grâce aux appâts, bien plus d’oiseaux que de poissons. Il en tire la conclusion que la palangre est un engin à proscrire. Si les cas qu’il cite sont tout à fait réels, son analyse est uniquement à charge, car il pourrait aussi indiquer que la pêche a favorisé le développement de certaines espèces d’oiseaux attirés par les rejets des bateaux de pêche (poissons et résidus de l’étripage). Callum Roberts remet également en cause les filets, qu’ils soient dérivants ou calés, car ils ont le tort de prendre également des poissons non désirés, des tortues ou des mammifères marins. Il a l’honnêteté d’aller jusqu’au bout de la critique des filets alors que les ONGE se sont contentées jusqu’à présent de demander l’interdiction des filets dérivants. Evidemment, il s’acharne contre les engins comme les dragues et chaluts accusés de la destruction des fonds marins et de captures accessoires qui génèrent des rejets. Pour lui, tout atteinte à l’intégrité des fonds marins est nécessairement négative alors que, suivant les milieux touchés, les effets sont très différents. S’il y a des effets négatifs, il y a aussi des effets positifs pour la pêche et, certaines espèces, comme le montrent des études récentes sur l’impact du chalut sur la production de poisson .
Par ailleurs, les pêcheurs ont depuis longtemps constaté qu’après de fortes tempêtes, les pêches étaient plus fructueuses, car les fonds remués avaient mis plus de nourriture à la disposition des espèces démersales. Les sennes sont aussi largement critiquées du fait des risques de captures accessoires sauf pour les sardines, l’anchois et les harengs.
Une vision idéalisée de la mer sans l’homme
C. Roberts est, à juste titre, fasciné par la beauté des coraux, la richesse de la biodiversité marine, la productivité des milieux marins peu impactés par les activités humaines. Nul ne niera que les océans étaient plus riches avant que diverses activités humaines, comme la pêche, ne viennent les transformer de diverses manières. Il en était de même des espaces continentaux avant que des milliards d’hommes ne viennent les transformer pour assurer leur existence. mais pour renforcer sa charge contre la pêche, l’auteur en vient à oublier certaines réalités comme la variabilité dans le temps de la productivité des océans, en fonction des modifications environnementales tout à fait indépendantes de l’action humaine. Il va jusqu’à écrire que « dans le passé, ils (les pêcheurs) étaient au moins sûrs de faire bonne pêche ». Ce fut loin d’être toujours le cas, avant même l’intensification de la pêche, puisque, tout au long de l’histoire de la pêche à la morue à Terre Neuve, il y eut des périodes, parfois longues, où la morue avait déserté ses zones habituelles. L’histoire des pêches sardinières est marquée par de longues décennies de disparitions des bancs de sardines qui ont entraîné une misère effroyable pour les pêcheurs bretons. Aujourd’hui encore, les stocks d’anchois dans le Golfe de Gascogne ou a large du Pérou varient considérablement en fonction des conditions environnementales. Un film comme « The Silver of the Sea » décrit avec finesse l’attente angoissée des macareux en Norvège. Si les bancs de harengs n’arrivent pas, leurs poussins vont mourir, et cela arrive fréquemment. Bien sûr, cette variabilité est aggravée par la surpêche, mais, indépendamment de celle-ci, les stocks de poissons varient considérablement et cela rend d’ailleurs très difficile, et aléatoire, une gestion scientifique de la pêche.
Même un phénomène comme la pollution est plus complexe qu’on l’imagine puisque des chercheurs viennent de découvrir que la pollution des animaux marins par le mercure est pour une bonne part liée à des processus naturels et aux conditions environnementales. La mer n’est donc pas toujours l’Eden dont on rêve.
L’idéal de la Wilderness marine
Si Callum Roberts s’inquiète pour l’avenir à cause de la forte pression démographique et des bouleversements de l’environnement, il ne fait pas partie de ces biologistes ultra-réactionnaires, comme Garret Hardin, qui souhaitent une extermination par la famine ou les maladies de milliards de pauvres pour sauver la biodiversité. Roberts est un vrai humaniste qui s’inquiète, à juste titre, de la dégradation de l’environnement et veut éviter le malheur à l’humanité. Cependant sa vision du monde est profondément marquée par le souci de préserver et promouvoir la « Wilderness » sur les océans, d’écarter l’homme du maximum d’espaces marins. Il semble regretter que les hommes aient transformé la nature pour assurer leur subsistance parce qu’une forêt primaire est plus riche en biodiversité qu’un pâturage ou un champ de blé : « Le fait est que les herbages offrent moins de moyen de subsistance que les bois… » S’il a du mal a admettre que l’agriculture ait pu modifier la nature pour répondre aux besoin des hommes, on comprend qu’il ne puisse accepter que les pêcheurs transforment le milieu marin en appauvrissant sa biodiversité, certes, mais pour répondre à leur besoin du moment. De ce point de vue, les océans sont d’ailleurs bien moins altérés que les milieux terrestres et la pression sur la biodiversité marine est bien inférieure à celle qui s’exerce sur les continents ; ceci ne justifie pas bien sûr de poursuivre l’exploitation des mers sans prendre en compte cette biodiversité.
C. Roberts propose ainsi de mettre en réserves intégrales 35% des océans. L’objectif de 10% fixé par l’ONU ne peut être qu’une étape. Il assure évidemment que ces réserves permettront d’accroître les ressources disponibles pour les pêcheurs. Cela est parfois vrai et les pêcheurs eux-mêmes ont mis en place des réserves dans ce but. Mais les réserves marines sont loin d’avoir toujours des effets sociaux positifs, contrairement à ce que prétendent Roberts et de nombreux biologistes, d’abord intéressés par la biodiversité. Tarik Dahou, un chercheur de l’IRD, le constate : « La création d’une AMP (aire marine protégée) se fait le plus souvent sans tenir compte des usages locaux d’exploitation du milieu marin, et en se focalisant uniquement sur la conservation. De plus, il y a un déficit de compensation économique pour les secteurs les plus touchés par les mesures de protection, en particulier, les pêcheurs artisanaux ». Il poursuit : « Si l’on exclut la pêche d’une zone protégée, les exploitants artisanaux sont doublement perdants face aux armateurs plus importants, qui ont les moyens de partir au large, et aux promoteurs de l’écotourisme qui vont profiter des effets de la conservation »
De curieuses indulgences
Certains chapitres du livre contiennent de curieux passages qui paraissent dédouaner les grandes entreprises polluantes de leurs responsabilités. Mieux même, l’auteur vante parfois leur action. Ainsi, à propos des compagnies pétrolières : « On diabolise facilement ces compagnies, mais les principaux responsables de la pollution des mers ne sont pas les déversements accidentels des pétroliers, ni les forages pratiqués avec négligence : ce sont les gens comme vous et moi », et il poursuit : « le pétrole a valu quelques bienfaits à la flore et à la faune marine. Les effets délétères des marées noires ont contribué à la création de quelques-uns des premiers parcs marins, de même que l’exploitation des forêts avait encouragé celle des parcs nationaux au XIXè siècle ».
Le chapitre sur la pollution chimique se conclut ainsi : « Il est facile de s’indigner de l’ubiquité de la pollution chimique et de se répandre en injures contre la rapacité des firmes qui colportent ces produits, mais c’est oublier les milliers, peut-être les millions, de vies qu’ils sauvent ». Il y a une part de vérité dans ce constat, mais cela signifie clairement qu’un représentant du WWF ne va pas se répandre en injures contre la rapacité des multinationales de la chimie ou du pétrole. Le WWF, comme beaucoup d’ONGE, a trop besoin des gros financements de ces multinationales pour financer leurs parcs, leurs campagnes sur la pêche, leur bureaucratie et souvent, le train de vie de leurs dirigeants. Les pêcheurs, par contre, n’ont pas le droit à ces considérations positives, ils ne sont que des ravageurs et ils n’ont même pas l’excuse de faire vivre des millions de gens, à la différence des multinationales de la chimie et du pétrole. Contre eux, tout est uniquement à charge, curieuse distorsion…
Une vision libérale de la conservation.
Comme beaucoup d’ONGE, C. Roberts est un fervent partisan d’une privatisation des ressources halieutiques pour assurer leur durabilité. Il propose ainsi une adjudication des droits de pêche au plus offrant. On peut facilement imaginer qui en bénéficiera. La pêche et la conservation passeront sous le contrôle des milliardaires, financeurs des environnementalistes qui seront aussi leurs conseillers, Ils iront même jusqu’à acheter des droits de pêche pour que la pêche disparaisse de certaines zones, comme c’est déjà le cas parfois aux Etats-Unis. George Holmes, dans un récent article a bien analysé ce phénomène et les liaisons entre grandes entreprises, fondations et ONGE pour la défense de la biodiversité. De cette manière, la défense de la biodiversité vient conforter le capitalisme libéral , marginalisant totalement les pêcheurs, au point de les condamner à une quasi-disparition.
Vive la pêche à la ligne
S’il ne préconise pas une interdiction immédiate des méthodes de pêche qu’il juge destructrices, ses propositions finales aboutissent à la programmation de cette interdiction. Il faut ici citer C. Roberts dans ses conseils au consommateur. « Choisissez des animaux capturés avec le mnimum de dégâts pour l’environnement. Les espèces « attrapées à la main », « pêchées à la ligne » (attention, cela peut vouloir dire à la palangre), « à la canne » ou « à la nasse » sont généralement recommandables. Evitez ce qui a été pêché au chalut, à l’aide de dragues, de filets maillants, de palangres ou de filets dérivants ». Pour aboutir à ses objectifs, il aurait dû ajouter qu’à la main, à la ligne ou au casier, on peut très bien réduire à néant des stocks de coquillages ou de poissons.
Les dérives d’une réflexion salutaire
Avec « Océans», C. Roberts nous offre une analyse alarmante et salutaire de l’état actuel et futur de nos mers et de nos ressources marines. On voit pourtant clairement les dérives qu’entraînent ses analyses et surtout ses propositions. La pêche constitue pour lui la pire des menaces, alors que les multinationales de la chimie et du pétrole compensent leurs destructions par des éléments positifs. Il est certain que les pêcheurs doivent tenir compte de leur impact sur la biodiversité. Beaucoup en sont d’ailleurs conscients et ils sont souvent les premiers à se mobiliser lorsque les milieux côtiers et marins sont menacés. Ils sont également soucieux de changer leurs pratiques lorsqu’elles mettent en péril des ressources vitales pour leur avenir. Mais C. Roberts ne se contente pas de cela, il rêve du retour à un Eden océanique où des pêcheurs à la ligne viendraient parfois capturer quelques poissons. Pour lui, ils seraient plus nombreux qu’aujourd’hui ; peut-être, mais avant que cela se produise, la majorité des pêcheurs actuels auraient été sacrifiés au nom de la protection de la biodiversité. Même avec des lignes et quelques sennes pour les pélagiques, les pêcheurs du Sénégal sont déjà trop nombreux pour les ressources existantes, ce qui justifie leur opposition à l’intervention de chalutiers étrangers. Les réalités de la pêche sont différentes selon les lieux et sont le produit d’une histoire. C’est en fonction de ces réalités et non en fonction d’une vision idéalisée du futur possible que les adaptations doivent être conçues, en prenant en compte les réalités sociales comme l’état de la biodiversité. La senne, que préconise C. Roberts pour la pêche à la sardine, était critiquée par les pêcheurs bretons partisans du filet maillant. Aujourd’hui, seule subsiste, cette pêche à la bolinche avec une vingtaine de bateaux, le retour au filet maillant est impossible et de plus il poserait le problème des dauphins friands de sardines dans ces filets. Le chalut et la drague ont un impact sur les fonds, mais il est variable suivant la nature de ces fonds, une condamnation généralisée déstabiliserait totalement l’économie fragile des zones côtières au profit d’autres activités qui seraient sans doute aussi dangereuses pour la biodiversité. Il faut donc analyser les situations au cas par cas et travailler avec les pêcheurs pour améliorer leurs pratiques, voire changer d’engin si cela leur est possible. Mais les pêcheurs se méfient des solutions simplistes prônées par de nombreux écologistes ; beaucoup leur conseillent aujourd’hui d’utiliser les palangres au lieu du chalut , mais quand ils auront lu Callum Roberts, ils les dénonceront sans doute parce que les palangres capturent aussi des oiseaux et des requins. Les bons conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Les pêcheurs risquent à l’avenir d’avoir à faire face à de redoutables campagnes qui ne manqueront pas de financements.
Alain Le Sann
Janvier 2014
Article publié le 20 janvier 2014 (1799)
Autres articles :
- Des initiatives pour contourner l'étiquetage opaque des produits de la mer
- Pêche durable : Du poisson Vert ? Non merci !
- Pêche profonde : Discussion autour du chalutage dans les grands fonds
- Documentaire. Pêcheurs et consommateurs, tout simplement...
- Auchan, plutôt requin que poisson "made in France"
- Chalutage : MSC ordonne au WWF Canada de retirer sa pub
- Les pêcheurs britanniques anticipent l'interdiction de la drague à coquilles
- Chalutage, chantage au labourage !
Pour aller plus loin...
From 13 December 2014, the rules for labels accompanying all fishery and aquaculture products for EU consumers will change. This pocket guide explains what must appear on the new labels and what additional information can be displayed.
Le 26 Août 2014
Le 8 Janvier 2014
Un rapport dévastateur sur les « prises accidentelles »
Source : La Presse par Éric-Pierre Champagne
Des victimes « collatérales »
Le problème n’est pas nouveau. La surpêche du thon n’est pas sans conséquence pour l’espèce, mais elle fait aussi depuis des années une victime collatérale : le dauphin à long bec. Dans l’océan Indien, jusqu’à tout récemment, l’industrie de la pêche sri-lankaise tuait ou blessait 15 000 dauphins par année. Par ailleurs, une réglementation plus sévère dans l’océan Pacifique a permis de réduire considérablement les prises accidentelles, mais les scientifiques s’inquiètent de voir la population de dauphins stagner malgré ces nouvelles mesures. Pour expliquer cet état de fait, le NRDC émet entre autres l’hypothèse que la réglementation n’est pas respectée par toute l’industrie.
Le 14 Août 2014
Thonier-senneur. Les tortues marines passent entre les mailles des filets géants
La pêche à la senne se déroule à bord de thoniers-senneurs, des navires puissants pouvant atteindre plus de 100 mètres de longueur, utilisant des filets (les "sennes") de plus de 1,5 km de long et ciblant les thons tropicaux. Afin d’optimiser les captures, cette pêche industrielle au thon utilise notamment des dispositifs de concentration de poisson (DCP), des systèmes flottants au milieu de l’océan servant à attirer les grands poissons pélagiques et particulièrement les thons tropicaux. Ces méthodes sont souvent accusées de générer des captures accidentelles importantes.
Bien sûr, les DCP restent un problème car ils "attirent des jeunes tortues marines qui peuvent se retrouver prises dans les filets utilisés pour fabriquer ces DCP. Mais dans l’ensemble, cela joue un faible rôle dans les captures accidentelles", toujours selon l'auteur. Cependant, depuis 2013, "la construction de ces DCP a été modifié par la flottille européenne pour limiter le nombre de tortues emmêlées dans les filets et les premiers retours semblent très positifs".
D'après les articles d'Ifremer : Quels sont les impacts de la pêche thonière à la senne sur les tortues ? et de zinfos974 : Pêche à la senne: Les tortues marines passent entre les mailles des filets
![]() À partir du 13 décembre 2014, l’étiquette des produits de la pêche devra indiquer l’engin – chalut, senne ou filet, etc. – avec lequel le poisson a été capturé. Pas sûr que cette information supplémentaire guide les consommateurs vers des produits durables.
À partir du 13 décembre 2014, l’étiquette des produits de la pêche devra indiquer l’engin – chalut, senne ou filet, etc. – avec lequel le poisson a été capturé. Pas sûr que cette information supplémentaire guide les consommateurs vers des produits durables.
Source : UFC Que Choisir par Florence Humbert
Adoptée le 10 décembre 2013, la réforme de la Politique commune de la pêche (PCP) prévoyait notamment d’améliorer l’étiquetage des produits de la mer. Il s’agissait de fournir aux consommateurs des « informations claires et complètes, notamment sur l’origine des produits ainsi que sur leurs méthodes de production », afin qu’ils « puissent faire des choix en connaissance de cause ». Il faut dire que la traçabilité des produits de la mer laisse vraiment à désirer, surtout si on la compare aux autres denrées alimentaires, les viandes en particulier, dont l’indication de l’origine va devenir obligatoire.
Le présent projet de loi, déposé par le Gouvernement, a pour objet la mise en place de « nouveaux outils de régulation économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels ».
Source : Sénat
Enquête. Les pêcheurs du nord de la France sont en colère après les professionnels hollandais. Ces derniers munissent leur bateau d'un courant électrique pour paralyser les poissons. Une technique qui n'est pas autorisée en France et en Belgique. Alors lorsque les Français pêchent dans les mêmes eaux, ils se disent défavorisés, et parlent de concurrence déloyale.
Le 26 Avril 2014
![]() Le merlu de ligne des pêcheurs artisans basques et le merlu de ligne MSC capturé par l’armement industriel galicien « Grupo Regal »
Le merlu de ligne des pêcheurs artisans basques et le merlu de ligne MSC capturé par l’armement industriel galicien « Grupo Regal »
Le 26 Août 2014
A bord du caseyeur "Notre Dame de Kerizinen II"
D'après le marin : Reportage Vidéo - Une marée au crabe en mer Celtique
A partir du 13 décembre 2014, nouvel étiquetage du poisson sur les étals
From 13 December 2014, the rules for labels accompanying all fishery and aquaculture products for EU consumers will change. This pocket guide explains what must appear on the new labels and what additional information can be displayed.
Cliquer Ici pour télécharger "A pocket guide to the EU’s new fish and aquaculture consumer labels"
Union Nationale de la Poissonnerie Française
Nouveautés dans l’étiquetage : méthodes de pêche et zones plus précises doivent être mentionnées
Ce que dit l’Union Nationale de la Poissonnerie Française (UNPF) dans son magazine d’information l’Info N°18 Octobre-Décembre 2014
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
L’information des consommateurs sur les produits de la pêche et de l’aquaculture
Des modes de présentation et d’affichage divers
Union Nationale de la Poissonnerie Française
Nouveautés dans l’étiquetage : méthodes de pêche et zones plus précises doivent être mentionnées
Ce que dit l’Union Nationale de la Poissonnerie Française (UNPF) dans son magazine d’information l’Info N°18 Octobre-Décembre 2014
Dès le 13 décembre 2014, il y aura désormais l’obligation de noter la méthode de pêche et une zone de pêche plus précise.
L’UNPF condamne la mise en place de ce changement car c’est une surcharge de travail qui engendre des coûts. Toutefois, il faut envisager cette mesure comme une garantie supplémentaire pour le consommateur de la qualité du produit, de sa fraîcheur, de sa traçabilité et du respect de l’environnement.
Profitons-en pour consolider l'image de la poissonnerie artisanale et de son savoir-faire.
Jusqu’au 13 décembre 2014, trois éléments suffisaient :
L’UNPF condamne la mise en place de ce changement car c’est une surcharge de travail qui engendre des coûts. Toutefois, il faut envisager cette mesure comme une garantie supplémentaire pour le consommateur de la qualité du produit, de sa fraîcheur, de sa traçabilité et du respect de l’environnement.
Profitons-en pour consolider l'image de la poissonnerie artisanale et de son savoir-faire.
Jusqu’au 13 décembre 2014, trois éléments suffisaient :
- la dénomination commerciale de l’espèce,
- le mode de production,
- la zone de capture ou le pays d’élevage.
À partir du 13 décembre, le règlement information consommateur 2065 /2001 sera remplacé par le règlement 1379 /2013.
Deux éléments devront être rajoutés :
- une zone de pêche plus précise que la zone FAO pour l’Atlantique Nord Est et la Méditerranée.
Pour ces deux zones, le nom de la sous-zone ou de la division de pêche figurant sur la liste des sous zones de pêche et des divisions de la FAO est indiqué obligatoirement au consommateur.
FAO 27
Sous-zone I : Mer de Barents
Sous-zone II : Mers de Norvège
Sous-zone III : Mer Baltique
Sous-zone IV : Mer du Nord
Sous-zone V : Islande et Féroé
Sous-zone VI : Ouest Ecosse
Sous-zone VII : Manche et Mers Celtiques
Sous-zone VIII : Golfe de Gascogne
Sous-zone IX : Ouest Portugal
Sous-zone X : Açores
Sous-zone XII : Nord Açores
Sous-zone XIV : Est Groenland
FAO 37
Sous-zone I : Ouest Méditerranée
Sous-zone II : Centre Méditerranée
Sous-zone III : Est Méditerranée
Sous-zone IV : Mer Noire
- la méthode de pêche. L’un des 7 engins de pêche énumérés doit obligatoirement figurer sur l’étiquette : sennes, chaluts, filets maillants et filets similaires, filets tournants et filets soulevés, lignes et hameçons, dragues, ainsi que casiers et pièges.
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
L’information des consommateurs sur les produits de la pêche et de l’aquaculture
La nouvelle réglementation communautaire fixe des dispositions relatives à l’information des consommateurs plus complètes que les précédentes, notamment la mention de zones de pêche plus précises et l’indication de la catégorie d’engin de pêche.
Source : Ministère de l'économie (DGCCRF) - 09/12/2014
La réglementation communautaire portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture vient d’évoluer.
Outre les mentions déjà obligatoires depuis 2001, comme la dénomination commerciale et le mode de production, le dernier règlement communautaire[1] fixe de nouvelles dispositions qui portent notamment sur la catégorie d’engin de pêche et les zones de pêche. Ces obligations s’appliquent à partir du 13 décembre 2014.
Ce texte concerne l’information du consommateur final, lors la vente au détail de poissons, algues, mollusques et crustacés,
Les conserves ou les œufs de poissons, les produits cuits (à l’exception des crustacés non décortiqués) ou préparés avec d’autres ingrédients (salades, marinades, plats cuisinés…) ne sont pas concernés. En revanche, si les produits ne comportent que des produits de la mer et sont présentés en brochettes, ficelés, bardés ou accompagnés d’un ingrédient utilisé uniquement à titre décoratif, ils doivent être étiquetés conformément au règlement.
Le consommateur final de produits non transformés de la pêche et de l’aquaculture doit être informé :
- de la dénomination commerciale,
- du nom scientifique,
- de la méthode de production : « pêché », « pêché en eaux douces » ou « élevé »,
- de la zone de pêche ou du pays d’élevage,
Pour les poissons d’aquaculture, le pays d’élevage correspond au pays dans lequel « le produit a atteint plus de la moitié de son poids final ou est resté plus de la moitié de la période d’élevage ».
Pour les produits pêchés en eaux douces, la mention des eaux d’origine dans le pays de provenance doit être indiquée. Les « eaux » peuvent être entendues comme le nom d’un fleuve, d’un lac, d’un étang ou d’une zone de lacs ou d’étangs.
A noter que les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de production plus précise (« Huîtres élevées en France, affinées en Vendée », par exemple).
Les autres mentions obligatoires sont :
- la catégorie de l’engin de pêche (« senne », « chalut », « filet maillant »…),
- la mention « décongelé ». Des dérogations sont cependant permises (denrées utilisées comme ingrédient dans une salade composée, par exemple).
Des modes de présentation et d’affichage divers
Les producteurs doivent étiqueter tous les produits s’ils sont préemballés.
Pour les produits non préemballés, l’information peut être fournie sous différentes formes. Il peut s’agir de tableaux (comme pour les catégories d’engins de pêche), de cartes (pour les zones de pêche) par exemple.
A noter que la vente en mélange est autorisée. Pour le mélange d’espèces, la liste des mentions obligatoires doit être indiquée pour chaque espèce. Cette obligation s’applique aux plateaux de fruits de mer notamment. Les informations communes à plusieurs espèces peuvent être rassemblées (« huîtres et moules élevées en France », par exemple).
Des informations complémentaires facultatives sont autorisées (date de capture, date de débarquement…) sous réserve qu’elles soient vérifiables, qu’elles ne soient pas trompeuses ou de nature à induire le consommateur en erreur.
Les produits étiquetés avant le 13 décembre 2014 et qui ne sont pas conformes aux nouvelles règles peuvent être vendus jusqu’à épuisement des stocks. Cependant, les étiquettes en stock qui ne sont pas encore collées sur l’emballage des produits ne peuvent pas être utilisées.
Les étiquettes utilisées à partir de cette date doivent satisfaire aux nouvelles exigences.
A noter que pour les publicités hors du lieu de vente, la mention de l’origine du produit, pour les denrées périssables, est indispensable. L’indication de la zone de pêche permet de satisfaire à cette obligation.
[1] Le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture a abrogé le règlement précédent (CE) n° 104/2000.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 26 Août 2014
La connaissance des engins de pêche permet de minimiser les impacts sur les fonds marins
Le contexte prime : les meilleures pratiques croisent le type d'engin de pêche, l'habitat et la gestion de la pêcherie
Dans le volume 2 des Séries Scientifiques du Marine Stewardship Council (MSC), une étude montre que la bonne gestion et la conservation des pêcheries et des zones de pêche exigent une compréhension globale des méthodes et engins de pêche.
Source : Marine Stewarship Council
Dans le volume 2 des Séries Scientifiques du Marine Stewardship Council (MSC), une étude montre que la bonne gestion et la conservation des pêcheries et des zones de pêche exigent une compréhension globale des méthodes et engins de pêche.
Source : Marine Stewarship Council
Les engins de pêche utilisés pour capturer les espèces benthiques et démersales ont un impact variable sur les fonds marins. Comprendre les impacts directs et indirects des pratiques de pêche sur les habitats benthiques est important afin d’assurer la viabilité des océans de la planète.
Dans le volume 2, Chris Grieve et al. explore les meilleures pratiques de mesure, de gestion et d'atténuation des impacts benthiques de la pêche. L'examen porte sur un grand nombre d'engins de pêche les plus largement utilisés. Les auteurs y donnent une description de chaque engin et de son interaction avec l'environnement.
Historiquement, l'amélioration des engins de pêche visait à maximiser les captures. Aujourd’hui, pour répondre aux préoccupations de l'industrie et des ONG, la recherche se concentre davantage sur des modifications d’engins visant à minimiser les impacts sur les fonds marins et les prises accessoires.
Dans l’article, Analyse des impacts sur les habitats des engins de pêche mobiles et statiques qui interagissent avec les fonds marins, les auteurs écrivent : «Les travaux de recherche sur les habitats benthiques sont en plein essor et deviennent disponibles pour les décideurs et les gestionnaires de ressources. La prise de conscience de la nécessité de gérer activement les composants complexes des écosystèmes marins et de comprendre les impacts directs et indirects de la pêche augmente".
La classification des types d’engin de l’Organisation Mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture (FAO) est en cours d’actualisation pour intégrer les récents développements dans ce domaine et sera prochainement publiée. Parmi les améliorations récentes, nous pouvons citer les avancées en technologie de la fibre, la mécanisation de la manutention des engins, l'amélioration des performances des navires et la motorisation, le traitement informatique pour la conception des engins, les aides à la navigation et la détection de poissons.
Cette analyse, ainsi que trois documents publiés dans le volume 2 des Séries Scientifiques, guident le MSC dans son développement stratégique sur les meilleures pratiques mondiales.
D'autres documents publiés sur la réduction des prises accessoires et les recommandations pour la gestion des stocks de saumon ont également joué un rôle important dans l'orientation de la Révision du Référentiel Pêcherie, un processus qui permet au Référentiel MSC de répondre aux meilleures pratiques scientifiques actuelles.
Dr David Agnew, directeur de l’équipe Référentiel du MSC déclare : «Pour vraiment apprécier les impacts mondiaux de la pêche, il est nécessaire d’augmenter la connaissance scientifique. Au MSC, nous révisons régulièrement nos Référentiels pour assurer leur rigueur et pertinence. Grâce à nos Séries Scientifiques, nous continuons de partager de nouvelles connaissances et contribuons à l'effort mondial de recherche sur la pêche durable ".
Le portail de recherche halieutique a été lancé en Novembre 2013 pour partager les connaissances scientifiques qui alimentent le Référentiel MSC. Le résultat de la révision du Référentiel sera publié le 1er Août 2014, intégré aux Exigences de certification des pêcheries MSC 2.0
Cliquer Ici pour télécharger le document "Review of habitat dependent impacts of mobile and static fishing gears that interact with the sea bed"
Pour plus d’informations : MSC
Le 18 Septembre 2014
Morizur Yvon, Gaudou Olivier, Demaneche Sebastien
Durant la période 2008-2013, des observations de captures ont été réalisées à bord des fileyeurs de mer du Nord, d’Atlantique et de Méditerranée (Corse).
Les filets observés n’étaient pas équipés de pingers et les observations ont été analysées pour déterminer des taux de capture annuels moyens des espèces de mammifères marins par flottille.
Des estimations par flottille ont ensuite été calculées en procédant à des extrapolations sur la base des efforts de pêche de l’année 2012. Parmi les mammifères marins, le marsouin commun Phocoena phocoena était l’espèce la plus fréquente dans les filets. Une estimation annuelle de 600 marsouins capturés a été obtenue pour l’ensemble de la flotte française. Les autres espèces rencontrées dans les filets étaient principalement le dauphin commun Delphinus delphis, le dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba, et les phoques Phoca vitulina et Halichoerus grypus.
Les trémails à baudroie et les trémails à sole sont responsables de 80 % des captures de marsouins. Quelques captures (20 %) existent aussi au filet maillant dans le golfe de Gascogne. Aucune capture accidentelle n’a été recensée en Méditerranée. La majorité des captures de marsouins se produit à 80-100 mètres de profondeur. Certains métiers de pêche de la zone concernée par le dispositif réglementaire « pingers » ne s’avèrent pas concernés par les interactions avec les marsouins. C’est le cas notamment des filets maillants à araignées en Manche.
Les captures accidentelles de marsouins ont été peu fréquemment observées en Manche centrale alors qu’elles existent aux deux extrémités de la Manche. Les taux de capture par opération de pêche ont été calculés par métier et par zone, et l’étude s’attache à décrire les variations observées. Les captures accidentelles de marsouins semblent saisonnières et la modulation saisonnière est différente selon les zones. Les résultats sont discutés en relation avec le règlement européen 812/2004 dans lequel les engins de pêche de type trémail ne sont pas mentionnés.
Cliquer Ici pour télécharger le document "Morizur Yvon, Gaudou Olivier, Demaneche Sebastien (2014). Analyse des captures accidentelles de mammifères marins dans les pêcheries françaises aux filets fixes. Source : Archimer
Pour plus d’informations : MSC
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 13 Octobre 2014
Consommation de poisson : Portefeuille VS Environnement
Selon le Greendex (*), l'environnement n'impacte pas la consommation du poisson et de produits de la mer contrairement à la consommation de viande (boeuf, poulet et porc)...
Greenpeace cible les DCP utilisés par les pêcheries thonières
DCP : Dispositif de concentration des poissons
Faute de pouvoir les interdire, Greenpeace demande aux marques françaises d’arrêter de s’approvisionner en thon pêché avec des DCP. « Nous ne demandons pas l’impossible. Certaines entreprises françaises pratiquent déjà la pêche à la senne sans DCP pour le thon albacore. C’est également le cas dans d’autres pays, comme au Royaume-Uni ou en Italie, où les marques John West et Mareblu se sont engagées à vendre 100 % de thon pêché à la canne ou sans DCP d’ici 2016 ».
Florence Humbert de l’association de consommateurs UFC Que Choisir :
Sauf que Greenpeace oublie de préciser l’impact non négligeable de ces techniques de pêche moins intensives sur le prix des produits. Par exemple, le prix du thon albacore au naturel de la marque Phare d’Eckmühl, la mieux notée par Greenpeace, atteint 26,25 €/kg contre 16,24 €/kg pour Petit Navire, classé sévèrement par l’ONG. Le thon en boîte, source de protéines de bonne qualité pour les ménages les plus modestes, est-il condamné à devenir unproduit de luxe ? C’est ce qui risque d’advenir si l’on ne gèle pas rapidement le nombre de DCP utilisés par les navires jusqu’à ce que leur impact sur la ressource ait été évalué par les comités scientifiques des organisations régionales de la pêche.
Extrait de l’article de Que Choisir : Thons en conserve. Les ravages d’une pêche non durable
Selon le Greendex, l'"Environnement" impacte peu les consommateurs de poisson en France, Espagne, Japon, Suède, Royaume-Uni et Russie
(*) Greendex : premier indice global des «éco-consommateurs»
La National Geographic Society présente les résultats de l'étude Greendex, un sondage planétaire des comportements de 18 000 consommateurs-internautes de 18 pays différents. Les types d'habitations, les modes de transport et les habitudes de consommation sont les principaux critères d'évaluation de ce grand comparatif mené depuis 2008.
Cliquer Ici pour accéder aux données Greendex 2014
Selon le Greendex, la conserve (de thon) a un bel avenir en France....
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 18 Septembre 2014
Analyse des captures accidentelles de mammifères marins dans les pêcheries françaises aux filets fixes
Morizur Yvon, Gaudou Olivier, Demaneche Sebastien
Ifremer - août 2014
Durant la période 2008-2013, des observations de captures ont été réalisées à bord des fileyeurs de mer du Nord, d’Atlantique et de Méditerranée (Corse).
Les filets observés n’étaient pas équipés de pingers et les observations ont été analysées pour déterminer des taux de capture annuels moyens des espèces de mammifères marins par flottille.
Des estimations par flottille ont ensuite été calculées en procédant à des extrapolations sur la base des efforts de pêche de l’année 2012. Parmi les mammifères marins, le marsouin commun Phocoena phocoena était l’espèce la plus fréquente dans les filets. Une estimation annuelle de 600 marsouins capturés a été obtenue pour l’ensemble de la flotte française. Les autres espèces rencontrées dans les filets étaient principalement le dauphin commun Delphinus delphis, le dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba, et les phoques Phoca vitulina et Halichoerus grypus.
Les trémails à baudroie et les trémails à sole sont responsables de 80 % des captures de marsouins. Quelques captures (20 %) existent aussi au filet maillant dans le golfe de Gascogne. Aucune capture accidentelle n’a été recensée en Méditerranée. La majorité des captures de marsouins se produit à 80-100 mètres de profondeur. Certains métiers de pêche de la zone concernée par le dispositif réglementaire « pingers » ne s’avèrent pas concernés par les interactions avec les marsouins. C’est le cas notamment des filets maillants à araignées en Manche.
Les captures accidentelles de marsouins ont été peu fréquemment observées en Manche centrale alors qu’elles existent aux deux extrémités de la Manche. Les taux de capture par opération de pêche ont été calculés par métier et par zone, et l’étude s’attache à décrire les variations observées. Les captures accidentelles de marsouins semblent saisonnières et la modulation saisonnière est différente selon les zones. Les résultats sont discutés en relation avec le règlement européen 812/2004 dans lequel les engins de pêche de type trémail ne sont pas mentionnés.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 8 Janvier 2014
Un rapport dévastateur sur les « prises accidentelles »
Un peu de dauphin avec votre salade de thon? C’est malheureusement ce qui arrive aux États-Unis, souvent à l’insu des consommateurs, estime le Natural Resources Defense Council (NRDC).
Cet influent organisme américain a rendu public hier un rapport dévastateur sur l’impact des différentes techniques de pêche dans le monde. Et de nombreux pays, dont le Canada, sont montrés du doigt pour leur laxisme en matière de pêche durable.
Au Canada, les baleines et marsouins communs meurent parce que les pêcheries de la côte Est, et plus particulièrement celles qui produisent du crabe et du homard, n’utilisent pas les mêmes techniques de pêche que celles exigées aux États-Unis.
Voici six faits saillants.
Cet influent organisme américain a rendu public hier un rapport dévastateur sur l’impact des différentes techniques de pêche dans le monde. Et de nombreux pays, dont le Canada, sont montrés du doigt pour leur laxisme en matière de pêche durable.
Au Canada, les baleines et marsouins communs meurent parce que les pêcheries de la côte Est, et plus particulièrement celles qui produisent du crabe et du homard, n’utilisent pas les mêmes techniques de pêche que celles exigées aux États-Unis.
Source : La Presse par Éric-Pierre Champagne
Une réglementation vieille de 40 ans
Adopté en 1972 par le Congrès américain, le Marine Mammal Protection Act interdit la prise de mammifères marins et l’importation de tout produit de mammifère marin aux États-Unis. En théorie, cette loi devrait protéger plusieurs espèces trop souvent capturées au cours d’une activité de pêche commerciale. Mais ces prises, dites accessoires ou accidentelles, sont monnaie courante partout dans le monde. Or, les Américains importent 91 % des fruits de mer et poissons qu’ils consomment. Le rapport du NRDC cible les pratiques de pêche de plusieurs pays, dont le Canada, la Chine, le Japon et la Nouvelle-Zélande.
Populaires, les produits de la mer
Poissons et fruits de mer sont de plus en plus populaires au sud de la frontière. Pour faire face à cette demande grandissante, les États-Unis doivent se tourner vers les marchés extérieurs. En 2012, on y a importé quelque 31 milliards en produits de la mer. Parmi les plus populaires, la crevette, avec des importations totalisant 4,46 milliards US, dont le tiers en provenance de la Thaïlande. De son côté, le Canada fournit du crabe et du homard à l’Oncle Sam. Le Chili, la Thaïlande et la Chine l’approvisionnent également en saumon, thon et tilapia.
Des victimes « collatérales »
Plusieurs techniques de pêche font des victimes « collatérales ». Le NRDC estime que plus de 650 000 mammifères marins sont tués ou sérieusement blessés chaque année au cours des activités de pêche hors des eaux américaines. « Pendant 40 ans, le gouvernement américain a échoué à donner plus de mordant à une loi qui aurait pu sauver des milliers de baleines et de dauphins tués à cause des pratiques de pêche négligentes des autres pays », affirme Zak Smith, avocat au NRDC et coauteur du rapport.
La baleine franche de l’Atlantique Nord
Parmi les principaux mammifères marins menacés par la pêche commerciale se trouve la baleine franche de l’Atlantique Nord. L’espèce est considérée comme en voie de disparition. Selon les derniers estimés, il ne restait que 509 baleines franches en 2011. La pêche au homard et au crabe des neiges est particulièrement dangereuse pour les baleines au printemps et à l’automne. Selon le NRDC, il n’existe pas de réglementation sur les « prises accidentelles » pour ces deux industries au Canada. La pêche au crabe serait responsable de 60 % des cas de baleines blessées par la pêche commerciale entre 1979 et 1998.
Le dauphin à long bec
Le problème n’est pas nouveau. La surpêche du thon n’est pas sans conséquence pour l’espèce, mais elle fait aussi depuis des années une victime collatérale : le dauphin à long bec. Dans l’océan Indien, jusqu’à tout récemment, l’industrie de la pêche sri-lankaise tuait ou blessait 15 000 dauphins par année. Par ailleurs, une réglementation plus sévère dans l’océan Pacifique a permis de réduire considérablement les prises accidentelles, mais les scientifiques s’inquiètent de voir la population de dauphins stagner malgré ces nouvelles mesures. Pour expliquer cet état de fait, le NRDC émet entre autres l’hypothèse que la réglementation n’est pas respectée par toute l’industrie.
Une loi plus sévère
Aux États-Unis, la loi sur la protection des mammifères marins a connu un certain succès, puisqu’elle a permis de réduire de 30 % les prises accidentelles en eaux américaines. Le Natural Resources Defense Council invite maintenant le gouvernement américain à revoir sa loi pour la rendre encore plus contraignante, notamment en ce qui a trait aux importations de produits de la mer. Le NRDC croit que l’importance du marché américain pour les pêcheurs étrangers pourrait les amener à revoir leurs pratiques en mer. Les consommateurs américains sont aussi invités à acheter seulement des produits qui respectent les standards gouvernementaux.
Pour consulter le rapport du NRDC :Net Loss: The Killing of Marine Mammals in Foreign Fisheries et résumé
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 14 Août 2014
Thonier-senneur. Les tortues marines passent entre les mailles des filets géants
Thonier-senneur "Glénan" en action de pêche sur Youtube
La pêche à la senne se déroule à bord de thoniers-senneurs, des navires puissants pouvant atteindre plus de 100 mètres de longueur, utilisant des filets (les "sennes") de plus de 1,5 km de long et ciblant les thons tropicaux. Afin d’optimiser les captures, cette pêche industrielle au thon utilise notamment des dispositifs de concentration de poisson (DCP), des systèmes flottants au milieu de l’océan servant à attirer les grands poissons pélagiques et particulièrement les thons tropicaux. Ces méthodes sont souvent accusées de générer des captures accidentelles importantes.
Les tortues marines passent entre les mailles des filets
Bonne nouvelle ! Dans une étude parue le 12 aout 2014 dans la revue scientifique "Biological Conservation", publiée par Elsevier Science, un groupe de chercheurs de l’Ifremer, de l’IRD, de l’IEO et de l’AZTI ont pu affirmer que "l’impact de la pêche à la senne était très faible sur les captures des six espèces de tortues marines présentes dans les océans indien atlantique".
Souvent pointés du doigt au sujet de pêches accidentelles massives et catastrophiques, ces grands navires, les thoniers-senneurs, et leurs filets d'1,5 km de long, ne peuvent finalement pas être accusés de balayer les tortues marines sur leur passage en cherchant à pêcher les thons tropicaux.
Les scientifiques ont ainsi analysé 15 913 données collectées entre 1995 et 2011 par des observateurs embarqués à bord des thoniers-senneurs européens. Pour l’océan Atlantique et l’océan Indien, cela représente respectivement 10,3% et 5,1% de la totalité de cette activité de pêche réalisée pendant cette période. En parallèle, de 2003 à 2011, 14 124 observations liées aux dispositifs de concentration de poisson (DCP) ont été réalisées pour vérifier si les tortues étaient prises dans les filets des DCP.
Le résultat de l’étude n’est pas une surprise pour les chercheurs : "Globalement, l’impact de la pêche à la senne est très faible sur les captures des six espèces de tortues marines présentes dans ces océans. Seulement un petit nombre de tortues restent coincées dans les filets" explique Jérôme Bourjea, premier auteur de la publication. "En plus, 75% des tortues pêchées accidentellement ont été relâchées vivantes".
Bien sûr, les DCP restent un problème car ils "attirent des jeunes tortues marines qui peuvent se retrouver prises dans les filets utilisés pour fabriquer ces DCP. Mais dans l’ensemble, cela joue un faible rôle dans les captures accidentelles", toujours selon l'auteur. Cependant, depuis 2013, "la construction de ces DCP a été modifié par la flottille européenne pour limiter le nombre de tortues emmêlées dans les filets et les premiers retours semblent très positifs".
D'après les articles d'Ifremer : Quels sont les impacts de la pêche thonière à la senne sur les tortues ? et de zinfos974 : Pêche à la senne: Les tortues marines passent entre les mailles des filets
Pour plus d'informations sur les programmes auxquels la délégation Ifremer Océan Indien participe :
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 4 Février 2014
Les engins de pêche vont apparaître sur les étiquettes
 À partir du 13 décembre 2014, l’étiquette des produits de la pêche devra indiquer l’engin – chalut, senne ou filet, etc. – avec lequel le poisson a été capturé. Pas sûr que cette information supplémentaire guide les consommateurs vers des produits durables.
À partir du 13 décembre 2014, l’étiquette des produits de la pêche devra indiquer l’engin – chalut, senne ou filet, etc. – avec lequel le poisson a été capturé. Pas sûr que cette information supplémentaire guide les consommateurs vers des produits durables.Source : UFC Que Choisir par Florence Humbert
Adoptée le 10 décembre 2013, la réforme de la Politique commune de la pêche (PCP) prévoyait notamment d’améliorer l’étiquetage des produits de la mer. Il s’agissait de fournir aux consommateurs des « informations claires et complètes, notamment sur l’origine des produits ainsi que sur leurs méthodes de production », afin qu’ils « puissent faire des choix en connaissance de cause ». Il faut dire que la traçabilité des produits de la mer laisse vraiment à désirer, surtout si on la compare aux autres denrées alimentaires, les viandes en particulier, dont l’indication de l’origine va devenir obligatoire.
Conformément aux souhaits de la PCP, de nouvelles normes d’étiquetage (règlement UE no 1379/2013), applicables à compter du 13 décembre 2014, ont donc été édictées par l’Organisation commune de marché (OCM) dans le secteur des produits de la mer. Mais force est de constater qu’une fois de plus la montagne a accouché d’une souris. Car les nouvelles dispositions s’appuient sur les mentions obligatoires existantes (1). Malgré leur imprécision, les « zones de capture » définies par la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, vont donc continuer à s’afficher sur les étiquettes. Par exemple, la fameuse « zone Atlantique Nord-Est », « zone 27 » que l’on retrouve sur la plupart des poissons vendus sur les étals français. Avec cette indication, le consommateur n’est pourtant pas plus avancé, car la zone couvre grosso modo une portion de mer partant du Groenland au nord de la Russie pour s’étendre jusqu’au sud de l’Espagne, Islande incluse ! Les langoustines, par exemple, qu’elles soient pêchées dans les eaux écossaises, irlandaises, norvégiennes ou françaises, seront donc toujours étiquetées A.N.E. ! Certes, rien n’empêche les metteurs en marché d’indiquer une zone plus précise, mais cette démarche reste volontaire.
En fait, la principale nouveauté du règlement vient de l’obligation de mentionner sur l’étiquetage le type d’engin de pêche utilisé pour la capture des produits des poissons, céphalopodes, coquillages et crustacés. Le matériel utilisé par les pêcheurs est regroupé en 7 grandes catégories : sennes, chaluts, filets maillants et filets similaires, filets tournants et filets soulevés, lignes et hameçons, dragues et casiers (et pièges).
Réalité complexe
Bien sûr, cette mesure était réclamée à cor et à cri par les organisations environnementalistes qui souhaitent ainsi pointer du doigt les engins qu’ils jugent destructeurs pour les fonds marins. À commencer par le chalut de fond. Même si le Parlement européen a finalement rejeté le 10 décembre 2013 l’interdiction du chalutage en eaux profondes (tout en prônant une règlementation accrue) ses opposants ne s’avouent pas vaincus pour autant. « L’étiquetage des engins de pêche va dans le bon sens. Cette mention va amener les consommateurs à se poser des questions », affirme Hélène Bourges, chargée de campagne Océans chez Greenpeace France. Même si elle concède qu’on entre là dans un domaine très technique et que « bien peu de gens savent ce qu’est une senne coulissante, une palangre ou un filet tournant ». C’est pourtant là que le bât blesse. Car à simplifier outrageusement une réalité complexe, on risque de discriminer certains engins de pêche au profit d’autres qui ne valent pas forcément mieux.« Tout changement doit être progressif, réfléchi, et la réglementation adaptée. Même la pêche en plongée, sans engin, peut surexploiter des stocks de coquillages si trop de plongeurs la pratiquent », déclarait Pascal Larnaud, technologiste des pêches et responsable de la station Ifremer de Lorient dans une interview accordé à Ouest-France, le 27 janvier 2014. « La substitution du chalut par des engins passifs (type casiers, nasses, palangres...) pourrait être envisagée au cas par cas en tenant compte du fait que ces techniques ont souvent des rendements moindres et ne pourraient sans doute pas assurer le même niveau d'approvisionnement. De plus, il ne faut pas perdre de vue que beaucoup de ces engins nécessitent des appâts... qui sont souvent pêchés au chalut », poursuit Pascal Larnaud.
Par ailleurs, on peut s’étonner que les exigences en matière d’étiquetage des produits de la pêche ne s’appliquent pas de la même manière à ceux issus de de l’aquaculture dont les pratiques sont pourtant loin d’être vertueuses. Pour ne citer qu’un seul exemple, la crevetticulture dans les pays asiatiques, au Brésil et en Amérique centrale, a eu des conséquences désastreuses au plan social et environnemental. Y aurait-il, pour Bruxelles, deux poids deux mesures ? À moins que le « scandale » du chalutage profond monté en épingle par les ONG environnementalistes ne serve à masquer l’irrésistible essor d’un secteur aquacole de plus en plus concentré.
(1) Sur l’étiquetage des produits de la mer figurent actuellement la dénomination commerciale du produit, la mention « pêché » ou « élevé », la zone de capture FAO des produits sauvages ou le pays d’élevage dans le cas de produits aquacoles, et la mention « décongelé » s’il y a lieu. À compter du 13 décembre 2014, le poissonnier sera dans l’obligation d’afficher le nom scientifique (en latin) des poissons, coquillages, crustacés et autres céphalopodes ainsi que l’engin de capture pour les produits sauvages. À titre facultatif, l’étiquette peut aussi indiquer la date de pêche ou de récolte, la date de débarquement, le port de débarque, le pavillon national du navire de pêche ainsi que des données environnementales, d’ordre éthique ou social.
----------------------------------------
Projet de loi relatif à la consommation
Le présent projet de loi, déposé par le Gouvernement, a pour objet la mise en place de « nouveaux outils de régulation économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels ».
Source : Sénat
Il comporte six chapitres.
Le chapitre Ier (articles 1 et 2) introduit dans le droit français une procédure d'action de groupe.
Le chapitre II (articles 3 à 17) vise à « améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs ». L'article 3 introduit ainsi dans le code de la consommation la définition de la notion de « consommateur » : est considérée comme consommateur : « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. ». Ce chapitre contient également des dispositions relatives au démarchage et à la vente à distance (article 5) ; à certains contrats spécifiques conclus dans les salons et foires (articles 11 et 12).
Le chapitre III (articles 18 à 22) est relatif au crédit et à l'assurance. Ainsi, l'article 20 tend à renforcer les consommateurs contre le risque de multi-assurance et l'article 21 aménage le droit de résiliation pour ce type de contrat.
Le chapitre IV (articles 23 et 24) concerne les indications géographiques : une nouvelle procédure qui permettra aux produits français d'obtenir une protection sur le territoire national et de valoriser les productions industrielles et artisanales locales, comme cela existe déjà pour les produits alimentaires.
Le chapitre V (articles 25 à 67) a pour objet de moderniser les moyens de contrôle et les pouvoirs de sanction de l'autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) et de ses agents.
Enfin, le chapitre VI (articles 68 à 73) intitulé « dispositions diverses » comprend notamment des dispositions relatives aux exploitants de voitures de tourisme avec chauffeurs et de véhicules motorisés à deux ou trois roues (articles 68 et 69) et le renouvellement de l'habilitation du gouvernement pour procéder, par voie d'ordonnance, à la refonte du code de la consommation, à l'harmonisation finale des pouvoirs d'enquête des agents de la CCRF ainsi que des dispositions nécessaires pour l'outre-mer (article 73).
Cliquer Ici pour téléharger le Texte n° 71 (2013-2014) modifié par le Sénat le 29 janvier 2014
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Les instances européennes confirment l'extension des autorisations de capture au chalut électrique pour les bateaux hollandais.
Source : Ouest France le 30 mars 2014
Vive polémique autour de la pêche au chalut électrique
Le 14 Mars 2014
Dans le marin du 14 mars 2014, Les pêcheurs du Nord s’opposent à la pêche électrique des Néerlandais
Président du comité régional des pêches Nord - Pas-de-Calais - Picardie, Olivier Leprêtre, s’insurge, photo à l’appui, contre cette pêche qui fait éclater le dos des limandes...
Les Pays-Bas veulent doubler le nombre de leurs navires pratiquant la pêche au chalut électrique au sud de la mer du Nord. Les pêcheurs français et belges s’y opposent.
La pêche électrique consiste à faire passer un courant dans un câble, en avant de l’engin de pêche (un chalut à perches). Les muscles des poissons se contractant, soles et autres poissons plats remontent vers la surface et se font alors happer.
Malgré les témoignages des pêcheurs français, qui observent des animaux abîmés, les Néerlandais, très forts en communication, ont mis en avant le développement durable auprès de la Commission. Avec succès puisque, alors que la législation européenne leur permettait d'équiper 5 % des chalutiers à perches, ils viennent d'obtenir une dérogation « sur base scientifique » qui leur en accorde jusqu'à 10 %. Soit 84 bateaux au lieu de 42.
La France n’y est pas favorable, pas plus que la Belgique. Le ministère de la Pêche, Frédéric Cuvillier, a écrit aux services de Maria Damanaki, le lundi 10 mars, pour demander sur quelle base juridique s’appuie cette dérogation additionnelle à fins scientifiques évoquée par la presse néerlandaise. Sans réponse à ce jour. Source : Le Marin
Chalut électrique : « Informer le consommateur »
Les instances européennes confirment l'extension des autorisations de capture au chalut électrique pour les bateaux hollandais.
Source : Ouest France le 30 mars 2014
Vive polémique autour de la pêche au chalut électrique
La DG Mare (direction de la pêche européenne) confirme le doublement de la flottille néerlandaise (87 contre 42) autorisée à utiliser le chalut à impulsion électrique en mer du Nord pour capturer les soles. « Le nouveau règlement de la politique commune de la pêche permet aux États membres - sans qu'ils aient besoin d'un accord de la part de la Commission européenne - de conduire des « projets pilotes » sur la base d'un avis scientifique et tenant compte de l'avis des CCR (Comités consultatifs régionaux), dans le but de préparer l'obligation de débarquement », indique l'instance bruxelloise.
Problème, selon Olivier Leprêtre, président du comité des pêches Nord-Pas-de-Calais-Picardie, le CCR mer du Nord n'a jamais rendu d'avis officiel sur cette question. Qui plus est, le règlement de 1998, pour protéger les juvéniles, interdit l'utilisation d'explosifs, de poison, de substances soporifiques ou de courant électrique. « Ce projet pilote européen dure depuis 2006. Il ne fait l'objet d'aucun rapport d'étape. Des poissons remontés dans les chaluts montrent des brûlures, des ecchymoses et des déformations du squelette consécutives à l'électrocution, relève l'association Robin des Bois. « Les dommages sur les coquillages, les crustacés, le plancton et les espèces de poissons non ciblées sont inconnus. »
Les soles électrocutées peuvent être commercialisées en France, selon les écologistes, qui estiment qu'« une clarification envers les consommateurs s'impose ».
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La pêche électrique, une technique illégale en France mais utilisée par les Hollandais
TF1 - 3min 27s - dimanche 13 avril à 20h35
Enquête. Les pêcheurs du nord de la France sont en colère après les professionnels hollandais. Ces derniers munissent leur bateau d'un courant électrique pour paralyser les poissons. Une technique qui n'est pas autorisée en France et en Belgique. Alors lorsque les Français pêchent dans les mêmes eaux, ils se disent défavorisés, et parlent de concurrence déloyale.
Source vidéo : La pêche électrique, une technique illégale en France mais utilisée par les Hollandais
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 26 Avril 2014
Il y a merlu de ligne et merlu de ligne
 Le merlu de ligne des pêcheurs artisans basques et le merlu de ligne MSC capturé par l’armement industriel galicien « Grupo Regal »
Le merlu de ligne des pêcheurs artisans basques et le merlu de ligne MSC capturé par l’armement industriel galicien « Grupo Regal »Quelques milliers de kilogrammes contre quelques milliers de tonnes...
3e édition de la fête du Merlu d'avril
Port de pêche de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
26 et 27 avril 2014
Merlu d'avril de la ligne à l'assiette
La Fête du « Merlu » aura lieu cette année des deux côtés du port de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure le 26 et 27 avril 2014.
Pendant ces deux journées, le merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz sera mis à l’honneur.
À découvrir tout au long du week-end : démonstrations culinaires par de grands chefs locaux, cours de cuisine gratuits non stop et dégustations gratuites de merlu de ligne…
Des cours de cuisine gratuits, non stop donnés par deux chefs locaux : Scott Serrato et Christophe Leborgne auront lieu au port de Ciboure, à côté de la criée. Découvrez les recettes autour du merlu qui seront réalisées tout au long de ces deux jour, en cliquant ici
Samedi 26 avril, à 10 heures : visite guidée. À 10 h 30, 17 heures et 18 heures : démonstrations de chefs cuisiniers. De 19 heures à 20 heures : dégustations avec Uhaina.
Dimanche 27 avril, à 10 heures : concours de cuisine. À 10 h 30, 16 heures et 17 heures : démonstrations de chefs. Demain et dimanche, de 11 heures à 13 heures : dégustations.
Au port de Ciboure : samedi et dimanche, à 11 heures, visites en bateau. De 10 h 30 à 18 h 30 (17 h 30 dimanche) : cours de cuisine par deux chefs cuisiniers. À 15 heures : conférences à la Grillerie et à la mairie de Saint-Jean-de-Luz.
Cliquez Ici pour en savoir plus sur le programme de la fête
Pour plus d'informations sur le Merlu de ligne de Saint Jean de Luz : La fraicheur sur toute la ligne
La pêcherie galicienne de Grupo Regal
![]() devient la première pêcherie européenne de merlu à obtenir la certification MSC
devient la première pêcherie européenne de merlu à obtenir la certification MSC
Le Marine Stewardship Council (MSC) a annoncé le 3 avril que la pêcherie à la ligne de merlu (Merluccius merluccius) de l’entreprise Grupo Regal a été certifiée suite à une évaluation indépendante menée selon le Référentiel MSC pour des pêcheries durables et bien gérées. À partir de maintenant, le merlu capturé par cette pêcherie à la palangre peut afficher le label bleu du MSC, permettant aux consommateurs de profiter de leur poisson préféré tout en ayant la garantie qu'il a été pêché en respectant l'environnement.
La certification de Grupo Regal : pionnière pour le merlu de ligne frais en Espagne et ouverte à d'autres entreprises
L’avis de Grupo Regal
Une espèce qui contribuera à transformer le marché espagnol vers un modèle durable
MSC, un référentiel environnemental rigoureux et internationalement reconnu
Contact médias
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sur la douzaine de DCP dénombrés autour de la Martinique (il y en a eu entre douze et quinze dans les années les plus fastes), beaucoup ont souffert après les derniers courants qui soufflent plus que d'habitude sur l'île.
Source : France Antilles par Christian Tinaugus
Le comité des pêches cherche à renouveler le parc de Dispositifs de concentration de poissons. 45 DCP attendent d'être financés.
Pas de pêche sans Dispositifs de concentration de poissons (DCP) à la Martinique. 80% de la production locale est réalisée grâce à ce matériel flottant construit en plusieurs points de l'île pour attirer la faune pélagique (thons, daurades, marlins, thazard...), ce qui prouve bien que ce système est de plus en plus utilisé par une majorité de professionnels. Devenus un peu vieillots avec le temps et incapables désormais de résister aux assauts des océans, beaucoup méritent d'être remplacés. Les responsables de la pêche locale ont, dans cette optique, monté un dossier auprès de la Région pour obtenir une subvention pour le renouvellement du parc. Si le Comité des pêches et élevages marins (CRPMEM) reçoit l'aide de la collectivité, il pourrait mettre en place un programme de réalisation de 45 ouvrages sur les deux ans à venir. Une procédure qui restait « compliquée » à mettre en oeuvre via le Fonds européen pour la pêche (FEP), il n'existait pas de d'aide publique pour ce matériel, ce que permet aujourd'hui le Fond européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Le comité profite ainsi du fait que les collectivités peuvent aujourd'hui financer les projets de ceux qui en font la demande. Sur la douzaine de DCP dénombrés autour de la Martinique (il y en a eu entre douze et quinze dans les années les plus fastes), beaucoup ont souffert après les derniers courants qui soufflent plus que d'habitude sur l'île.
« Oui de principe »
L'existant est constitué d'outils réalisés à l'initiative d'associations de marins pêcheurs, exploités par l'ensemble de la profession en dépit de leur caractère privé, contrairement à ce qui se fait à la Guadeloupe, où des équipements ne seraient utilisés que par ceux qui les ont mis en place.
Une autre partie du matériel a été aussi installée par la Région il y a deux ans. Les conditions climatiques contraignent à les remplacer constamment, ce qui a incité les élus de la pêche à se tourner vers l'Hôtel de Région de Cluny. « La Région nous avait donné un oui de principe. Mais budgétairement, les choses sont difficiles. Il nous faut des financements pour pouvoir boucler ce dossier et mettre à l'eau les DCP. À cause des courants, nous avons une très mauvaise année de Miquelon et de DCP. Il faut tout faire pour renouveler le parc avant la fin de l'année » , envisage le président du Comité des pêches Olivier Marie-Reine. Sachant que la durée de vie d'un DCP n'est pas éternelle, les quarante-cinq DCP ne seront pas opérationnels simultanément. L'idée est d'en programmer une bonne quantité afin de ne pas reconstituer à chaque fois un dossier de demande financement.
Pose d'un DCP. Il y a deux ans, la mise à l'eau d'un système au large des Trois-Ilets avait créé un petit événement pour les pêcheurs. Depuis, Le manque de matériel est toujours d'actualité.
Les DCP, ça fonctionne!
Vous lâchez un objet dans l'eau et vous observerez aussitôt que les poissons se regroupent autour. Ce phénomène, les hommes l'ont mis à profit il y a plusieurs siècles en le mettant au service de la pêche et ça marche!
Des Dispositifs de concentration de poissons ont été ainsi développés pour des pêcheries artisanales, soit sous forme naturelle (algues, débris végétaux...), soit construits par l'homme. Les premiers auraient été implantés à Hawaï en 1981. À la Martinique, on trouve en grande majorité des DCP ancrés. Ils nécessitent un équipement adapté pour leur mise en place. Aujourd'hui, nos marins pêcheurs ramènent plus des trois-quarts de leur produit de pêche, thons, maquereaux..., grâce à ce procédé.
Les Martiniquais en sont de gros consommateurs. Les DCP ont aussi l'avantage d'une pratique de l'activité toute l'année alors que la pêche à Miquelon ne dure que de décembre à juin.
Une quinzaine d'années de développement ont permis de démontrer l'efficience des DCP ancrés, d'améliorer progressivement leur technologie et d'approfondir les connaissances sur les mécanismes d'agrégation des poissons pélagiques.
Si les modèles de DCP légers ont progressivement évolué vers une longévité accrue, et une meilleure résistance aux courants, ils ont démontré leurs limites en matière de résistance aux forts courants autour de la Martinique. Des inconvénients qui s'ajoutent à une maintenance rapprochée, difficile à organiser, d'où la perte prématurée d'un matériel important.
Davantage de thons dans nos assiettes
Les DCP constituent l'avenir de la pêche. Et pour cause, 33% du territoire marin sont interdits de pêche à cause du chlordécone. Dans le même temps, les professionnels doivent faire face à l'invasion du poisson lion dont on incite de plus en plus à consommer. Un contexte expliquant que l'on est aux petits soins pour ce matériel. Une réalité qui explique aussi que le pélagique prend le dessus sur le poisson benthique (les poissons évoluant par bancs). On aura de plus en plus de thons et de thazard dans nos assiettes.
Pêcheurs acteurs
La politique du CRPREM vise à impliquer davantage les professionnels dans la fabrication et la pose des DCP. Des marins pêcheurs maîtrisent l'action de déposer et sont capables de répondre à des appels d'offre dans ce domaine, dit-on au siège du comité.
Les dirigeants font tout pour que ce soit une compétence locale reconnue tant sur la pose, la fabrication, que l'entretien. « Les pêcheurs pourraient être candidats en se regroupant, imagine déjà Olivier Marie. On est en train de voir comment faire juridiquement » . L'implication ne s'arrête pas là. Ils ont leur mot à dire sur les distances et leurs positions dès lors qu'il s'agira de les mettre à l'eau.
Filet dérivant
La pêche aux volants et aux balaous en danger ?
EUROPE. Une proposition d'interdiction totale de la pêche au filet dérivant, venant de Bruxelles, pourrait menacer l'avenir des professionnels spécialisés dans cette activité.
Source : France Antilles par Christian Tinaugus
En Martinique, à l'instar des pratiquants de la pêche estuairienne dans l'Hexagone, ce sont les marins pêcheurs spécialisés dans la capture de poissons « volants » (pêche saisonnière) ou de « balaou » notamment sur les côtes caraïbe et atlantique, qui seraient les plus pénalisés, au total une cinquantaine de professionnels. Il s'agit d'une pêcherie « très salvatrice » pour cette catégorie des gens de la mer. D'où l'inquiétude des responsables du secteur, sûrs et convaincus des dégâts collatéraux que causerait la décision européenne si elle était appliquée.
Lors de la dernière commission DOM, son rejet avait été clairement exprimé. D'autant que lors de sa consultation publique entre mars et septembre 2013, la commission européenne avait annoncé son intention d'évaluer la nécessité de revoir le régime d'encadrement des pêcheries exploitées au moyen de petits filets maillants dérivant (inférieurs à 2,5km), de mesurer l'impact sur l'environnement et notamment sur les espèces protégées.
Emplois menacés
Les représentants de la profession estiment que d'autres solutions sont possibles. Ainsi, le principe de régionalisation de la gestion des pêcheries européennes acté dans le cadre de la nouvelle politique commune de la pêche doit être appliqué en procédant à une consultation formelle des comités régionaux de pêche et entre organismes autorisés afin de déterminer les enjeux liés à l'usage du filet dérivant dans la région et les mesures correctives les plus appropriées à chaque zone géographique.
Les parlementaires et l'ensemble des politiques martiniquais ont été interpellés sur le sujet par le Comité régional des pêches. Le dossier est actuellement dans les mains du Comité national des pêches.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Port de pêche de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
26 et 27 avril 2014
Merlu d'avril de la ligne à l'assiette
La Fête du « Merlu » aura lieu cette année des deux côtés du port de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure le 26 et 27 avril 2014.
Pendant ces deux journées, le merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz sera mis à l’honneur.
À découvrir tout au long du week-end : démonstrations culinaires par de grands chefs locaux, cours de cuisine gratuits non stop et dégustations gratuites de merlu de ligne…
Des cours de cuisine gratuits, non stop donnés par deux chefs locaux : Scott Serrato et Christophe Leborgne auront lieu au port de Ciboure, à côté de la criée. Découvrez les recettes autour du merlu qui seront réalisées tout au long de ces deux jour, en cliquant ici
Des festivités gratuites
Au port de Saint-Jean-de-Luz
Samedi 26 avril, à 10 heures : visite guidée. À 10 h 30, 17 heures et 18 heures : démonstrations de chefs cuisiniers. De 19 heures à 20 heures : dégustations avec Uhaina.
Dimanche 27 avril, à 10 heures : concours de cuisine. À 10 h 30, 16 heures et 17 heures : démonstrations de chefs. Demain et dimanche, de 11 heures à 13 heures : dégustations.
Au port de Ciboure : samedi et dimanche, à 11 heures, visites en bateau. De 10 h 30 à 18 h 30 (17 h 30 dimanche) : cours de cuisine par deux chefs cuisiniers. À 15 heures : conférences à la Grillerie et à la mairie de Saint-Jean-de-Luz.
Cliquez Ici pour en savoir plus sur le programme de la fête
Pour plus d'informations sur le Merlu de ligne de Saint Jean de Luz : La fraicheur sur toute la ligne
Merlu de Ligne de Saint-Jean-de-Luz
Henri Lapeyre
Pêche responsable et durable : la pêche au merlu à la ligne dans le pays Basque à St Jean de Luz
WWF France
La pêcherie galicienne de Grupo Regal
 devient la première pêcherie européenne de merlu à obtenir la certification MSC
devient la première pêcherie européenne de merlu à obtenir la certification MSC Le Marine Stewardship Council (MSC) a annoncé le 3 avril que la pêcherie à la ligne de merlu (Merluccius merluccius) de l’entreprise Grupo Regal a été certifiée suite à une évaluation indépendante menée selon le Référentiel MSC pour des pêcheries durables et bien gérées. À partir de maintenant, le merlu capturé par cette pêcherie à la palangre peut afficher le label bleu du MSC, permettant aux consommateurs de profiter de leur poisson préféré tout en ayant la garantie qu'il a été pêché en respectant l'environnement.
Source : MSC
La certification a été attribuée après une évaluation effectuée par Food Certification International, un organisme de certification accrédité et indépendant. L'évaluation (un processus participatif), a été menée selon le référentiel MSC, et a montré que le stock est en bonne santé, que la pêcherie est bien gérée et que l’impact sur l'écosystème marin est minimal.
La certification a été attribuée après une évaluation effectuée par Food Certification International, un organisme de certification accrédité et indépendant. L'évaluation (un processus participatif), a été menée selon le référentiel MSC, et a montré que le stock est en bonne santé, que la pêcherie est bien gérée et que l’impact sur l'écosystème marin est minimal.
La certification de Grupo Regal : pionnière pour le merlu de ligne frais en Espagne et ouverte à d'autres entreprises
La certification a été attribuée à des bateaux de pêche à la palangre exploités par Grupo Regal et par des entreprises associées. La certification est ouverte, ce qui signifie qu'elle peut être partagée avec d'autres palangriers espagnols pêchant le merlu de l'Atlantique nord-est, qui seraient donc également éligibles pour afficher le label bleu du MSC sur leurs captures.
Les captures de merlu à la ligne sont effectuées dans la région de la Grande Sole en Atlantique Nord-Est (zone de pêche FAO 27), dans les eaux européennes. L'unité de certification se compose de deux navires, dont les captures atteignaient 1800 tonnes en 2013. Le merlu est pêché à la palangre, une technique sélective qui a un impact minimal sur l'environnement et qui capture rarement les petits individus reproducteurs.
Grupo Regal a également intégré un code de conduite robuste, permettant de planifier une stratégie de captures qui vise à maintenir une activité de pêche durable et responsable. Le code de conduite comprend des protocoles pour réduire les captures d'oiseaux et les rejets, diminuer l'impact sur les écosystèmes marins vulnérables et les zones protégées et pour améliorer la gestion des déchets.
Grupo Regal est une entreprise familiale fondée en 1964. En 2010, elle a obtenu la certification MSC pour ses captures de légine. À l'heure actuelle, l'ensemble de la flotte de Grupo Regal est certifiée MSC.
L’avis de Grupo Regal
Juan Antonio Regal, le directeur de Grupo Regal, a déclaré: «Cette certification récompense notre engagement à fournir sur le marché du merlu de ligne espagnol frais, un produit naturel de qualité extraordinaire, tout en ayant l'assurance qu'il a été pêché de manière durable et dans le respect de l'environnement. Ainsi, nous contribuons à l'amélioration des ressources halieutiques pour cette génération de pêcheurs et les générations futures.»
Une espèce qui contribuera à transformer le marché espagnol vers un modèle durable
Laura Rodríguez, la responsable du MSC en Espagne et au Portugal, commente: « Le merlu est l'une des espèces les plus prisées en Espagne et dans toute l'Europe. Cette certification est une étape importante car elle permet d’offrir du merlu européen pêché à la ligne certifié MSC en poissonneries et sur les étals de poissons frais à travers toute l’Espagne. »
MSC, un référentiel environnemental rigoureux et internationalement reconnu
Le programme de certification pour la pêche sauvage MSC est reconnu internationalement et se base sur un référentiel scientifique solide et sur des évaluations tierce partie, effectuées par des organismes de certification accrédités. Pour cette pêcherie, l'évaluation a été menée par l’organisme de certification Food Certification International pendant plus de 18 mois. La pêcherie a été évaluée selon les trois principes fondamentaux du référentiel MSC : la santé du stock de poissons, l'impact de la pêche sur l'écosystème marin, et l’efficacité de la gestion de la pêcherie.
Contact médias
Pour plus d'informations, veuillez contacter Cátia Meira, responsable communication pour le MSC Espagne et Portugal, par mail : catia.meira@msc.org ou par téléphone +3637557646.
Le 22 août 2014 :
2 engins de pêche dans le collimateurs
Martinique : Les DCP veulent se refaire une santé
Sur la douzaine de DCP dénombrés autour de la Martinique (il y en a eu entre douze et quinze dans les années les plus fastes), beaucoup ont souffert après les derniers courants qui soufflent plus que d'habitude sur l'île.
Source : France Antilles par Christian Tinaugus
Le comité des pêches cherche à renouveler le parc de Dispositifs de concentration de poissons. 45 DCP attendent d'être financés.
Pas de pêche sans Dispositifs de concentration de poissons (DCP) à la Martinique. 80% de la production locale est réalisée grâce à ce matériel flottant construit en plusieurs points de l'île pour attirer la faune pélagique (thons, daurades, marlins, thazard...), ce qui prouve bien que ce système est de plus en plus utilisé par une majorité de professionnels. Devenus un peu vieillots avec le temps et incapables désormais de résister aux assauts des océans, beaucoup méritent d'être remplacés. Les responsables de la pêche locale ont, dans cette optique, monté un dossier auprès de la Région pour obtenir une subvention pour le renouvellement du parc. Si le Comité des pêches et élevages marins (CRPMEM) reçoit l'aide de la collectivité, il pourrait mettre en place un programme de réalisation de 45 ouvrages sur les deux ans à venir. Une procédure qui restait « compliquée » à mettre en oeuvre via le Fonds européen pour la pêche (FEP), il n'existait pas de d'aide publique pour ce matériel, ce que permet aujourd'hui le Fond européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Le comité profite ainsi du fait que les collectivités peuvent aujourd'hui financer les projets de ceux qui en font la demande. Sur la douzaine de DCP dénombrés autour de la Martinique (il y en a eu entre douze et quinze dans les années les plus fastes), beaucoup ont souffert après les derniers courants qui soufflent plus que d'habitude sur l'île.
« Oui de principe »
L'existant est constitué d'outils réalisés à l'initiative d'associations de marins pêcheurs, exploités par l'ensemble de la profession en dépit de leur caractère privé, contrairement à ce qui se fait à la Guadeloupe, où des équipements ne seraient utilisés que par ceux qui les ont mis en place.
Une autre partie du matériel a été aussi installée par la Région il y a deux ans. Les conditions climatiques contraignent à les remplacer constamment, ce qui a incité les élus de la pêche à se tourner vers l'Hôtel de Région de Cluny. « La Région nous avait donné un oui de principe. Mais budgétairement, les choses sont difficiles. Il nous faut des financements pour pouvoir boucler ce dossier et mettre à l'eau les DCP. À cause des courants, nous avons une très mauvaise année de Miquelon et de DCP. Il faut tout faire pour renouveler le parc avant la fin de l'année » , envisage le président du Comité des pêches Olivier Marie-Reine. Sachant que la durée de vie d'un DCP n'est pas éternelle, les quarante-cinq DCP ne seront pas opérationnels simultanément. L'idée est d'en programmer une bonne quantité afin de ne pas reconstituer à chaque fois un dossier de demande financement.
Pose d'un DCP. Il y a deux ans, la mise à l'eau d'un système au large des Trois-Ilets avait créé un petit événement pour les pêcheurs. Depuis, Le manque de matériel est toujours d'actualité.
Les DCP, ça fonctionne!
Vous lâchez un objet dans l'eau et vous observerez aussitôt que les poissons se regroupent autour. Ce phénomène, les hommes l'ont mis à profit il y a plusieurs siècles en le mettant au service de la pêche et ça marche!
Des Dispositifs de concentration de poissons ont été ainsi développés pour des pêcheries artisanales, soit sous forme naturelle (algues, débris végétaux...), soit construits par l'homme. Les premiers auraient été implantés à Hawaï en 1981. À la Martinique, on trouve en grande majorité des DCP ancrés. Ils nécessitent un équipement adapté pour leur mise en place. Aujourd'hui, nos marins pêcheurs ramènent plus des trois-quarts de leur produit de pêche, thons, maquereaux..., grâce à ce procédé.
Les Martiniquais en sont de gros consommateurs. Les DCP ont aussi l'avantage d'une pratique de l'activité toute l'année alors que la pêche à Miquelon ne dure que de décembre à juin.
Une quinzaine d'années de développement ont permis de démontrer l'efficience des DCP ancrés, d'améliorer progressivement leur technologie et d'approfondir les connaissances sur les mécanismes d'agrégation des poissons pélagiques.
Si les modèles de DCP légers ont progressivement évolué vers une longévité accrue, et une meilleure résistance aux courants, ils ont démontré leurs limites en matière de résistance aux forts courants autour de la Martinique. Des inconvénients qui s'ajoutent à une maintenance rapprochée, difficile à organiser, d'où la perte prématurée d'un matériel important.
Davantage de thons dans nos assiettes
Les DCP constituent l'avenir de la pêche. Et pour cause, 33% du territoire marin sont interdits de pêche à cause du chlordécone. Dans le même temps, les professionnels doivent faire face à l'invasion du poisson lion dont on incite de plus en plus à consommer. Un contexte expliquant que l'on est aux petits soins pour ce matériel. Une réalité qui explique aussi que le pélagique prend le dessus sur le poisson benthique (les poissons évoluant par bancs). On aura de plus en plus de thons et de thazard dans nos assiettes.
Pêcheurs acteurs
La politique du CRPREM vise à impliquer davantage les professionnels dans la fabrication et la pose des DCP. Des marins pêcheurs maîtrisent l'action de déposer et sont capables de répondre à des appels d'offre dans ce domaine, dit-on au siège du comité.
Les dirigeants font tout pour que ce soit une compétence locale reconnue tant sur la pose, la fabrication, que l'entretien. « Les pêcheurs pourraient être candidats en se regroupant, imagine déjà Olivier Marie. On est en train de voir comment faire juridiquement » . L'implication ne s'arrête pas là. Ils ont leur mot à dire sur les distances et leurs positions dès lors qu'il s'agira de les mettre à l'eau.
Filet dérivant
La pêche aux volants et aux balaous en danger ?
EUROPE. Une proposition d'interdiction totale de la pêche au filet dérivant, venant de Bruxelles, pourrait menacer l'avenir des professionnels spécialisés dans cette activité.
Source : France Antilles par Christian Tinaugus
À coup sûr, c'est une proposition émanant de la commission européenne qui risque de provoquer un sérieux raz de marée dans le monde marin. Bruxelles prône en effet une interdiction de la pêche au filet maillant dérivant. Le filet maillant dérivant, c'est un filet équipé de nappes de filets, reliées ensemble à des ralingues, maintenu à la surface ou en dessous par le biais de flotteurs, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Ces filets sont déjà interdits au-delà de 2,5 km de long depuis 1992 ; et quelle que soit leur taille pour la capture des grands migrateurs (thons, espadons) depuis 2002. Mais ce sont des abus (en Italie notamment, au thon rouge) conduisant à des captures accessoires de mammifères marins, tortues de mer et oiseaux marins qui ont motivé l'Europe à décider une interdiction totale dès 2015.
En Martinique, à l'instar des pratiquants de la pêche estuairienne dans l'Hexagone, ce sont les marins pêcheurs spécialisés dans la capture de poissons « volants » (pêche saisonnière) ou de « balaou » notamment sur les côtes caraïbe et atlantique, qui seraient les plus pénalisés, au total une cinquantaine de professionnels. Il s'agit d'une pêcherie « très salvatrice » pour cette catégorie des gens de la mer. D'où l'inquiétude des responsables du secteur, sûrs et convaincus des dégâts collatéraux que causerait la décision européenne si elle était appliquée.
Lors de la dernière commission DOM, son rejet avait été clairement exprimé. D'autant que lors de sa consultation publique entre mars et septembre 2013, la commission européenne avait annoncé son intention d'évaluer la nécessité de revoir le régime d'encadrement des pêcheries exploitées au moyen de petits filets maillants dérivant (inférieurs à 2,5km), de mesurer l'impact sur l'environnement et notamment sur les espèces protégées.
Emplois menacés
Chez les responsables de la pêche, on redoute la conséquence d'une telle mesure : un très lourd impact socio-économique risquant d'entraîner l'arrêt d'activité pour une cinquantaine de professionnels à très court terme et près de 100 à l'horizon 2020, affectant 150 emplois directs et 200 à 300 emplois indirects.
Les représentants de la profession estiment que d'autres solutions sont possibles. Ainsi, le principe de régionalisation de la gestion des pêcheries européennes acté dans le cadre de la nouvelle politique commune de la pêche doit être appliqué en procédant à une consultation formelle des comités régionaux de pêche et entre organismes autorisés afin de déterminer les enjeux liés à l'usage du filet dérivant dans la région et les mesures correctives les plus appropriées à chaque zone géographique.
Les parlementaires et l'ensemble des politiques martiniquais ont été interpellés sur le sujet par le Comité régional des pêches. Le dossier est actuellement dans les mains du Comité national des pêches.
C.T.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 26 Août 2014
A bord du caseyeur "Notre Dame de Kerizinen II"
Le Marin
Reportage vidéo : En 10 minutes extraites de 3 jours de mer... Mise à l’eau quotidienne (filage) et récupération (virage) des filières, la sortie des crabes des casiers, chargement de la boëtte, immersion dans le vivier pour la débarque des crabes…
Le + : Reportage photographique dans l'hebdomadaire "le marin" publié le 22 août 2014.
Embarquez avec le marin à la pêche au crabe au sud-ouest de l’île de Sein, à bord du caseyeur Notre Dame de Kerizinen II. L’équipage pêche le tourteau d’avril à décembre sur ce 24 mètres détenu en copropriété par le patron, Hervé Salaün, et le groupe Béganton.
Les sept marins veillent sérieusement à la ressource et à la qualité, par exemple en rejetant à l’eau aussitôt les crabes trop petits, trop mous (en pleine mue) ou grainés (portant des œufs). Ils espèrent que le label pêcheur responsable et le programme européen Acrunet aideront à reconnaître ces efforts et à tirer les prix vers le haut.
D'après le marin : Reportage Vidéo - Une marée au crabe en mer Celtique
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Une solution à 150 euros qui réduit de 99% la mort des albatros dans les filets des chalutiers
![]() Lignes de dissuasion de BirdLife South Africa
Lignes de dissuasion de BirdLife South Africa
Crédits : Albatross Task Force, BirdLife South Africa - Droits d'images de Bronwyn Maree
La technique consiste à fixer une corde de 30m de long à l'arrière du navire, à laquelle sont attachées de 5 à 10 banderoles de matériau coloré et léger, placées à 2m d'intervalle. En flottant sous le vent, les banderoles distraient et effraient les oiseaux, les maintenant éloignés des câbles mortels.
Pour en savoir plus, contacts :
Elle vient d'aider à la restauration du Pont de Saint-Cado dans le Morbihan. La Fondation Total soutient les travaux de restauration, le plus souvent avec une approche d'insertion sociale. Entretien avec Catherine Ferrant, déléguée générale de la fondation Total.
Source : Ouest France par Virginie Jamin.
La fondation Total va verser 90 000 € pour la restauration du pont de Saint-Cado. Quels éléments ont emporté votre décision ?
Quels autres projets avez-vous soutenu en Bretagne avec la Fondation du patrimoine ?
Le 10 Novembre 2014
Cohabiter veut dire d'abord parler ensemble
Le 14 Octobre 2014
Afrique du Sud
Une solution à 150 euros qui réduit de 99% la mort des albatros dans les filets des chalutiers
La pêche au chalut en haute mer a été identifiée comme une cause majeure de la mort des oiseaux de mers. Attirés par milliers par les déchets de poissons évacués des navires, ils sont pris au piège dans les câbles épais qui maintiennent les filets du chalutier en place, puis entraînés sous l'eau avant de couler. Chaque année, environ 9.000 oiseaux de mers - dont 75% d'albatros - seraient tués par les chalutiers sud-africains.
Source : BE Afrique du Sud
Source : BE Afrique du Sud
Une petite révolution écologique pourrait limiter drastiquement ce phénomène : selon une étude du groupe de conservation des oiseaux BirdLife South Africa, une innovation ultra-simple et économique permet de réduire de 95% la mortalité des oiseaux, et jusqu'à 99% chez la population d'albatros. Les résultats, basés sur des données collectées depuis 5 ans par le groupe de conservation et les entreprises de la pêche, ont été publiés en mai dernier dans la revue internationale Animal Conservation.
 Lignes de dissuasion de BirdLife South Africa
Lignes de dissuasion de BirdLife South Africa Crédits : Albatross Task Force, BirdLife South Africa - Droits d'images de Bronwyn Maree
La technique consiste à fixer une corde de 30m de long à l'arrière du navire, à laquelle sont attachées de 5 à 10 banderoles de matériau coloré et léger, placées à 2m d'intervalle. En flottant sous le vent, les banderoles distraient et effraient les oiseaux, les maintenant éloignés des câbles mortels.
Recommandées par BirdLife dès 2004, ces "lignes de dissuasion", conçues à travers un projet collaboratif impliquant l'OVAPD (Ocean View Association for Persons with Disabilities), ont été largement adoptées par la communauté des industriels de la pêche. Bénéficiant du soutien financier de Total South Africa, elles leurs sont vendues à moins de 150 euros, un prix dérisoire au vu de leur impact spectaculaire sur la préservation de la faune avicole.
Cette success story dans le domaine de la conservation de la biodiversité est un exemple de collaboration réussie entre industrie, gouvernement et ONG. L'innovation pourrait sauver une espèce subissant une pression anthropique extrême, 15 des 22 espèces mondiales d'albatros étant actuellement menacées d'extinction.
Pour en savoir plus, contacts :
- Bulletin électronique : BE Afrique du Sud
- Site web de l'Albatross Task Force
Bretagne
Fondation Total. Neuf projets soutenus en Bretagne depuis 2006
Elle vient d'aider à la restauration du Pont de Saint-Cado dans le Morbihan. La Fondation Total soutient les travaux de restauration, le plus souvent avec une approche d'insertion sociale. Entretien avec Catherine Ferrant, déléguée générale de la fondation Total.
Source : Ouest France par Virginie Jamin.
La fondation Total va verser 90 000 € pour la restauration du pont de Saint-Cado. Quels éléments ont emporté votre décision ?
Outre le cachet architectural de ce pont qui participe pleinement à l'identité de ce village et à son attrait touristique, nous avons beaucoup apprécié la mobilisation de la population locale et toute l'énergie mise en oeuvre pour financer sa restauration. Cela nous a rendu le projet d'autant plus sympathique.
Quels autres projets avez-vous soutenu en Bretagne avec la Fondation du patrimoine ?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 10 Novembre 2014
Cohabiter veut dire d'abord parler ensemble
La Commission cohabitation du Comité des Pêches Maritimes du Finistère s'est réunie le 6 novembre 2014 à la CCI de Morlaix en présence d'une quinzaine de personnes.
Illustration : copie d'écran de Avel Nevez Film
Illustration : copie d'écran de Avel Nevez Film
Le film « Pêcher ensemble tout un art » produit par l’association Avel Nevez Film a permis de montrer aux pêcheurs que leurs accords intéressaient un public plus large que la Commission cohabitation. La reconnaissance publique de ces accords permet d’entamer la procédure de leur solidification. Elle sera poursuivie par une présentation au Comité Régional des Pêches et des Elevages Marins de Bretagne, au niveau ministériel et européen au travers des Comités Consultatifs Nord-Ouest et Sud-Ouest. Il serait très utile de le sous-titrer en anglais pour une bonne compréhension à ce dernier niveau.
Source : Cdpm 29
Source : Cdpm 29
Le film "Pêcher ensemble : tout un art" n'a suscité aucune critique, au contraire il faut le sous-titrer en anglais
La cohabitation en 2014 (jusqu’à présent) s’est bien déroulée. Il n’y a pas eu un seul incident majeur. C’est le cas du côté Ouest où il n’y a pas eu cette année l’arrivée massive de 15 perchistes en une nuit. Gaël Abjean a remercié nommément l’Armement Porcher qui a mis un second à la passerelle la nuit. Depuis, les problèmes ont disparu. Le seul incident signalé concerne la cohabitation entre deux engins dormants filets et casiers au niveau de la petite fosse. La demande des fileyeurs de pouvoir commencer à caler leurs filets dès le coefficient de 78 a été mise en délibéré entre Gaël Abjean et Patrick Loncle. Quand ils se seront mis d’accord les cartes A et B 2015 seront expédiées par la poste, ceci avant le 15 décembre prochain. Le ramassage des filets reste inchangé et doit être terminé avant le coefficient de 75.
En ce qui concerne l’installation des pingers, 10 navires de la flottille des fileyeurs hauturiers en sont pourvus. Jusqu’à présent aucun navire n’a été contrôlé par la Royal Navy. C’est à croire qu’ils les détectent autrement que visuellement…
Le point d’information sur les rejets a été fait par Thomas Timaud de l’AGLIA (association qui regroupe les régions Aquitaine, Poitou Charente, Pays de Loire et Bretagne). Beaucoup d’informations sont disponibles en Manche Est, en Mer Celtique ou dans le Golfe de Gascogne, très peu dans la zone Manche Ouest (7e). Les informations du plan rejet filet du Golfe de Gascogne pourront être retransmises aux fileyeurs de Manche Ouest. Le souci est d’être aussi sélectif que possible, d’éviter de faire des co-produits à bas coûts, de valoriser les quotas au maximum et d’éviter l'installation des caméras à bord.
L’Ifremer, représenté par Martial Laurans, a fait un compte rendu pédagogique de la Campagne Manche Occidentale (Camanoc), menée par son institut. Les pêcheurs ont pu constater la montée progressive au Nord et à l’Est des "sangliers" (petits poissons rouges dont la forme rappelle celle des cochons sauvages), ce qui prouve un changement profond de la nature des masses d’eau. De même le développement des bryozoaires à une vingtaine de milles de la côte Nord-Ouest de la Bretagne et Sud-Ouest de la Cornouaille anglaise pose un problème aux pêcheurs qui ne pêchent aucun poisson à proximité. Les premiers renseignements datent de 4 ans, ce qui était considéré au début comme une rencontre fortuite devient monnaie courante et constitue un autre signe de modification du milieu.
L’impact des échanges de KW/Js, que ce soit pour les coquilles Saint-Jacques ou les tourteaux, devient potentiellement important. La tendance est de vider le trop plein d’effort de pêche de la zone Manche Est (7d) dans la Manche Ouest (7e). Pour la Commission locale ces échanges ne peuvent se faire que si le CDPMEM29 est dans la boucle. La proposition de délibération mise au point par la Commission gros crustacés, d’interdire toute pêche de langouste du 1ier janvier au 31 mai d’une même année, a été rediscutée longuement. Il est apparu qu’il n’était pas forcément utile d’appliquer cette décision au-delà du 6° Ouest. Cela reste à confirmer par la commission gros crustacés et le bureau du Comité National des Pêches maritimes et des Elevages Marins.
Discussions nourries sur une multitude de sujets au cours de cette Commission cohabitation.
La réunion a été conclue à 17 heures 30 par Gaêl Abjean, le président de la Commission cohabitation, qui apportera au CDPMEM29 les éléments nécessaires pour établir les prochaines cartes de cohabitation 2015.
La conserve de thon subit depuis quelques semaines une campagne médiatique de Greenpeace, visant particulièrement la marque Petit Navire, qui fustige l’usage des dispositifs de concentration de poisson (DCP) par les senneurs.
Pour plus d'explications dans le marin
Ce qui ne vous empêche pas de participer au Grand Jeu Thon Pêché à la Ligne sur la page facebook de Saupiquet
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 1 décembre 2014
La conserve de thon pêché à la ligne fait des remous chez Saupiquet
La mise en avant du côté «respectueux des ressources marines» du thon à la ligne fait débat...
La conserve de thon subit depuis quelques semaines une campagne médiatique de Greenpeace, visant particulièrement la marque Petit Navire, qui fustige l’usage des dispositifs de concentration de poisson (DCP) par les senneurs.
Pour plus d'explications dans le marin
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^