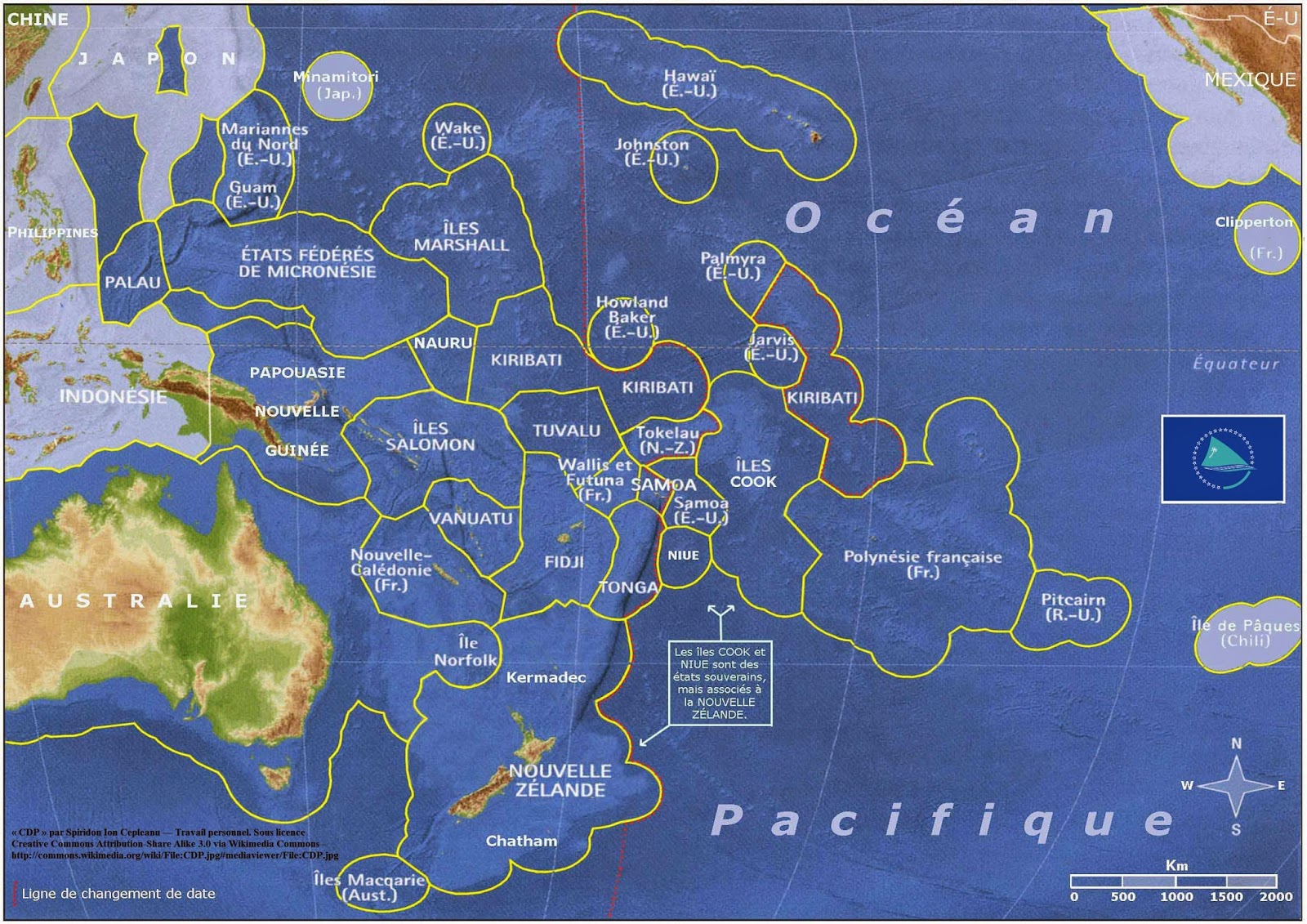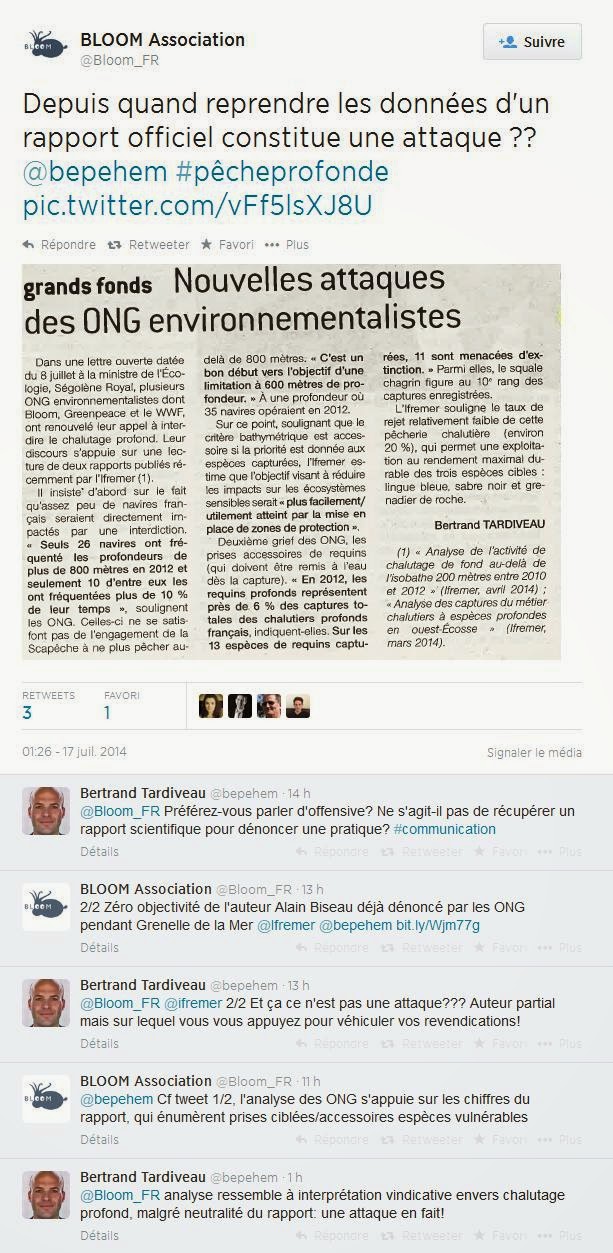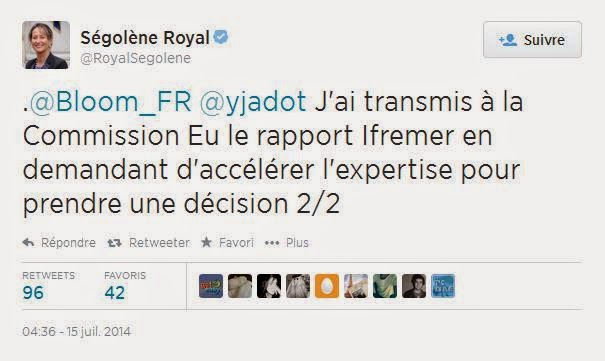----------------------------------
1 octobre 2014 : Ouverture de la coquille saint-jacques (saison 2014/2015)Google Alertes : Coquilles Saint-Jacques à la normandeCopie d'écranComité national des pêchesOuverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques
Ce mercredi 1er octobre marque le jour de l’ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques pour les pêcheurs français. Guettez-les sur les étals, elles feront votre régal !
Bon à savoir :
- Le nom scientifique de la coquille Saint-Jacques est : Pecten maximus. On trouve d’autres espèces voisines sur le marché, ce sont des pectinidés, souvent commercialisés sous le nom de pétoncle.
- La coquille Saint-Jacques est une espèce sédentaire, qui vit en banc. Les principaux gisements en France sont : Baie de Seine, Baie de Saint-Brieuc, Rade de Brest, Quiberon, Pertuis charentais.
- Les pêcheurs français respectent une fermeture de la pêche chaque année, du 15 mai au 30 septembre, afin de laisser le temps aux coquilles de grandir et de se reproduire.
- Une licence professionnelle a été créée, à la demande des pêcheurs, pour limiter l’accès à la pêcherie. Cette licence a dans certains cas valeur d’AEP (autorisation européenne de pêche).
Source :
CNPMEM
Au moment où Pavillon France lance l'opération " 3. 2. 1. Poissons ! ", "Viandes de France" fait le point...
Après le scandale des viandes : les choses ont-elles vraiment changé ?
Plus d'un an et demi après le scandale de la fraude à la viande de cheval, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles dénonce des mesures et des dispositifs inefficaces
Source :
SudOuest.fr, avec AFP
Pour répondre à la crise qui avait durement touché la filière des viandes durant l'année 2013, plusieurs mesures avaient été prises pour permettre aux acheteurs de retrouver la confiance.
Mention "Viandes de France" : "les étiquettes ne sont pas imprimées"
L'étiquette "Viandes de France", qui devait informer et rassurer le consommateur et garantir l'origine de la viande, a fait long feu à peine six mois après son lancement, a dénoncé mercredi la FNSEA.
"La vérité c'est que les étiquettes ne sont même pas imprimées ! C'est un coup de com' sans effet", s'est insurgé devant la presse Patrick Bénézit, président de la fédération régionale des syndicats agricoles (FRSEA) du Massif Central.
"La démarche n'est pas entrée dans les faits", remarque-t-il en dénonçant un "jeu malsain", entretenu notamment par les opérateurs de la grande distribution qui se fournissent dans les pays voisins.
Les étiquettes "Viandes de France" n'ont pas eu l'efficacité escomptée, dénonce la FNSEA.
"Ce n'est pas que les voisins sont moins chers, mais c'est une façon de calibrer le marché intérieur à la baisse : si on achète moins en France, les prix vont baisser", explique encore le président de la FNSEA, lui même éleveur dans le Cantal et vice-président de la Fédération nationale bovine (FNB).
Cantines : 87% de volailles étrangères
L'autre cible dans le viseur des éleveurs, qui dénoncent un effondrement des cours "qui perdent 2 à 3 centimes du kilo par semaine", selon la FNB, c'est la restauration collective, cantines scolaires et des administrations publiques notamment.
"Il n'y a plus un morceau de viande française dans les cantines!", affirme le responsable qui renvoie les élus à leurs "responsabilités".
Selon Christiane Lambert, 1ere vice-présidente de la FNSEA, "87% des volailles servies dans les cantines sont étrangères et autour de 70% pour la viande rouge". Ces chiffres ont été établis par le syndicat des Jeunes agriculteurs au fil d'une enquête minutieuse, précise-t-elle. Le principal syndicat agricole français entend d'ailleurs conduire des "enquêtes" dans les cuisines de la restauration collective et publier ses résultats.
"On va enquêter dans les cantines et remonter la chaîne: que les parents qui subissent des licenciements dans les entreprises agroalimentaires, comme chez Doux, Tilly ou Gad, sachent ce que leurs enfants mangent à l'extérieur", a-t-elle prévenu. "Quand on s'enfonce dans la crise, le patriotisme alimentaire ça compte".
La FNSEA a annoncé sa volonté de conduire un "travail sur le terrain" jusqu'au 15 décembre, selon une méthodologie qui est en cours d'établissement et sera présentée au réseau le 15 octobre.
"Seuls 44% des viandes sont françaises chez McDo"
L'enquête n'épargnera personne, ni les cuisines de l'industrie agro-alimentaire prévient-elle.
"Nous avons fait des contrôles chez Fleury-Michon en Vendée et découvert du porc espagnol nourri aux OGM", a rapporté Mme Lambert. Elle a rappelé que l'Europe et les industriels de l'agroalimentaire avaient refusé l'étiquetage obligatoire de l'origine des viandes en faisant valoir des surcouts de "40% liés aux contrôles qu'ils devraient effectuer".
Malgré le refus de la commission européenne de rendre la mesure obligatoire, distributeurs et industriels s'étaient engagés à promouvoir sur une base volontaire les "viandes de France" nées, élevées et abattues en France, dans la foulée du scandale des raviolis au cheval et pour contrer la concurrence européenne.
"Certains le font, d'autres pas", constate Mme Lambert qui pointe également les enseignes de restauration rapide, comme MacDo ou KFC qui font leur publicité sur les viandes de terroir: "Chez MacDo les contrôles ont montré que seuls 44% de la viande des hamburgers est d'origine France". Quant à KFC elle n'a pas été en mesure de chiffrer avec certitude la part des poulets français.
"Mais l"Allemagne construit des poulaillers gigantesques de 30.000 poulets qui sont vendus 20 à 25% moins cher", a-t-elle noté.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques
Depuis ce mercredi 1er octobre, minuit, la pêche à la coquille Saint-Jacques est ouverte. A Dieppe, une quarantaine de bateaux a pris la mer. Tôt ce matin, certains étaient déjà revenus à leur port d’attache. L'occasion de faire un premier bilan : la coquille 2014 s'annonce belle, mais rare.
Le reportage, ce matin, à Dieppe, de Grégory Archiapati et Karima Saïdi (montage : Stéphanie Pierson)...
avec les interviews de :
Patrick Leroy, armateur du Jennivic
Arnaud Colsenet, matelot à bord du Paskisa
Depuis cette nuit, la pêche est ouverte dans une zone comprise entre Barfleur et le cap d'Antifer, au-delà des 20 milles (environ 37 km).
A partir du 3 novembre, une nouvelle zone sera autorisée, entre 12 et 20 milles des côtes, pour permettre aux plus petits bateaux de commencer à pêcher.
Enfin, la Baie de Seine, la zone la plus proche des côtes, ouvrira le 1er décembre.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Les premiers bâteaux partiront cet après-midi (mardi 30 septembre 2014 ndlr) pour être sur zone à minuit, heure à laquelle ouvre la saison de pêche de la Saint-Jacques.
Source :
Les informations dieppoises
Une trentaine de bateaux de pêche de Dieppe prendront la mer dès cet après-midi pour l’ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques.
Après une année 2013 qualifiée d’exceptionnelle, les professionnels s’attendent à trouver un produit de bonne qualité mais certainement en moindre quantité.
Les premières coquilles sont attendues sur les étals dès mercredi. A Dieppe, la Saint-Jacques est réputée pour sa fraîcheur, puisqu’elle arrive à quai encore vivante.
Normandie. La pêche à la saint-jacques ouvre mercredi
La pêche à la coquille Saint-Jacques ouvre à minuit, dans la nuit de mardi à mercredi, pour la zone des 12 à 20 milles. Les patrons-pêcheurs de Port-en-Bessin s'inquiètent déjà.
Source :
Ouest France
La grogne
À la veille de l'ouverture, les patrons-pêcheurs de Port-en-Bessin protestent. « Des accords sont signés entre les Britanniques et les Français, mais on retrouve des bateaux irlandais sur la zone, explique Claude Milliner, armateur du Défi. Nous avons contacté les élus pour qu'ils interviennent. S'il ne se passe rien, nous projetons de pêcher dans la zone des 12 milles. Après une saison en demi-teinte, nous pensions retrouver un peu d'air avec l'arrivée des nouvelles coquilles. »
Trois dates à retenir
La zone qui ouvre ce soir va de Barfleur au cap d'Antifer, au-delà des 20 milles (environ 37 km). La zone comprise entre les 12 et 20 milles, ouvrira le 3 novembre et permettra aux plus petits bateaux de pouvoir commencer à pêcher. « La première zone est très éloignée, cela engage des frais et les cours ne suivent pas souvent », remarque un autre pêcheur. Beaucoup étaient revenus au chalut l'an passé, en attendant le mois de novembre. La Baie de Seine, près des côtes, ouvrira, quant à elle, le 1er décembre.
Quelle qualité de coquille ?
Quid de la qualité et de la taille des coquilles à l'ouverture ? « C'est la surprise des premières caisses débarquées, note Richard Brouze, directeur de l'organisation des producteurs de Basse-Normandie. Il y a l'offre et la demande, mais les volumes fixent les règles des cours. » Ifremer annonce un retard de croissance. « Nous verrons bien, ce n'est pas pour cela que les coquilles seront moins chères, au contraire certainement. »
Plus d'informations :
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 29 Septembre 2014« Tuer la poule aux oeufs d’or… » à propos des campagnes contre le chalut
Fishing News international, vient d’attribuer le titre de « man of the year » à Menakhem Ben-Yami. Une juste reconnaissance pour ce rescapé du ghetto
qui a toujours été un résistant. Le journal lui consacre un long article biographique.
Menakhem Ben-Yami à Lorient en Novembre 2010 (Photo Alain Le Sann)Concernant les campagnes contre le chalutage, ce scientifique remet en cause les messages médiatiques très largement diffusés. Lire l’article ci-dessous : traduction de World fishing and aquaculture (en anglais)
Source :
L'Encre de Mer
L’auteur s’insurge contre l’idée véhiculée (notamment par Oceana) que « l’utilisation intensive des chaluts de fonds et des dragues provoquerait des dommages plus directs aux fonds sous-marins que toute autre activité humaine dans le monde, plus que les forages pétroliers, les mines sous-marines, les poses de pipelines, les déversements de tonnes de polluants…. ! Pour lui, il est important de » ne pas mettre tout le chalutage, à toutes les échelles, et à toutes les zones océaniques, dans le même panier de publicité ». Il pense même que cette focalisation d’Oceana sur le chalutage et sur d’autres méthodes de pêche ne vient pas seulement d’un souci environnemental mais plutôt de la volonté d’écarter l’attention du public et des institutions de réglementation d’autres activités industrielles dont certaines constituent ses principaux bailleurs de fonds.
Des études scientifiques récentes montrent qu’au contraire le chalutage peut accroître la richesse des fond et l’abondance de poissons….
« Depuis des années, j’ai lu de nombreuses études sur les effets du chalutage avec des conclusions et des recommandations très variables. La conclusion habituelle est que sur des sols mous, le chalutage est bon car il oxygène la couche de fond supérieure et empêche ainsi la création d’une couche noire, malodorante, anoxique résultant du dépôt continuel de matière organique morte. Sur fond dur, les chaluts et les techniques de chalutage de fond sont conçus de manière à avoir un impact réduit. Et au niveau écologique, il est habituellement prévu la fermeture des habitats sensibles sur lesquels les chaluts pourraient en effet causer des dommages permanents aux récifs coralliens profonds.
Quoi qu’il en soit, pour éviter que votre poule ne picore dans votre jardin, vous n’avez pas à la tuer; juste clôturer le jardin … et la laisser picorer ailleurs. »
plus d'informations dans :
L'Encre de Mer ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dans le marin du 26 septembre 2014, L’art de conter la pêche artisanale
"Elisabeth Tempier et son équipe de l’Encre de Mer nous invitent avec passion et finesse à découvrir la pêche artisanale, à la comprendre, à l’aimer si ce n’est le cas. En renfermant Poissons, on regrette de ne pas avoir ouvert plus tôt ce livre sorti en juin... et on a envie que tout le monde le lise..." Solène Le Roux
« Poissons, Histoires de pêcheurs, de cuisiniers et autres » d’Elisabeth Tempier. Préface de Carlo Petrini, fondateur de Slow Food. Postface de Pierre Mollo, biologiste spécialiste du plancton. Editions Libre et Solidaire
À la une du marin du 26 septembre : Ebola perturbe l’activité maritime en Afrique
Le marin consacre son sujet d’ouverture au virus Ebola qui ne cesse de progresser en Afrique de l’ouest. Face à la menace, l’ensemble des activités maritimes (commerce, offshore, pêche…) s’organise.
Également dans ce numéro du marin :
* la certification pêcheur responsable de 33 navires bretons ;
* la volonté des thoniers senneurs français d’encadrer les DCP ;
* Quotas. L'Association d'halieutique veut un effort sur la durée ;
* les négociations tendues pour la répartition de l’enveloppe du Feamp ;
* GMS. Le thon rouge de ligne retrouve les rayons en 2015 ;
* l’invasion de sargasses dans les Antilles ;
* Vendée. Olmix mise sur l'algue rouge ;
* les filets sud-asiatiques accusés de capturer trop de cétacés dans l'Océan Indien ;
* baleine. la pêche scientifique plus encadrée ;
* justice. La chalutage reste interdit dans les 3 milles ;
* gens de mer. Des pensionnés combatifs ;
* CBS. Le chantier étellois monte en puissance ;
* la stratégie de Total pour réduire ses coûts…
Cliquer
Ici pour lire le marin ou aller dans
le Kiosk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 26 septembre 2014
Privatisation du domaine public maritime au profit de riches estivants...
Bassin d'Arcachon : Devant l'avancée touristique, les professionnels de mer entrent en résistance au Cap Ferret...
Les cabanes ostréicoles au tribunal... Le Comité départemental des pêches et le Syndicat des patrons, armateurs et marins de la Gironde (Spam 33) viennent de déposer plusieurs requêtes devant le tribunal administratif de Bordeaux. Les pêcheurs contestent l’attribution des cabanes du domaine public maritime à des estivants. Ils dénoncent une privatisation au profit de riches particuliers...
Lorsque la commune de Lège-Cap-Ferret a pris le village du Four en gestion, ladite convention a été refondue. « Une première version rédigée en 2011 par les services de l'État interdisait la transmission automatique et permettait l'exercice d'un véritable droit de priorité aux professionnels de la mer qui ont besoin de proximité pour travailler et se loger », souligne Alain Argelas, président du Spam 33. Il rappelle que « le Cap-Ferret est l'un des seuls endroits où il y a des cabanes d'habitation sur le domaine public maritime ». Et de parler aussi des levées de boucliers qui ont suivi, menant selon lui à la rédaction in fine d'une convention « illégale et favorable aux estivants ».
« C'est un privilège filial. Le domaine public est inaliénable, intransmissible », résume Alain Argelas, qui dénonce la privatisation des villages au profit de riches occupants peu présents sur la presqu'île, faisant de ces cabanes des résidences secondaires alors que les jeunes inscrits maritimes ne parviennent pas à se loger.
Lège Cap-Ferret : les cabanes de bord de mer au tribunal
Les pêcheurs contestent l’attribution des cabanes du domaine public maritime à des estivants. Ils dénoncent une privatisation au profit de riches particuliers
Source :
Sud Ouest par Sabine Menet
Les cabanes ostréicoles au tribunal... Le Comité départemental des pêches et le Syndicat des patrons, armateurs et marins de la Gironde viennent de déposer plusieurs requêtes devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Ils demandent l'annulation de délibérations prises lors du Conseil municipal de Lège-Cap-Ferret le 20 juin dernier et relatives à plusieurs autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime. Ils demandent également l'annulation de plusieurs arrêtés municipaux portant sur le transfert de ces AOT à des ayants droit non professionnels. Bref, avec ces requêtes, ils entendent attaquer sur le fond la convention de gestion des cabanes de 2012. Un petit rappel des faits s'impose.
Une convention illégale et favorable aux estivants
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 25 Septembre 2014
Granville. Toute la mer sur un plateau ce week-end
Chaque année, le public répond toujours plus nombreux au festival des coquillages et crustacés. Granville, le premier port coquillier de France, s'apprête à accueillir plus de 50000 visiteurs pour la 12e édition.
Source :
Ouest France par Fabien Jouatel et Jean-René Rivoal.
La 12ème édition du Festival "Toute la mer sur un plateau" aura lieu les 27 et 28 septembre 2014.
Dans la baie du Mont-Saint-Michel, le port de pêche de Granville - 1er port coquillier de France - mettra une nouvelle fois en vedette les produits de la mer. Depuis maintenant 12 ans, la mer - omniprésente dans le paysage granvillais - donne le ton à ce grand rendez-vous annuel placé sous le signe de la pédagogie et de la gastronomie.
Les coquillages et les crustacés auront la part belle, frais ou transformés mais également mis en scène par les Chefs normands. Pas moins de 16 tonnes de produits de la mer, en direct du pêcheur ou du conchyliculteur : bulots, praires, coquilles Saint-Jacques, olivettes, amandes, huitres, moules, homards et tourteaux. Au programme du week-end : vente et restauration sur place, animations variées pour petits et grands, démonstrations de cuisine et dégustations pour les quelque 55 000 visiteurs qui se donnent rendez-vous, chaque année, sur le port de pêche granvillais.
Cliquer
Ici pour télécharger le programme des deux jours
Bulot
C'est le produit phare de la criée granvillaise. Les coquillages représentent 79 % du tonnage annuel. L'obtention du label européen IGP (Identification géographique protégée) pourrait intervenir en 2015, et renforcerait l'image de Granville comme le 1er producteur européen de bulots. Sa labellisation « pêche durable » est également en cours.
Coquille saint-jacques
Sa pêche sera ouverte le 1er octobre, mais par dérogation spéciale des Affaires maritimes, les pêcheurs pourront la pêcher dès le vendredi 26 septembre. L'association du festival cotise auprès du comité régional des pêches pour réensemencer l'équivalent de la partie prélevée avant la date officielle d'ouverture.
Cette année, le tonnage proposé devrait atteindre les 7 tonnes contre 5 l'an passé, soit une augmentation de 40 %.
Depuis 2009, le comité régional des pêches est dans une démarche d'ensemencement de coquilles afin de gérer la ressource. Là aussi, une démarche est en cours de certification pour obtenir le Label rouge pour la noix de saint-jacques blanche surgelée.
Homards
400 kg ont été vendus la première heure l'an dernier. Au total sur les deux jours, trois tonnes ont été écoulées. En 2013, treize bateaux avaient participé à l'approvisionnement du festival en homard dont certains de Barneville-Carteret, de Diélette et de Jersey.
Fraîcheur
Pour assurer un maximum de fraîcheur aux produits de la mer proposés, 90 % des bateaux de pêches de Granville participeront à approvisionner le festival. Pour les coquillards et les bateaux qui pêchent la praire, normalement au repos le vendredi, ce sera une sortie de pêche en plus, exceptionnellement.
Espaces thématiques
(...)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Granville, premier port européen pour le bulot
A l'occasion de la fête Toute la mer sur un plateau ce week-end, entretien avec Loïc Houssard, président de la Chambre de commerce et d'industrie du centre et Sud Manche.
Granville est-il toujours le premier port coquillier de France ?
Toujours ! C'est aussi le premier port bas-normand, la sixième criée sur les 37 qui existent en France, avec 8 500 tonnes de coquillages et 2 500 tonnes de poissons. 54 navires où travaillent 175 personnes. Sans oublier le reste de la filière : les mareyeurs, le transport... Et le bassin conchylicole qui regroupe 450 entreprises sur toute la côte, avec 16 200 tonnes d'huîtres et 12 000 tonnes de moules de bouchot.
À propos de qualité, à quoi correspond la marque Baie de Granville ?
Mise en avant depuis 2009 avec le groupement Normandie fraîcheur mer, cette marque commerciale « Baie de Granville » concerne le bulot, le bar, la daurade grise, le lieu jaune, le saint pierre, la sole et le turbot. Quand je fais mon marché, j'aime bien savoir d'où vient le produit qu'on me présente. Et sur les écriteaux, on lit souvent : « pêché en Atlantique Nord », c'est un peu vague. Cette marque a le mérite d'être plus précis et définit plusieurs critères de qualité : lieu de pêche, fraîcheur, marée courte et respect des tailles.
Bulot de la Baie de Granville – Normandie
Normandie Fraicheur Mer
Les pêcheurs de l'Ouest du Cotentin (France) s'engagent, avec le groupement qualité nfm (www.nfm.fr), pour une pêche respectueuse d'un des nombreux coquillages emblématiques de la Normandie : le bulot de la baie de Granville(whelk from Normandy). Découvrez cette pêche avec un pêcheur professionnel de Granville, dans la Manche: Didier LEGUELINEL, à bord du M TETHYS.
Vous souhaitez encore aller plus loin dans ce domaine ?
Une démarche a été entreprise, concernant le bulot, pour avoir le label d'Indication géographique protégée (IGP). Granville reste le premier producteur européen de bulot. Une reconnaissance au niveau européen, spécifiante et de qualité, qui devrait être délivrée en 2015. En 2011, nous avons déjà obtenu la labellisation Pêche durable pour le homard. Une autre démarche de certification est également engagée au niveau de la saint-jacques surgelée blanche, avec une grande responsabilité de nos pêcheurs, qui gèrent, chaque année depuis 2009, un ensemencement.
Pour plus d'informations sur le Bulot de Granville :
Normandie Fraicheur Mer (NFM) Granville, 1er port de pêche bas-normand
Une flottille de 54 navires. 175 hommes embarqués. Granville reste aussi le premier port coquillier de France. Source :
Ouest France (Janvier 2014)
Le président de la Chambre de commerce (CCI) Centre et Sud-Manche Loïc Houssard a établi, jeudi soir, le bilan 2013 des ports de Granville. Le port de pêche est le premier port en tonnage de Basse-Normandie. Il a enregistré une hausse des apports en tonnage de 9 %, soit plus de 1 000 tonnes supplémentaires (10 918 tonnes en 2013, contre 9 983 tonnes l'année précédente).
Pourtant, le chiffre d'affaires est en légère baisse de -2 %, à 18,4 millions d'euros. « Les sorties des bateaux ont été rythmées par les caprices de la météo avec une fin d'année balayée par des tempêtes », souligne Loïc Houssard.
Avec une flottille comptant 54 navires pour environ 175 hommes embarqués, le port de Granville reste le premier port coquillier de France, 6e en tonnage et 14e valeur sur les 37 halles à marée. Les coquillages représentent 79 % des apports en tonnage.
Commerce et plaisance
Projet d'extension
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 24 Septembre 2014
Eolien. Ils comptent oiseaux et mammifères en baie de Saint-Brieuc
Samedi, sur la zone du projet éolien, les naturalistes d'In Vivo ont réalisé 110 observations d'oiseaux ou marsoins Samedi, sur la zone du projet éolien, les naturalistes d'In Vivo ont réalisé 110 observations d'oiseaux ou marsoins | François Grégoire
Depuis deux ans, à raison de deux sorties par mois, des naturalistes du bureau d'études In Vivo conduisent des observations sur la zone d'implantation du futur parc éolien.
" Nous assurons un suivi des oiseaux et mammifères marins, le but étant de caractériser la zône du projet éolien en baie de Saint-Brieuc par rapport à la richesse avifaunistique et des mammifères marins ", résume Alexis Chevallier, du bureau d'études finistérien In Vivo à qui a été confié ce recensement.
Ces observations sont ensuite compilées et cette "photographie" vient nourrir l'étude d'impact commandée par Ailes Marines, porteur du projet éolien en baie de Saint-Brieuc.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 23 septembre 2014
Urgent : Relecture de la filière pêche sous l'angle géopolitique...
La relecture de la filière pêche sous l'angle géopolitique est urgente.
La France détentrice de la plus vaste superficie maritime, après les USA, est fondée à mettre en œuvre, une politique courageuse de protection de ses zones maritimes. Le contrôle des AMP, la cohabitation entre l'activité halieutique, son maintien, et l'exploitation pétrolière en mer profonde nécessite de fortes avancées diplomatiques. Les alliés traditionnels de la France comme les USA ont plus intérêt à participer à la préservation des océans, à nos côtés, qu'à servir de cadre à des manigances fumeuses et gravement destructrices.
Décryptage de Richard Honvault - Conseiller municipal (UDI/Nouveau Centre) de Boulogne-sur-Mer et Secrétaire national du Nouveau Centre en charge de la pêche, de la mer et de l'économie portuaire
La pêche en eau profonde, un nouvel enjeu géopolitique ?
Une vaste opération, à caractère géostratégique, est menée pour confisquer de vastes espaces maritimes et océaniques au bénéfice exclusif des intérêts américains. Cette manipulation est relayée en France et dans le monde par des ONG en relation étroite avec les acteurs américains de cette entreprise.
1/3 des pétitionnaires sont étudiants ou doctorants d'institutions scientifiques américaines directement financées par PEW et les 2/3 restants sont des bénéficiaires via des réseaux comme Sea Around Us doté à plus de 20 millions de dollars, par PEW.
Au nom de la défense de l'environnement et de la faune maritime, la pêche de grand fond serait interdite dans des Aires Marines Protégées (AMP) ce qui faciliterait de futures extractions minières offshore au profit d'intérêts politico-économiques américains. Les trusts caritatifs comme PEW sont au cœur du lobby des ONG visant à la création des AMP dans le monde.
En 2009, le Royaume-Uni, ciblé par les lobbies écologiques américains, a adopté le "Marine and Coastal Access Act" (loi d'accès maritime et côtier) qui instaure une catégorie spécifique d'AMP, les MCZ (marine conservation zone) ou zones de préservation de la biodiversité des fonds marins. Prévue en 2013, l'officialisation par le gouvernement britannique des 127 MCZ, est différée.
La communauté maritime française craint que ces MCZ ne menace gravement l'activité des flottes de pêche. La sanctuarisation de plus de 50% des zones, interdisant de fait la pêche induit la disparition du droit de pêche, de 5 000 emplois directs et de notre souveraineté maritime. Interrogé sur ce point, par Hervé Morin, (question parlementaire JO du 18/12/2012), le ministre des transports, F Cuvillier s'est voulu rassurant (réponse p7578, JO du 16/07/2013). Depuis lors, aucun point d'étape n'a été communiqué par les services de l'État.
Le PEW Charitable Trusts est intervenu, sur la réforme communautaire de la pêche et son interdiction en grand fond. Ciblant le parlement européen et l'opinion publique de l'UE, PEW est à la base d'un consortium d'ONG, regroupant OAK Fundation, Adessium (Hollandaise), le WWF, Greenpeace et Birdlife international, mobilisant 140 millions de dollars. L'argumentaire scientifique est établi par l'université de Colombie britannique pour un coût de 2à millions de dollars payé entièrement par PEW.
Les cartes établies par "Blue Lobby" pointent la superposition d'enjeux (pêche, défense, commerce, terres rares marines) dans les zones visées, attirant les appétits américains. Des lobbies réclamant la création de ses AMP, financés ou en lien avec les administrations et les compagnies pétrolières américaines, affirment que l'exploitation pétrolière serait un mode durable de financement de la préservation des mers citant les études d'impact financées par ces industriels liés à PEW!
La famille PEW qui a fait fortune dans le pétrole, créé, dans les années 80, son trust caritatif le "PEW Charitable Trusts" avec un capital de 5 milliards de dollars placé sur les marchés financiers internationaux, générant des gains annuels de 300 millions de dollars, défiscalisés (conformément aux lois US) et affectés au programme d'actions du trust. Classé 12ème aux USA, ce trust serait devenu organisateur et financeur du lobby "Océan" d'autres ONG.
Suite :
Huffingtonpost^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 22 septembre 2014 Après MerAlliance, Thaï Union acquiert le norvégien King Oscar
Après MerAlliance, le groupe Thaï Union Frozen (TUF) vient de signer une deuxième acquisition en un mois. Il s'agit de la société norvégienne King Oscar, propriété du fonds Procuritas Capital Investors IV.
Spécialiste du poisson en conserve (hareng, maquereau, thon, anchois, foie de morue), King Oscar occupe des positions de leader en Norvège, aux Etats-Unis, en Pologne, en Belgique et en Australie. La société norvégienne est même numéro un du segment de la sardine premium en Norvège, aux Etats-Unis et en Australie. Son chiffre d'affaires est de 80 millions de dollars (pour 90 millions de conserves par an). Il affiche une croissance annuelle de 6 % depuis cinq ans. Ses deux sites de production sont implantés à Gniewino en Pologne et à Svolvaer en Norvège, pour une capacité de production de 135 millions de conserves par an.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Reportage photographique dans le marin...
Depuis le 15 juin, dans les ports de l’est Cotentin et du Calvados, une soixantaine de chalutiers ont armé les dragues pour la campagne de moules sauvages. Le marin a embarqué, le temps d’une marée, à bord du Valenscillia, basé à Saint-Vaast-la-Hougue.
Romain Lanéele, le patron, explore le gisement de Réville où « la moule est magnifique ». Les traits d’une vingtaine de minutes s’enchaînent à bon rythme durant 3 heures pour atteindre le quota de 2,4 tonnes (5 jours par semaine et > 1 euro le kilo ndlr). Les moules déversées sur le pont sont aussitôt triées puis mises en sacs. « La production est déjà vendue », souligne Romain Lanéele, qui travaille avec le groupement Normandie fraîcheur mer et a donc « un cahier des charges exigeant ».
L’est du Cotentin concentre la plus importante zone de moules sauvages du littoral français. L’an passé, entre 5 000 et 7 000 tonnes y ont été pêchées. Les professionnels gèrent cette ressource en fixant les dates, les conditions d’ouverture et les quotas de pêche selon les prospections effectuées avec l’Ifremer. D'après le marin :
Une marée à la pêche aux moules sauvages dans l’est Cotentin
Les autres sujets du marin :
Entretien avec Xabier de La Gorce, président de la SNSM;
3 incendies en mer : Au Croisic : un ligneur brûle et coule, à Port-en-Bessin : un chalutier sombre après un Incendie, à l'Aiguillon-sur-Mer : incendie du fileyeur "Théo";
La chute à la mer fatale sur un caseyeur à Belle-Île;
Peu de coquilles Saint-Jacques attendues pour la campagne en Manche-est;
Saumon. Marine Harvest a repris la filiale chilienne de Pescanova;
Le thaïlandais TUF poursuit ses emplettes en Norvège;
Malconche (Oléron). Nouvelle enquête sur le projet de filières;
Pêche. Les autorisations européennes dont des vagues en Méditerranée;
Quotas. José Jouneau refuse toute baisse en 2015;
Tourteau. Un audit européen à bord de cinq caseyeurs français;
Granville. Ouverture réussie pour la praire;
Pêche illégale. la France veut ratifier un accord international;
Guadeloupe. Flagrant délit de pêche aux lambis;
Guyane. Deux radars pour lutter contre la pêche illégale;
Des centaines de migrants précipités à la mer;
Un dossier complet en région Aquitaine : Pêche. Vers une année record... Le pari de la transformation...
Cliquer
Ici pour lire le marin ou aller dans
le kiosk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 20 Septembre 2014 Journées du patrimoine : Visitez les coulisses de Maréis !Maréis, le centre de la découverte de la pêche en mer...
Étaples - Pas-de-Calais
À l’occasion des journées du patrimoine, Maréis a concocté un programme spécial.
Visite des coulisses. Pour la première fois, les visiteurs pourront découvrir comment fonctionne le système de filtration d’eau, la zone d’élevage, le régime alimentaire des animaux...
Visites à 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et 17 h.
Visites guidées. À 10 h 30, 11 h 30, 15 h, 16 h (en patois étaplois) et 17 h.
Demi tarif. Les entrées sont à demi-tarif durant tout le week-end.
Renseignements : 03 21 09 04 00 et site web :
Maréis
En un mois, Maréis a franchi la barre des 10 000 visiteurs
L’équipe du centre de la découverte de la pêche en mer, à Étaples, est HEU-REUSE. Pour la première fois de son histoire, Maréis a enregistré plus de 10 000 visiteurs en un mois. Une hausse de 47 % par rapport à 2013.
Source :
Voix du Nord par Elise Chiari
Les raies ont failli en faire un flash-mob. Au mois d’août, Maréis a accueilli 10 325 visiteurs. Un record absolu pour le centre depuis son ouverture en 2001. « D’habitude on oscille entre 4 000 entrées pour les pires mois d’août et 8 000 pour les meilleurs », note Vincent Theeten, directeur du pôle tourisme, qui ne cache pas sa joie : « En général, on reste mesurés, on ne se gargarise pas des réussites mais là, on le dit, on est vraiment ravis ! »
Il y a de quoi car le résultat représente plus d’un quart de la fréquentation annuelle (43 000 visiteurs en 2013). « Nous avons eu des journées très denses, parfois jusqu’à 800 personnes. Le personnel a assuré, tout le monde a gardé le sourire en toutes circonstances. »
Pour Vincent Theeten, la météo seule ne peut pas expliquer ce succès. « C’est vrai que le mois d’août a été exécrable mais depuis 2001, il y en a eu des saisons pourries, sans pour autant qu’on atteigne des scores pareils ! » Alors quoi ? « Je crois qu’on peut dire que Maréis commence à être connu. On a mieux communiqué ces dernières années, on a une meilleure visibilité dans le Montreuillois. »
Depuis quelques années, Maréis multiplie les animations autour de la pêche : visites guidées par des pêcheurs ou femmes de pêcheurs, ateliers pédagogiques pour les familles, sorties à Capécure, visite de chalutier ou de l’usine de soupes Pérard… Maréis se diversifie et s’ouvre. « On a de plus en plus de partenariats, on travaille avec le FIGRA, avec les pêcheurs, la CME… Le programme d’animations culturelles contribue à donner une image plus large à Maréis. » Mieux encore : « Les gens disent qu’après la visite, ils voient la pêche différemment. »
Ne comparez pas à Nausicaa!
À côté des 600 000 visites annuelles de Nausicaa, le score de Maréis fait figure de goutte d’eau dans l’océan... « On ne peut pas nous comparer, nous ne faisons pas la même chose », rectifie Vincent Theeten.
Selon lui, le jumeau de Maréis est Haliotika, cité de la pêche au Guilvinec, qui a enregistré 20 000 visites en juillet-août. Un poil devant Maréis, qui est à 17 230.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Journées du patrimoine à Cabourg. Découverte de la pêche à la senne
Pour les Journées du patrimoine, une démonstration de la pêche à la senne aura lieu dimanche à 15 h sur la plage de Cabourg.
Source :
Ouest France
Le rendez-vous est fixé à 15 heures en face du Grand hôtel, pour une démonstration de cette pêche interdite depuis le début des années soixante. Vers 17 h 30, les spectateurs seront invités à tirer sur les cordes du filet pour le ramener sur la plage.
Cette manifestation, organisée par le Comité des amis du patrimoine et de l’animation côtière (Capac) se déroule chaque année depuis 1998, dans le cadre des Journées du patrimoine. Elle a lieu, en alternance, sur les plages d’Houlgate, Cabourg, Merville-Franceville et Blonville.
----------------------------
Journées du patrimoine : que faire dans le Sud-Ouest ?
Pour les 31e Journées du patrimoine, la rédaction de Sud Ouest liste 5 idées de sorties/visites par zone, et plus si affinités
Source :
Sud Ouest Selon Météo-France, la pluie pourrait nous épargner ce week-end. Une raison de plus pour profiter des 31e Journées européennes du patrimoine, qui ont lieu ce week-end. "Patrimoine culturel, patrimoine naturel", tel est le thème retenu par le ministère de la Culture et de la Communication.
Au total, 17 000 lieux sont ouverts ce week-end. Plus de 23 000 animations programmées.
Les agences locales de Sud Ouest ont retenu cinq idées pour chaque zone. Une sélection subjective. Tous les événements sont listés ici.
Extrait
Gironde
- au fil de l'eau sur le canal entre le Bassin et le lac de Lacanau, dimanche à Lège-Cap-Ferret. Plus d'infos ici.
Charente-Maritime
- à Rochefort. Site unique en Europe, la Station de lagunage de Rochefort est un exemple de gestion durable de l'environnement et de préservation de la qualité des eaux du fleuve pour la biodiversité et les activités humaines sur le littoral. Cette station de traitement écologique des eaux et les marais périurbains constituent un espace naturel remarquable pour les oiseaux. Découverte à vélo en longeant le fleuve Charente de Rochefort à Soubise, en empruntant le Pont Transbordeur et le bac "le Rohan" et découverte de la station de lagunage et des oiseaux migrateurs : dimanche 14h30-17h. Plus d'infos ici.
- à Ars-en-Ré, la coopérative des Sauniers de l'Ile de Ré organise la fête du sel, avec visite d'un marais salant à vélo : samedi à 10h et dimanche à 10h et à 15h. Au programme du week-end : marché du terroir avec démonstrations culinaires, démonstrations de danses dans les marais, récolte des sauniers, charroi du sel à l'ancienne jusqu'au port, bal... Renseignements au 05 46 29 40 27. Plus d'infos ici.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Analyse des captures accidentelles de mammifères marins dans les pêcheries françaises aux filets fixes
Morizur Yvon, Gaudou Olivier, Demaneche Sebastien
Ifremer - août 2014
Durant la période 2008-2013, des observations de captures ont été réalisées à bord des fileyeurs de mer du Nord, d’Atlantique et de Méditerranée (Corse).
Les filets observés n’étaient pas équipés de pingers et les observations ont été analysées pour déterminer des taux de capture annuels moyens des espèces de mammifères marins par flottille.
Des estimations par flottille ont ensuite été calculées en procédant à des extrapolations sur la base des efforts de pêche de l’année 2012. Parmi les mammifères marins, le marsouin commun Phocoena phocoena était l’espèce la plus fréquente dans les filets. Une estimation annuelle de 600 marsouins capturés a été obtenue pour l’ensemble de la flotte française. Les autres espèces rencontrées dans les filets étaient principalement le dauphin commun Delphinus delphis, le dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba, et les phoques Phoca vitulina et Halichoerus grypus.
Les trémails à baudroie et les trémails à sole sont responsables de 80 % des captures de marsouins. Quelques captures (20 %) existent aussi au filet maillant dans le golfe de Gascogne. Aucune capture accidentelle n’a été recensée en Méditerranée. La majorité des captures de marsouins se produit à 80-100 mètres de profondeur. Certains métiers de pêche de la zone concernée par le dispositif réglementaire « pingers » ne s’avèrent pas concernés par les interactions avec les marsouins. C’est le cas notamment des filets maillants à araignées en Manche.
![]()
Les captures accidentelles de marsouins ont été peu fréquemment observées en Manche centrale alors qu’elles existent aux deux extrémités de la Manche. Les taux de capture par opération de pêche ont été calculés par métier et par zone, et l’étude s’attache à décrire les variations observées. Les captures accidentelles de marsouins semblent saisonnières et la modulation saisonnière est différente selon les zones. Les résultats sont discutés en relation avec le règlement européen 812/2004 dans lequel les engins de pêche de type trémail ne sont pas mentionnés.
Cliquer
Ici pour télécharger le document "Morizur Yvon, Gaudou Olivier, Demaneche Sebastien (2014). Analyse des captures accidentelles de mammifères marins dans les pêcheries françaises aux filets fixes. Source :
Archimer^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bases scientifiques de la gestion des pêches, aujourd'hui et demain
Formation continue - Module inter-entreprises
Agrocampus Ouest - Rennes
du 6 au 8 octobre 2014
Publics concernés : Acteurs et cadres du secteur des pêches maritimes : responsables, animateurs, chargés d'études des structures et organisations professionnelles, des administrations et collectivités territoriales
Contexte Le secteur des pêches est aujourd'hui confronté à de profondes mutations : réforme de la politique commune des pêches, mise en place d'une politique marine intégrée (Directive cadre «Stratégie pour le milieu marin»), préoccupations sociétales concernant les enjeux de durabilité écologique et de conservation des ressources marines.
A tort ou à raison, ces différentes évolutions de la gestion des pêches se réclament bien souvent de «l'avis des scientifiques».
Dès lors, il est utile pour les différents acteurs du monde de la pêche maritime de comprendre comment cet avis se construit, quelles sont les méthodes aujourd'hui utilisées par les scientifiques et quels sont les résultats qui justifient (ou pas) les évolutions en cours ou à venir.
Objectifs
Comprendre les notions scientifiques et le principe des méthodes utilisées par les chercheurs lors de la production des avis scientifiques : proposition de TAC et quotas, plans de gestion, approches plurispécifiques
Appréhender les enjeux liés au développement de l'approche écosystémique des pêches et à la mise en œuvre de la Directive cadre stratégie pour le milieu marin
Programme
Séquence 1 (2 jours) : La gestion des pêches aujourd'hui : bases scientifiques
* Pressions des activités humaines sur les ressources vivantes marines
* Notions de base sur la dynamique des populations exploitées : impact de la pêche sur les biomasses et le recrutement
* Notion de rendement par recrue et modèle de capture - Choix des objectifs de gestion
* Atelier étude de cas (modèle de production)
- L'approche de précaution : mise en oeuvre et bilan
- Principes et contraintes de la gestion au RMD
- Lecture dirigée d'un rapport d'évaluation de stock
Séquence 2 (1 jour) : Approche écosystémique des pêches et nouveaux enjeux de gestion
* Approche écosystémique : état des lieux et perspectives pour les pêches en Europe
* La nécessité de préserver les habitats essentiels au renouvellement des ressources halieutiques
* Nouveaux outils de gestion des écosystèmes marins : gestion écosystémique des pêches, DCSMM, aires marines protégées ; état d'avancement et perspectives
Durée : 3 jour(s)
• 06 octobre 2014 au 08 octobre 2014
Lieu : Rennes
Tarif : 765 €
Responsable(s)
Didier GASCUEL
Olivier LE PAPE
AGROCAMPUS OUEST
Cliquer
Ici pour plus d'informations et inscription
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 17 Septembre 2014 Petits métiers : du thon rouge et des civelles...
Des thons, y'en a plein la mer, et des cons y'en a plein la terre !" Avec son incomparable faconde, le Ciotaden Gérard Carrodano a tôt fait de résumer en une phrase ce que pense tout le petit monde des pêcheurs provençaux. À savoir que le stock de thons rouges jadis menacé semble en bonne voie de reconstitution.
Quant aux civelles, les pêcheurs sont « payés » pour repeupler les rivières, alors que les civelles reviennent naturellement dans les cours d’eau !
L’état moyen des rivières sur la zone Rhône Méditerranée Corse s’est amélioré par rapport à 2012, grâce notamment aux pluies abondantes qui ont dilué les polluants, a expliqué Martin Guespereau, directeur général de cette agence de l’eau au cours d’une conférence de presse. Notamment dans les Alpes et en Corse.... « Des poissons migratoires, comme les civelles ou les aloses, reviennent dans nos rivières », a d’ailleurs noté M. Guespereau. Et ce, grâce à des passes à poissons ou des rivières artificielles. Extrait de La Gazette des communes :
Des panneaux indicateurs de rivières propres dans le Sud en 2015
En Charente-Maritime, pour une hausse du quota de civelles
La campagne dernière, 81 licences de pêche à la civelle avaient été accordées pour l'unité de gestion englobant la Gironde, la Seudre et la Charente ; 34 licences au nord pour la Sèvre niortaise. Ces pêcheurs avaient capturé en une semaine le quota dit « de consommation » qui aujourd'hui doit, selon le règlement européen, représenter 40 %. Le reste qui va au repeuplement est acheté par des financements publics. Mais les budgets étant insuffisants, tout le quota de repeuplement n'a pas été pêché, ce qui a constitué un manque à gagner pour la flottille. Dans ce contexte, le CRPM plaide pour le relèvement du quota de consommation, celui qui est mis sur le marché. La volonté de rouvrir le marché asiatique a été exprimée à la direction des pêches qui a laissé peu d'espoir aux responsables professionnels. Extrait de Sud-Ouest :
Charente-Martime. Pêche : les dossiers de la rentrée
En Méditerranée, le thon rouge ne broie plus du noir
« Les observations indiquent un retour de l’espèce. Les petits pêcheurs espèrent en conséquence de nouveaux quotas. Sans agrément spécifique, Gérard Carrodano
qui pêche l’espadon à la palangre, ne peut relever les thons rouges qui semblent selon plusieurs sources concordantes de retour en Méditerranée. Une situation crispante pour les petits métiers qui prônent l’augmentation de leurs quotas.
Illustration de L'Encre de Mer : "Gérard Carrodano, sentinelle de la mer"« Des thons, y’en a plein la mer, et des cons y’en a plein la terre ! » Avec son incomparable faconde, le Ciotaden Gérard Carrodano a tôt fait de résumer en une phrase ce que pense tout le petit monde des pêcheurs provençaux. À savoir que le stock de thons rouges jadis menacé semble en bonne voie de reconstitution.
Article de La Provence via
L'Encre de Mer
Sentinelle de la Méditerranée, spécialiste des captures d’espèces vivantes pour les plus grands aquariums européens et pêcheur d’espadon à la palangre, ce marin expérimenté de 59 ans, qui passe bon nombre de journées en mer, est confronté à un problème de taille : des thons rouges se prennent dans ses lignes, mais il ne peut pas les relever car il est victime des quotas imposés par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (Iccat)…
Suite dans
La Provence ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Pêcheries de l’UE : une première pour le merlan bleu de l’Atlantique Nord
Un groupe de pêcheries pélagiques des Pays Bas, d’Allemagne, de France, d’Angleterre, de Lituanie, du Danemark et d’Irlande fait entrer pour la première fois le merlan bleu de l’Atlantique Nord dans le processus d’évaluation de la Marine Stewardship Council (MSC). Il s’agit de la troisième évaluation multinationale de la pêche pélagique au cours des derniers mois, ce qui traduit une tendance à la hausse de la coopération transfrontalière dans le secteur, selon des déclarations de la MSC. En unissant leurs efforts, les organisations nationales de pêche peuvent réduire leurs coûts d'évaluation et améliorer leur gestion de la pêche.
Source :
CTA d'après worldfishing.net
First North Atlantic blue whiting enters MSC assessment
Source : MSC Aug 13, 2014
A large group of Dutch, German, French, English, Lithuanian, Danish and Irish pelagic fishers has entered the first North Atalntic blue whiting (Micromesistius poutassou) fishery into MSC assessment. This is the third multi-national assessment of a pelagic fishery in recent months marking a growing trend of cross-border cooperation in the pelagic sector. By working together, national fishing organisations are reducing their assessment costs and collaborating to improve fishery management.
“It has been our longstanding intention to get our blue whiting fishery under MSC certification.” said Gerard van Balsfoort, president of the Pelagic Freezer-trawler Association, on behalf of all fleets concerned, “Now the stock is doing very well and the development of an effective management plan for this fishery is entering its final phase, we are confident that the MSC assessment can be concluded successfully.”
Early adopters
Suite : MSC Lire aussi RPA :Merlan bleu. Joseph Roty 2 : Un chalutier-usine chargé de douceurs (surimi)^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 15 Septembre 2014 Coquille Saint-Jacques. Les dates d'ouverture fixées avec les Anglais
Il aura fallu deux réunions, la semaine dernière, pour décider des dates d'ouverture de la pêche à la coquille saint-jacques, d'un accord avec les pêcheurs anglais et élire des représentants.
Jeudi dernier, c'est à Paris que se sont réunis les représentants de la commission interrégionale de pêche à la coquille saint-jacques. Le but ? Prendre les décisions en ce qui concerne les dates d'ouvertures, les quotas et les autorisations de pêche faites aux pêcheurs anglais.
Source :
Ouest France
« Comme l'an dernier, il a été décidé d'une ouverture en trois temps pour la pêche à la coquille en Manche, explique Alain Rigault, membre des commissions coquilles saint-jacques. La première ouverture aura lieu le 1er octobre et concernera la zone du large qui se situe au-delà d'une bande de 20 milles des côtes du Calvados. Le 3 novembre, c'est la bande située entre les 12 milles et les 20 milles des côtes calvadosiennes qui sera ouverte à la pêche. » Quant à l'ouverture de la pêche à la coquille en baie de Seine, elle est fixée au 1er décembre.
Les quotas seront de 1,8 tonne par débarque pour les bateaux de moins de 15 mètres, de 2 tonnes pour les 15-16 mètres et de 2,2 tonnes pour les plus de 16 mètres.
Terrain d'entente
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
À la une du marin du 12 septembre : la rentrée dans les hydros et les lycées maritimes
Le marin consacre son sujet d’ouverture à la rentrée, riche en nouveauté pour les futurs marins : une nouvelle répartition des rôles entre site de l’ENSM dans lesquels les cursus ont été rénovés, et lancement des BTS, premier diplôme d’enseignement maritime supérieur pour la pêche.
Également dans ce numéro du marin : la nomination du Maltais Karmenu Vella, commissaire européen chargé de la Pêche et des Affaires maritimes, également chargé de l'Environnement ;
Calendrier serré pour le zéro rejet ;
Pêche côtière. Sérénité à l'orée du chantier ;
Port-en-Bessin. La Coopération maritime en congrès ;
Bar. Pêcheurs et Ifremer lancent une nouvelle campagne de marquage ;
Les plaisanciers ne pourront plus pêcher des espèces interdites aux professionnels ;
Plan d'action pour la petite pêche côtière. La première mouture passe mal ;
les rangs de Blue fish s'étoffent ;
les enjeux maritimes de l’éventuelle indépendance de l’Écosse ;
Saumon fumé : Le thaïlandais TUF rachète Meralliance ;
Parc des Calanques. Les rejets de bauxite continueront ;
le rapport du bureau d’enquête maritime sur la perte des conteneurs du Svendborg Maersk ;
la construction chez Alumarine d’un bateau fluvial innovant ;
Biodiversité. La commission européenne prône la compensation ;
Thon rouge. Vers une baisse radicale de la pêche dans le Pacifique ;
Norvège. Saison record à la baleine ;
Acheter des quotas de baleines pour les protéger ;
Embargo russe. Les pêcheurs peuvent reporter leurs quotas sur 2015;
le recours de WPD concernant le parc éolien des Deux îles ;
Gens de mer. Situation tendue à l'Agism ;
Xynthia. Cinq semaines de procès aus Sables-d'Olonne ;
les menaces qui pèsent sur le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
le frégate "Hermione" prend le large ;
Chris Miller, pêcheur-photographe ;
un dossier sur le salon du Grand Pavois…
Cliquer
Ici pour lire le Marin ou aller dans le
Kiosk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 11 Septembre 2014« L’Écosse doit-elle devenir un pays indépendant ? »
Avis engagé de Christian Allard... Analyse du Marin... Pêcheurs écossais partagés...
En Écosse, un Bourguignon en première ligne pour l’indépendanceChristian Allard a ouvert le bureau de Tradimar Stef à Glasgow, une société française impliquée dans le transport du poisson... Ce bourguignon installé depuis trente ans en Ecosse, s’est fait élire député indépendantiste.
En mai 2013, le nouveau député nationaliste domine le château de la Reine, à Edimbourg. Et porte son premier kilt, celui du clan Ross.... (Photo Paris Match :
"Vive l'Ecosse libre" - Un Français élu député indépendantiste)
Christian Allard est le seul Français député nationaliste au Parlement écossais. Ce Bourguignon débonnaire de 50 ans, installé depuis 30 ans en Écosse, ne cache pas son enthousiasme à l’idée de voir en septembre ses rêves d’indépendance se concrétiser.
Ce député du Parti national écossais (SNP), visage rond, accent frenchie et regard pétillant dissimulé derrière des lunettes de vue, mène campagne avec bonne humeur et décontraction en faveur du oui au référendum d’autodétermination du 18 septembre qui scellera le destin de l’Ecosse.
«Je suis venu à Glasgow il y a une trentaine d’années pour ouvrir un bureau pour une société française (Tradimar Stef dans le transport du poisson NDLR) et je suis tombé amoureux du pays et de ma femme, une Écossaise de Glasgow. Trois filles et deux petits-enfants plus tard, me voilà à Aberdeen, j’y habite depuis 20 ans et je suis membre du Parlement écossais à Edimbourg», résume, amusé, ce quinquagénaire aux tempes grisonnantes qui a travaillé pendant des années dans le transport et l’exportation de poissons.
C’est sans parler un mot d’anglais - il a arrêté l’école à 14 ans - qu’il a découvert ces vertes contrées, loin de sa Bourgogne natale.
«Je pensais rester seulement un ou deux ans et peut-être aller ensuite sous des climats plus favorables, mais j’ai été très bien reçu par les gens d’ici», explique celui qui a été le premier Français élu en mai 2013 au Parlement écossais. Toute personne vivant et travaillant en Écosse peut se présenter à cette instance régionale, sans condition de nationalité.
«Nous avons beaucoup de ressources naturelles, des châteaux formidables pour le tourisme, le whisky bien sûr, la pêche. Les eaux territoriales écossaises ont beaucoup de pétrole, nous n’aurons aucun problème après le vote du oui pour obtenir plus de 90% du pétrole et du gaz naturel qui sortent de la mer du Nord», martèle-t-il, serein.
Son travail auprès des pêcheurs a été fondamental dans son engagement en faveur de l’indépendance.
«Nous sommes un pays agricole, de pêche. Aujourd’hui, pour obtenir davantage de subventions, il faut convaincre Londres avant Bruxelles. Eh bien, je peux vous dire que c’est plus facile de convaincre Bruxelles! Si Westminster travaillait pour nous, je n’aurais aucune raison de vouloir que l’Écosse devienne indépendante.»
Et d’ironiser sur la campagne «très très négative» du non qui lui «rappelle beaucoup Astérix (et sa formule) le ciel va nous tomber sur la tête si nous votons yes.» Cramponné à son optimisme, il confie qu’après la victoire du oui, dont il ne doute pas, il sera «très fier de devenir Écossais».
Extrait de l'article de Libération :
En Écosse, un Bourguignon en première ligne pour l’indépendance
Sous-marins, pétrole, pêche : les menus problèmes que l'indépendance de l'Écosse poserait à Londres
« L’Écosse doit-elle devenir un pays indépendant ? » C’est à cette question que répondront les électeurs écossais, le jeudi 18 septembre.
Source :
Le Marin Rappelons que l’Écosse, rattachée au Royaume-Uni depuis 1707, en comprend un tiers du territoire, 8,4 % de la population et presque 10 % du produit intérieur brut. L’indépendance, réclamée par le parti de centre gauche Scottish National Party (SNP) depuis sa création en 1934 (et désormais majoritaire au Parlement écossais), prend l'avantage
dans les récents sondages, provoquant la panique de David Cameron – à l’origine du réferendum - autant que celle des autres partis anglais, ainsi qu'un trouble certain à la City ou dans la Royal Navy.
La perte de l'Écosse est perçue à Londres comme un danger et une humiliation pour le Royaume-Uni, prolongeant la perte des colonies américaines en 1783, de l’Irlande en 1921, de l’Inde et de l’ensemble des « dominions » après la Seconde Guerre mondiale, puis de Hong Kong en 1997.
Sans compter le reproche qui pourrait être fait au Premier ministre anglais dans certaines capitales étrangères - à commencer par Madrid - d'avoir ravivé le feu autonomiste de certaines régions avec une perspective réelle de parvenir à leurs fins.
Les enjeux maritimes sont nombreux dans la question écossaise....
(...)
Autre enjeu maritime, la pêche. L’indépendance rebattrait les cartes à plusieurs points de vue. De manière très directe en bouleversant le système national de quotas mis en place. De plus, la comptabilisation séparée des flottilles devrait montrer que celle de l'Écosse est surdimensionnée, à l'inverse de celle du reste de la Grande-Bretagne.
Deuxième étage à la fusée, la question du maintien de l'Écosse au sein de l'Union européenne. Et donc de sa soumission au système communautaire de gestion des pêches. Le SNP assure que l'Écosse deviendra automatiquement membre de l'Union. L'ex-président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, avant de quitter son poste, sans doute soucieux d'aider Londres (et Madrid, face aux revendications basque ou catalane), avait pour sa part promis aux Écossais le purgatoire d'un passage par la case "candidature à l'adhésion".
Les sujets "pêche" de l'Écosse seraient-ils alors traités comme ceux de l'Islande ou de la Norvège ?
Chez Pêcheurs de Bretagne, on indique que 14 navires en 2012, 12 en 2013, ont eu une activité dans les eaux écossaises. Il s’agissait l’an passé de 4 fileyeurs franco-espagnols et de 8 chalutiers Scapêche-Dhelemmes. Les captures ont atteint 14 500 tonnes pour 34,7 millions d'euros de ventes (estimation de Pêcheurs de Bretagne).
« La quasi-totalité de ce que nous vendons à Lorient vient d’Écosse, soit pratiquement 10 000 tonnes par an (poisson de grands fonds, lotte, merlu, lieu noir, merlan bleu…) pêchées par deux 46 mètres et cinq 33 mètres dont deux ex-Dhelemmes, pour 23-24 millions euros de ventes », résume Jean-Pierre Le Visage, responsable d’exploitation de l’armement de Mousquetaires.
Au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne, le secrétaire général Jacques Doudet estime qu’« au-delà de toute considération économique et environnementale, la sortie de l’Union européenne d’une Écosse indépendante entraînerait des conséquences en cascade. Des flottilles disparaîtraient ou se déplaceraient sur d’autres zones, provoquant des désordres économiques par effet de dominos. C’est ce qu’on avait observé en 2005, au moment de la fermeture du quota d’anchois et de l’interdiction des filets de grands fonds. »
A noter que si les pêcheurs britanniques, comme leurs homologues français, ont souvent été puissamment hostiles aux décisions de la Commission européenne, c'est la pêche qui est aujourd'hui prise en exemple pour plaider en faveur d'un refus de l'indépendance par certains membres conservateurs - donc unionistes - du Parlement écossais. Dans une récente déclaration, ils rappellent qu'au niveau national, la plus grande partie des captures des pêcheurs écossais est réalisée dans les eaux du reste de la Grande Bretagne. Et qu'au niveau communautaire, l'ouverture d'une négociation de quotas pour le nouvel État pourrait permettre à certains membres, tels que l'Espagne, d'en tirer avantage.
La gestion des pêches comme plaidoyer au service de l'Union européenne, qui l'eut cru ?
Les pêcheurs écossais sont entre deux eaux dans l'attente du référendum
"Un, deux, deux. Un, trois, quatre. Un, trois, six". Dans le plus grand marché d'Europe de poisson, à Peterhead, au nord-est de l'Ecosse, le vendeur s'époumone, égrenant les prix dans un froid qui transforme son souffle en buée.
Source :
Le Soir - Aberdeen (Royaume-Uni) (AFP)
Autour de lui, acheteurs en bottes jaunes ou orange virevoltent au milieu de la pêche du jour. En trois heures, six mille bacs de poissons blancs de la mer du Nord, cabillaud, aiglefin, lotte et colin essentiellement, sont partis, achetés par des chaînes de magasins, des restaurants ou des usines agroalimentaires à travers le continent.
Plus de 130.000 tonnes de poisson et de fruits de mer transitent chaque année par ce port, situé à 250 kilomètres au nord d'Edimbourg. Et les affaires marchent si bien que sa direction envisage de construire une criée plus vaste.
Mais une certaine anxiété a pris le pas ces derniers temps, à la perspective du référendum sur l'indépendance du 18 septembre. Entre ceux qui espèrent un avenir meilleur et ceux qui craignent des temps plus difficiles, l'industrie de la pêche écossaise navigue dans des eaux incertaines. "On ne sait pas comment ça se passerait en termes de bureaucratie, s'il y aurait des taxes imposées pour commercer avec l'Angleterre. Personne ne nous a rien dit. Rien du tout", explique Gary Mitchell, un grossiste qui vend 20% de sa marchandise en France et 80% en Angleterre. "Contrairement à ce qui se passe pour la France, il n'y a pas pour l'instant de papiers à remplir pour l'Angleterre. Avec l'indépendance, ce serait un grand bouleversement", ajoute-t-il.
- Industrie négligée -
La principale incertitude réside toutefois dans la quantité de poissons qu'une Ecosse indépendante pourrait pêcher. Les quotas de pêche de chaque pays sont déterminés par l'Union européenne à l'issue de négociations difficiles. En cas de scission du Royaume-Uni, personne ne sait ce qu'il adviendra des quotas écossais.
Le Parti national écossais (SNP), qui milite en faveur de l'indépendance, assure que le gouvernement à Londres néglige de toute façon l'industrie de la pêche, concentrée en grande partie en Ecosse, au profit d'autres secteurs. "Aujourd'hui, nous n'avons aucun contrôle sur l'activité de bateaux étrangers dans nos eaux. En tant que nation indépendante, nous pourrons fixer des règles à l'intérieur du cadre européen qui nous conviendraient", souligne Stewart Stevenson, député SNP au Parlement écossais.
Ce message trouve un certain écho auprès des pêcheurs, dont beaucoup vivent de la mer depuis des générations.
Peter Bruce, dont l'arrière-arrière-grand-père travaillait sur un baleinier, a vécu le déclin sévère de cette industrie. "A un moment, j'ai eu six membres de ma famille proche dans la pêche. Aujourd'hui, je suis le dernier. Tout le monde est dans le pétrole", raconte le capitaine du "Budding Rose". M. Bruce votera en faveur de l'indépendance, en particulier pour la proximité qu'elle offrira avec un ministre écossais de la Pêche.
Dans le camp d'en face, le président de la Fédération écossaise des pêcheurs, Bertie Armstrong, juge qu'une Ecosse indépendante ne pèserait pas du même poids sur la scène européenne et qu'à court terme cela risquerait d'être douloureux pour les pêcheurs de la région. Actuellement, ils pêchent de 20 à 30% de plus que leur quota, en rachetant ou louant des quotas à l'Angleterre et au Pays de Galles. Mais cela n'est possible que parce que cela fait partie du quota global du Royaume-Uni.
"Que se passera-t-il si cela s'arrête?" s'interroge-t-il.
Il doute en outre qu'une Ecosse indépendante ait suffisamment d'autorité pour obtenir les mêmes quotas qu'actuellement. "On peut se sentir plus à son aise à négocier pour soi en tant que petit pays, si on veut peser davantage qu'un insecte, il faut être un poids lourd", dit-il.
Avec des eaux plus poissonneuses ces dernières années, l'avenir promet d'être rose, mais encore faut-il, indépendance ou non, que cette industrie ne soit pas abandonnée, réclame simplement M. Bruce.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 10 Septembre 2014Karmenu Vella en charge des Affaires maritimes, de la Pêche et... de l'Environnement
Le président élu, Jean-Claude Juncker, a dévoilé aujourd'hui son équipe et la nouvelle organisation de la prochaine Commission européenne. Il a désigné le maltais Karmenu Vella au poste de commissaire chargé de l'environnement, des affaires maritimes et de la pêche...
Photo de Karmenu Vella (wikipedia)
Un certain nombre de portefeuilles ont été remaniés et simplifiés. Ainsi, les portefeuilles Environnement et Affaires maritimes et pêche ont été combinés et placés sous la responsabilité d'un seul commissaire, à savoir le maltais Karmenu Vella. Un regroupement qui selon la Commission doit « refléter la double logique de la croissance « bleue » et « verte ». Les politiques en matière d'environnement et de protection de la mer peuvent et doivent jouer un rôle clé dans la création d'emplois, la préservation des ressources, la stimulation de la croissance et la promotion de l'investissement. La protection de l'environnement et le maintien de la compétitivité doivent aller de pair, car tous deux sont les gages d'un avenir durable. »
Cependant, Karmenu Vella n’aura pas la responsabilité des Energies marines renouvelables (EMR) qui relèvent du portefeuille de l’espagnol Miguel Arias Cañete, commissaire responsable de l’action pour le climat et l’énergie. La commission précise que « l'UE doit renforcer la part des énergies renouvelables sur son territoire, non seulement pour mener une politique responsable de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi – et c'est un impératif pour la politique industrielle – pour continuer à disposer d'une énergie à un prix abordable sur le moyen terme. »
Dans la nouvelle organisation de la Commission européenne présentée par Jean-Claude Juncker, le nouveau Commissaire chargé des affaires maritimes, de la pêche et de l'Environnement, dépendra de la Vice-Présidence « Union de l’énergie ». Piloté et coordonné par la slovène Alenka Bratušek, le programme « Union de l’énergie » implique plusieurs commissaires, en particulier les commissaires chargés du Climat et l'énergie, du Transport et de l'espace, de l'Agriculture et du développement rural, de la Politique régionale, du Marché intérieur, de la Science et de l'innovation, de l'Industrie, de l'Entreprenariat et PME...
Pour plus de détails sur la nouvelle commission, lire le communiqué de presse :
La Commission Juncker : une équipe forte et expérimentée pour faire bouger les chosesLes 28 membres de la Commission européenne
![]()
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 9 Septembre 2014La Normandie, 2ème région de Pêche FrançaiseLa pêche normande anticipe le redécoupage des régions françaises...
La Normandie, 2ème Région de pêche maritime française !
et 1ère Région pour les coquillages !
Le saviez-vous ?
C'est ce qu'indique notre document "La Pêche de Normandie en Chiffres", lorsqu'on cumule les données des 2 régions Normandie...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 8 Septembre 2014
Baie de Somme : la pêche à la coque est ouverte
Depuis la marée de ce lundi matin, aux alentours de 6h30, plusieurs dizaines de pêcheurs à pied se pressent sur les plages de la Baie de Somme, notamment celle du Crotoy : c'est l'ouverture de la saison 2014 de la pêche à la coque.
Avec Michel Nicolay, représentant des pêcheurs à pied; Stéphane Pagnier, brigade nautique de Saint-Valéry-sur-Somme et Jean-Luc Bourgau, marin pêcheur/Reportage de Arrantxa Belderraïn et Benoît Henrion
Les règles de la pêche à la coque sont strictes :
- pour les pêcheurs professionnels, 128kg par jour et par personne (contre 90kg en 2013, tombé à 60kg en raison de la pauvreté du gisement);
- les particuliers ne pourront eux pêcher que 5kg par jour et par personne.
La pêche est autorisée du lundi au vendredi et interdite week-end et jours fériés dans un périmètre défini par un arrêté préfectoral périmètre autorisé. Enfin, la taille minimale de pêche des coques est fixée à 30 mm.
L'année dernière, la pêche n'avait duré que 2 mois: le gisement, trop pauvre en individus prélevables, avait entraîné la fin anticipée de la saison.
Deux années difficiles
Après deux dernières années compliquées pour les pêcheurs à pied, à cause de la mauvaise qualité et quantité des coques, celle-ci s'annonce assez prometteuse.
Principale destination de ces coques : les conserveries espagnoles, où on est très friand de la denrée.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 6 Septembre 2014Je veux faire la pêche...La “Rentrée passion” de Yoann au lycée maritime du Guilvinec en grand format sur M6Ce dimanche 7 septembre, Yoann Le Gal sera l'un des “sujets” du reportage diffusé sur l’émission 66 minutes : grand format.
Mardi 2 septembre, Yoann Le Gal et Marc Garmirian dans la salle de ramendage du lycée maritime au Guilvinec.Mardi 2 septembre, Yoann Le Gal et Marc Garmirian dans la salle de ramendage du lycée maritime au Guilvinec.
Source :
Côté Quimper
Yoann Le Gal vient du collège Alain de Crozon. À tout juste 15 ans, il est l’une des 52 nouvelles recrues du lycée professionnel maritime du Guilvinec qui ont fait leur première rentrée dans l’établissement ce mardi 2 septembre. Il a intégré l’internat du lycée et une classe de seconde pro CGEM “Conduite et gestion des entreprises maritimes” pour devenir marin pêcheur.
Je veux faire la pêche.
C’est une passion qui a germé lentement au fil des ballades et des rencontres sur les quais de Camaret et qui s’est affirmée en 4e quand Yoann a déclaré à ses parents : « Je veux faire la pêche ! ». Marc Garmirian, reporter de l’agence CapaTV, a suivi Yoann depuis le week-end dernier, en famille, préparant ses fournitures et ses équipements scolaires, jusqu’à ses premiers pas dans l’établissement aujourd’hui et ses premières réactions…
Sur M6
Le documentaire de 40 minutes, fait le portrait de quatre jeunes dont Yoann, qui font leur rentrée des classes dans des établissements hors du commun, liant passion et parcours scolaire. “Les rentrées passions” sera diffusé dans l’émission 66 minutes : grand format, présentée par Xavier De Moulins sur la chaine M6, dimanche 7 septembre à 18 h 40.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dans le marin du 5 septembre 2014, Essor du pescatourisme malgré les blocages
La pêche attire les touristes, des études viennent le prouver. Pour un territoire, c’est un atout plus fort qu’avoir des sentiers côtiers ! Sans elle, le manque à gagner serait fort. La pêche rend ainsi service au secteur du tourisme et aux collectivités, qu’elle profite ou qu’elle subisse cet afflux estival…
Alors autant en profiter, car la demande pour du « tourisme d’expérience » est forte. De plus en plus de pêcheurs se mettent ainsi à embarquer des touristes à la pêche. Le pescatourisme décolle, depuis un à deux ans, en Aquitaine et en Méditerranée. Mais en Bretagne, les abandons sont nombreux face aux contraintes réglementaires.
On atteint malgré tout en France près de 80 pêcheurs pratiquant le pescatourisme, et l’essor devrait se poursuivre pourvu que certains blocages soient levés. Outre le profit, qui reste très modeste, l’intérêt est avant tout de communiquer auprès d’un public avide de mieux connaître la pêche, voire de l’interpeller sur son impact....
À lire, 3 pages sur le sujet dans « le marin » du vendredi 5 septembre, avec des témoignages.
Également dans ce numéro du marin :
Dieppe. Le principal armateur-mareyeur est amer ;
Thon rouge. Un application pour une traçabilité maximale ;
Préfecture maritime. Mission bien remplie pour le vice-amiral Labonne à Brest ;
Baltique. Proposition d'augmenter de 31% les captures de hareng ;
Embargo. L'Europe interpellée par l'industrie de la pêche ;
Cap-Vert. Accors de pêche renouvelé avec l'Europe ;
Conchyliculture. Gérald Viaud réélu à la tête du CNC ;
Île-aux-Moines (56) : Un sit-in pour défendre l'ostréiculteur ;
900 000 euros pour aider les mytiliculteurs de Vendée et Charente-Maritime ;
Algues. L'agitation persiste autour du proet à Moëlan (Finistère) ;
Martinique. Un modèle d'"île durable" pour Royal ;
Méditerranée : Un accord-cadre pour préserver les zones humides ;
Languedoc. Des plaisanciers pris en infraction au thon rouge ;
l’Europe au secours de l’Italie pour la gestion des migrants ;
Cliquer
Ici pour lire le marin ou aller dans le
Kiosk (en ligne)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 4 Septembre 2014 Le jeudi 4 Septembre 2014 à partir de 15h
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 3 Septembre 2014La Grèce exsangue bazarde (aussi) son littoral Grèce : Carte des 90 plages mises en vente (source : Okeanews) « Toute notre vie, on s'est baigné, on a pêché, on vit encore maintenant sur cette plage et, du jour au lendemain, on nous la prend pour la donner à des investisseurs ? Ils sont devenus fous ! Et nos enfants, ils auront quoi comme héritage ? ». « On ne se laissera pas faire » martèle de son coté Petros Petrou,
homme d’affaire de la région qui croit savoir que la plage et plusieurs hectares aux alentours sont destinés à être loués pour 99 ans. « On a reçu cette plage et tout cet environnement de rêve de nos pères et grands pères. C'est un don de Dieu, on doit le préserver et le transmettre tel quel à nos enfants et petits-enfants ».
Source :
TV5 Monde Par Angélique Kourounis (à Athènes)
« La mer a son pays : la Grèce », disait joliment naguère un slogan touristique. Aujourd'hui, les deux sont partiellement à vendre. Alors que son gouvernement annonce un peu vite une sortie de la crise, la dette du pays continue de croître en valeur relative. Après les cures d'austérité dévastatrices de l'aveu même du FMI, l'heure est à l'accélération de la privatisation du patrimoine, littoral compris, l'un des rares de la Méditerranée jusqu'alors relativement préservé du bétonnage.
Généralement, sur les îles, il y a plusieurs grandes plages. Mais à Heraklia, dans les petites Cyclades, il n'y en a qu'une : c'est To Libadi. Une magnifique plage de sable très fin avec, tout au bout, un coin naturiste, quelques arbres qui donnent de l'ombre, une eau incroyablement bleue, très peu profonde idéale pour les enfants ou les nageurs paresseux.
Heraklia est le paradis de ceux et celles qui fuient les clubs bruyants, les plages aménagées et les bars et qui rêvent juste de silence, de soleil et longues baignades tranquilles. Ce bonheur sur terre est désormais menacé et Melpomeni Balsami, conseillère municipale, est bouleversée. Le Taiped, l’Agence chargée des privatisations, a mis en vente To Libadi avec 109 autres plages dans tout le pays. « Ceux qui viennent ici sont ceux qui n'ont pas envie d'aller dans les grandes Cyclades, s'indigne t-elle. Ce sont des gens qui veulent juste être tranquilles. Cette tranquillité est notre mode de vie. S’il construisent un grand complexe hôtelier, comme on le dit, pour nous, c’est foutu. »
Opacité
Comme plus de 200.000 personnes à travers le monde, elle a signé l’une des trois pétitions qui circulent actuellement sur le net. « Toute notre vie, on s'est baigné, on a pêché, on vit encore maintenant sur cette plage et, du jour au lendemain, on nous la prend pour la donner à des investisseurs ? Ils sont devenus fous ! Et nos enfants, ils auront quoi comme héritage ? ». « On ne se laissera pas faire » martèle de son coté Petros Petrou, homme d’affaire de la région qui croit savoir que la plage et plusieurs hectares aux alentours sont destinés à être loués pour 99 ans. « On a reçu cette plage et tout cet environnement de rêve de nos pères et grands pères. C'est un don de Dieu, on doit le préserver et le transmettre tel quel à nos enfants et petits-enfants ».
Se lamenter, c'est bien ; agir, c'est mieux. Georgos Beronis, agent immobilier à Naxos, la grande île toute proche, a l'esprit pratique. Il a essayé d’avoir plus de renseignements auprès du Taipeddans le but qu’une coopérative d’insulaires achète To Libadi et coupe court à tout investissement néfaste. « Ils ont refusé de me donner le moindre renseignement », tonne-t il. « Le jeu est truqué d’avance ! ».
La même chose est arrivée aux mairies qui ont voulu racheter la Générale des Eaux de Thessalonique en voie de privatisation .Le Taiped, qui n'a de comptes à rendre à personne et que personne ne contrôle, n'a tout simplement pas répondu à leur demande.
Sur la question des plages, sa porte-parole Maria Tsinaridou, jointe par téléphone, se veut pourtant rassurante. « Nous n’avons jamais mis ces plages en vente », affirme–t-elle. « On les a indiquées sur notre site car l’État nous les a transférées et nous y sommes obligés pour des raisons de transparence ».
Loin de rassurer les Grecs, ces paroles sont perçues comme une provocation. D’autant que bon nombre des ces plages se trouvent dans des régions classées Natura 2000, c’est à dire inconstructibles et protégées, tant par les lois européennes que nationales. Ainsi à Corfou, la célèbre île ionienne dans le nord-ouest du pays, le Taiped a mis en vente un terrain de 180 hectares près du site d’Issos pour en faire, là aussi, un complexe hôtelier avec des villas de luxe et un terrain de golf. Sauf qu'Issos est en plein sur un site Natura 2000, censé être protégée par la loi grecque et européenne.
Bétonnage
Complément d'informations : et très bon site :
Okeanews
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 2 Septembre 2014Embargo russe. Les pêcheurs européens interpellent Maria DamanakiSuite aux mesures de représailles prises par les occidentaux dans le cadre de la crise ukrainienne (1), la Russie a mis en place un embargo sur des produits alimentaires le 7 août 2014. Cet embargo concerne entre autre l'Union européenne, et ses produits : la viande, les produits laitiers, les fruits et légumes ainsi que le poisson. L'ensemble de ces produits, privé de débouchés à l'export, va donc se retrouver sur le marché intérieur avec des conséquences négatives sur les filières concernées.
Il n’y a pas que les agriculteurs européens qui exportent leurs produits en Russie :
* 125 millions d'euros débloqués par l'UE pour aider le secteur des maraîchers (2),
* La Commission européenne annonce des mesures d'urgence pour soutenir le marché dans le secteur du lait (3),
Il n’y a pas que les pisciculteurs norvégiens avec près de 100.000 tonnes de saumon exportées chaque année et qui semblent malgré tout s’en tirer (4) :
Le saumon norvégien s'en sort bien
Après l'annonce de l'embargo, les cours du numéro un du saumon, le Norvégien Marine Harvest, avait chuté de plus de 8%.
Un mois plus tard, les esprits se sont apaisés. Certes le prix du saumon a baissé depuis l'annonce des sanctions russes, passant de 40 couronnes (environ 5 euros) le kilo à 32 couronnes. Mais c'est la période où les poissons sont arrivés à maturité, et l'afflux de marchandises pèse sur les prix.
Et puis surtout le marché semble se rééquilibrer tout seul, note François Perrone, chef des opérations du marché spécialisé Fish Pool. "La Russie va devoir se tourner vers le saumon chilien, ce qui veut dire qu'il y aura moins de saumon chilien pour les Américains et les Japonais qui devront donc se tourner à leur tour vers le poisson norvégien", estime-t-il.
Il y a aussi les pêcheurs et les aquaculteurs de l’UE, rappelle l’organisation Europêche qui dénonce dans un communiqué du 29 août (5), l’inaction de Maria Damanaki, commissaire européenne à la pêche, face à l’embargo russe sur les produits de la pêche et de l’aquaculture. Europêche estime les exportations à 153.8 millions d’euros. Des saumons, des truites et des huîtres qui inévitablement vont se retrouver sur le marché communautaire...
A Boulogne, la société Deepfresh offre ses services aux acteurs du négoce surgelé pour décongeler une vingtaine d’espèces de poisson. Mais pas d'huîtres à décongeler !!! (6)
(6) PDM-Seafoodmag :
Deepfresh, pour du refresh^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 1 septembre 2014 Nouvel exemple du mépris à l'égard du monde la pêcheC'est en essayant de porter assistance à un voilier en difficulté que les marins du chalutier Célacante ont terminé sur les roches des Pierres Noires (le 22 mai dernier)...
Les images du chalutier échoué aux Pierres Noires et du voilier à quai au Conquet :
Chalutier Celacante échoué aux Pierres Noires
Merci braz !
dans Le Télégramme du 30 août 2014
C'est en essayant de porter assistance à un voilier en difficulté que les marins du chalutier Célacante ont terminé sur les roches des Pierres Noires (le 22 mai dernier). Au final, les plaisanciers s'en sont tirés mais les marins-pêcheurs y ont perdu leur outil de travail. L'autorité maritime a mis en demeure l'armateur de récupérer au plus vite son bateau. Ce qu'il a tenté à deux reprises, le navire sombrant à moins de 100 m du phare (à la mi-juillet). Aussi douloureuse soit-elle pour l'équipage et l'armateur Jean Porcher, l'affaire aurait pu en rester là. Mais la machine administrativo-judiciaire s'est enclenchée ; le Parc marin infligeant à l'armateur une contravention pour « occupation illicite d'un territoire naturel protégé ». Stricte application de la règlementation, en dehors de toute compassion et prise en compte du fait de mer. Merci braz ! Voilà comment des marins qui auraient dû être décorés, des hommes qui ont fait preuve de solidarité et de prévention de la vie humaine, s'en trouvent récompensés. Le message envoyé cet été par le Parc marin réduit ces pêcheurs professionnels à de vulgaires délinquants de l'espace maritime. Messieurs, mesdames qui croisez un navire en difficulté sur votre chemin, réfléchissez à deux fois avant de lui porter assistance dans le Parc marin ! A contrario, on n'a jamais entendu parler d'astreinte financière pour les épaves militaires qui croupissent et se détériorent, depuis des années, dans le cimetière marin de Landévennec, au beau milieu d'une zone Natura 2000.
Stéphane Jezequel
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dans le marin du 29 Août 2014, Cuvillier rend son tablier Faute de moyens dévolus aux enjeux maritimes dans le nouveau gouvernement, Frédéric Cuvillier a refusé d'y participer. Celui qui incarnait les sujets maritimes depuis le retour de la gauche au pouvoir renonce à poursuivre son action, rappelant ainsi la démission de Louis Le Pensec, il y a 31 ans.
Lire RPA (mai 2012) :
Pas de ministère de la mer !... Quelle place pour la pêche et la conchyliculture ?
À la une du marin du 29 août : la guerre des hydrocarbures en mer de Chine méridionale
Le marin consacre son sujet d’ouverture aux hydrocarbures de la mer de Chine méridionale. Les projets de forage de la Chine à proximité des îles Paracels suscitent un regain de tensions entre Pékin et Hanoi.
Également dans ce numéro du marin :
une étude alarmante sur les ressources marines,
l’abondance de raies brunettes dans le golfe de Gascogne,
le salon ostréicole de Vannes : Cap sur l'Australie et l'Irlande,
Fonds européens. L'accord français de partenariat adopté,
FranceAgriMer. 11,8 millions d'euros en appui à la filère pêche,
Languedoc-Roussillon. Disparition de Christian Bourquin,
Un chalutier heurte un vraquier,
Algues. Un projet d'élevage à Thau,
Sein. Les sabliers de l'Odet retirent leur projet d'extraction,
Pacifique. Le Japon veut réduire les prises de jeunes thons rouges,
l'Union européenne aide le Sénégal à renforcer son contrôle des pêches,
le renfort apporter à l’Italie pour sauver les migrants,
la collision entre un vraquier et un chalutier en Bretagne sud,
l’installation d’hydroliennes au Canada,
Cliquer
Ici pour lire le marin ou aller dans le
kiosk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 30 Août 2014
Avec l’installation de trois nouveaux professionnels, les pêcheursde Porquerolles veulent relancer la prud’homie, développer le pescatourisme et travaillent avec le parc pour la mise en place de la charte.
Eux-mêmes s'amusent du paradoxe… En pleine période de récession, où les petits métiers disparaissent, écrasés par l'industrie ou les réglementations, à Porquerolles, les pêcheurs, eux… se multiplient. Pas façon petits pains, n'exagérons rien ! Mais trois nouveaux pêcheurs dans une corporation insulaire qui en comptait quatre… ça fait quand même une sacrée différence.
Pierre Pironneau, dit « Pierrot », est l'une des figures du quai des pêcheurs. Il n'est pas le doyen. C'est « Sam »…
Mais Pierrot a assuré le maintien de l'activité sur le quai, car il est resté longtemps seul à vendre au public, quand ses autres collègues vendaient aux restaurants.
Depuis cet été : ils sont trois à vendre au quai, quatre aux restaurants. Sans compter la quinzaine de pêcheurs qui travaillent dans les eaux de Porquerolles.
« Ça relance l'activité »
Pas du tout inquiet de cette concurrence, Pierrot voit au contraire d'un très bon œil ce regain d'activité. «Ça peut être une bonne concurrence, ça permet une offre plus large sur le quai.Ça relance l'activité et permet de développer différents métiers. » Par « métier », il entend les différents types de pêche : casiers, palangres, filets fixes, gangui… qui procurent autant d'espèces différentes à proposer à la clientèle. « Tout le monde ne travaille pas en permanence, mais maintenant, il y aura sans doute du monde tout le temps. On a tout intérêt à ce que ça continue comme ça. On n'est pas inquiet, on travaille avec le parc national pour la mise en place de la charte, ils sont à l'écoute et nous aussi on est réceptifs à leurs préoccupations. Et puis, comme on est plus nombreux, on souhaite relancer la prud'homie. Pour fédérer les pêcheurs et relancer les lois anciennes faites par les pêcheurs pour les pêcheurs ».
« Je me suis tout de suite senti à ma place ! »
(...)
Jean-Paul Costes « Epaté par l'accueil »
(...)
Pierrot,pêcheur engagé
Ce Toulonnais, arrivé en 1990 sur l'île, était cuisinier sur des voiliers, et a navigué en transat'(lantique). « Et puis j'ai eu envie de me poser, pour que mes enfants vivent ici. » Employé par un ancien prud'homme « Jacques Guillaume qui m'a appris le métier », il est à son compte depuis 8 ans et vit avec sa famille, sur un bateau, au bout du quai. Très sensibilisé aux questions environnementales, il veut agir en ce sens. « Nous sommes acteurs de la pêche durable. Au niveau du comité local des pêches, nous avons d'ailleurs une charte interne pour limiter l'impact de nos métiers sur le milieu. »
Pierrot est également l'un des trois professionnels du Var à porter sur son bateau une balise Ifremer dans le cadre d'un réseau d'études sur les lieux de pêche.
« On a aussi en projet avec le parc, d'établir pour 5 ans, une zone de préservation de la ressource sur 12 hectares le long de l'une des côtes de l'île. » Autre projet « Développer le pescatourisme, pour faire découvrir notre métier au public et bénéficier ainsi d'un petit revenu supplémentaire ». Pierrot évoque enfin un rêve : « Organiser à Porquerolles, un grand rassemblement des pêcheurs des îles ! »
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 29 août 2014
En Europe, la pêche minotière a de beaux jours devant elle...
Danemark : La pêche durable deviendra-t-elle miraculeuse ?
Une nouvelle étude de la Commission de l’UE montre que les stocks de poisson augmentent significativement dans les eaux danoises. Dans la réforme de la politique commune de la pêche de 2013, un nouveau principe de gestion des populations a été inscrit dont le but est le rendement maximale durable (MSY - Maximum Sustainable Yield) :
Une interdiction de rejet en mer de poissons (discard) sera intégrée progressivement durant la période 2015-2019.
« Les nouvelles sont encourageantes aujourd’hui mais nous n’avons pas encore atteint les objectifs. Il faut entre autre introduire une interdiction efficace des rejets en mer. Les pêcheurs doivent avoir des quotas plus importants et qui prennent en considération les quantités de poissons qui étaient rejetées en mer. Il faut une pêche durable pour les poissons et pour les pêcheurs », explique Dan Jørgensen, le ministre danois de l’Agriculture.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le Marin
Reportage : En 10 minutes extraites de 3 jours de mer... Mise à l’eau quotidienne (filage) et récupération (virage) des filières, la sortie des crabes des casiers, chargement de la boëtte, immersion dans le vivier pour la débarque des crabes…
Embarquez avec le marin à la pêche au crabe au sud-ouest de l’île de Sein, à bord du caseyeur Notre Dame de Kerizinen II. L’équipage pêche le tourteau d’avril à décembre sur ce 24 mètres détenu en copropriété par le patron, Hervé Salaün, et le groupe Béganton.
Les sept marins veillent sérieusement à la ressource et à la qualité, par exemple en rejetant à l’eau aussitôt les crabes trop petits, trop mous (en pleine mue) ou grainés (portant des œufs). Ils espèrent que le label pêcheur responsable et le programme européen Acrunet aideront à reconnaître ces efforts et à tirer les prix vers le haut.
Le + : Reportage photographique de Solène Le Roux dans l'hebdomadaire
"le marin" publié le 22 août 2014.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 27 Août 2014 A la Une du "marin" le 22 Août 2014 : trop de conteneurs perdus en mer Les conteneurs sont principalement localisés dans les deux cadres à l'ouest de la carte (1)
Le marin développe dans son numéro daté du vendredi 22 août le sujet des pertes de conteneurs en mer. La France vient de saisir l'Organisation maritime internationale à ce sujet. Elle lui demande de prendre des mesures pour mieux prévenir ce type d'événement.
Egalement à la Une du marin cette semaine :
- un reportage de Solène Le Roux réalisé à bord du Notre Dame de Kerizinen II, un caseyeur de 24 mètres pêchant le crabe en mer Celtique. Ses sept marins veillent à la ressource et à la qualité.
Parmi les autres sujets à découvrir dans le marin :
- les dix propositions d'action pour la conchyliculture de la Charente-Maritime,
- Pêcheurs de Bretagne. Naissance de la plus grande OP française,
- TAAF : légine. Quotas en hausse,
- Débarquements. Douarnenez attire les espagnols,
- Algues. le projet de Moêlan-sur-mer en passe d'être validé,
- Aquaculture. L'écolabel ASC Franchit les 1000 produits,
- Pélagiques. le merlan bleu candidat au MSC,
- Moins d'algues vertes en Bretagne, davantage ailleurs,
- Paca. Cuvillier recontre les pêcheurs,
- Islande : mobilisation autour d'un cimetière de pêcheurs français…
Cliquer
Ici pour lire le marin ou aller dans le
Kiosk(1)
Les conteneurs perdus se rappellent aux pêcheurs
Source :
Cdpm 29 par René-Pierre Chever
A la suite des pertes de containers survenus lors des dernières tempêtes hivernales à bord du Svenborg Maersk, l’armateur a réalisé un levé bathymétrique au cours du mois de juillet dernier à la demande de la Préfecture maritime. Cette dernière a communiqué au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CRPMEM) de Bretagne une information concernant les zones où les risques de « croches » sont particulièrement importants pour les pêcheurs.
Cette information concerne l’ensemble des pêcheurs et plus particulièrement les chalutiers et les arts dormants....
Lire aussi dans le marin :
Pertes de conteneurs en mer : la France saisit l’Organisation maritime internationale^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 26 Août 2014Sous la Présidence "Hollande", le parcours de Frédéric Cuvillier s'est arrêté en Corse... (1)Frédéric Cuvillier: «Nous devons être les militants de l'enjeu maritime»
Frédéric Cuvillier est venu en Corse à l'invitation de Gérard Romiti, président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, pour faire le point sur les enjeux d'actualité de la pêche en France et en Méditerranée et ce dans un esprit de dialogue. Il a été accueilli par le maire de Bonifacio avant de continuer son périple dans l'île pendant deux jours.Alain Pistoresi
Source :
Corse Matin le 22 Août 2014
Frédéric Cuvillier, le secrétaire d’Etat chargé des transports et de la pêche a entendu, hier, les revendications des pêcheurs insulaires et a promis d’être leur ambassadeur auprès de l’Europe
Engagements pris, engagements respectés. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'Etat aux transports, à la mer et à la pêche, est un homme de parole. Il a tenu la promesse faite à Gérard Romiti, président du comité régional des pêches et du comité national des pêches maritimes et des élevages maritimes, en venant à la rencontre des acteurs et des représentants de la pêche insulaire à l'occasion d'une visite de deux jours sur l'île.
Première étape, hier, à Bonifacio, pour une rencontre qui se voulait conviviale avec les instances de la pêche insulaire, histoire de prendre la température à l'aube des futurs enjeux européens. Gérard Romiti a salué l'homme de dialogue, avant de donner le ton : « Aujourd'hui nous payons l'Europe de 2006, nous sommes arrivés à la date butoir. Il faut arriver à faire reconnaître la spécificité de la Méditerranée au sein de l'Europe ». Un constat partagé par le secrétaire d'Etat.
Dispositifs eurocompatibles
« Les pêcheurs français sont les bons élèves de la Méditerranée, ils s'inscrivent dans une démarche durable et responsable. Je me ferai leur avocat », a-t-il promis.
Quelques propositions ont été évoquées, notamment en terme de renouvellement de la flotte, via un dispositif de certification (l'équivalent d'un contrôle technique pour les bateaux). Mais Frédéric Cuvillier a aussi joué carte sur table : « Je resterai dans une démarche eurocompatible, c'est ma seule ligne de conduite, je ne vous laisserai pas partir sur des dispositifs qui vous rattraperaient, juste pour avoir la paix pendant mon mandat », a-t-il prévenu.
Le premier prud'homme de Bonifacio, Philippe Botti, a soulevé la question des aires marines protégées, « les pêcheurs ont fait beaucoup d'efforts et ils payent souvent le prix fort ». Concurrence déloyale de la pêche de plaisance, braconnage... Autant d'inquiétudes relayées auprès d'un Frédéric Cuvillier attentif.
Les enjeux de la diversification
Le secrétaire d'Etat à également rappelé son attachement à la formation et à l'esprit d'innovation des jeunes générations. Un message entendu par Thibault Étienne, à l'origine d'un projet pilote de pescatourisme lancé en 2010 à Bonifacio.
« La pluriactivité et l'écotourisme régleraient 90 % des problèmes de la pêche », estime ce jeune pêcheur, qui en a profité pour remettre au secrétaire d'Etat un projet en la matière, « on évoque nos problèmes mais on est aussi capable d'apporter des solutions ».
Diversification des activités, modernisation de la flotte, augmentation du nombre de kW par bateau... De nombreux points ont été soulevés durant ces deux heures de discussion à bâtons rompus. Au-delà des enjeux européens et de la vision d'avenir, étaient également évoquées les aides d'urgences.
Une aide exceptionnelle
« La pêche corse va très mal, il nous faut une bouffée d'oxygène. Si nous n'avons pas une aide d'urgence exceptionnelle, certains pêcheurs ne verront pas ces projets futurs », a prévenu Xavier d'Orazio, premier prud'homme d'Ajaccio. Présent lors de ces échanges, le secrétaire général de la préfecture a promis que la question serait examinée, précisant que l'intégration des pêcheurs au sein du dispositif d'aide aux socioprofessionnels, coordonné par le préfet de région à la suite du conflit de la SNCM, était « envisageable ».
Durant ces échanges courtois, Frédéric Cuvillier a su se montrer à l'écoute et a affiché sa volonté d'aller de l'avant. « Ne baissez pas le pavillon ! »,a lancé un ministre en ordre de marche.
Frédéric Cuvillier en déplacement en Corse-du-Sud :
"On apprend beaucoup de choses sur le terrain et en mer !"
Frédéric Cuvillier est venu rencontrer les acteurs et les représentants de la pêche insulaire. Le secrétaire d’Etat chargé des transports et de la pêche s’est rendu la veille à Bonifacio. Il a longuement échangé avec les professionnels. Les pêcheurs ont profité de la visite du ministre pour rappeler les difficultés que connaît la profession : Météo chaotique, tempêtes, inondations de l’hiver dernier, problèmes auxquels les professionnels ont été confrontés.
A Bonifacio, il a écouté les revendications des pêcheurs et promis d’être leur ambassadeur auprès de l’Europe. Des questions comme celles de la concurrence déloyale de la pêche de plaisance ou celle du braconnage ont également été soulevées. Frédéric Cuvillier a reconnu que les pêcheurs français en Méditerranée s’inscrivent dans une démarche « durable et responsable » et a promis de représenter les deux-cents pêcheurs et patrons corses au niveau de l’Europe. Quelques propositions ont été évoquées concernant notamment la modernisation de la flotte ou les aides d’urgence.
Vendredi, fin de matinée, le Secrétaire d’Etat s’est longuement entretenu avec Philippe Riera, président de la société Gloria Maris Corsica, dont il a visité les installations situées au large de la Parata aux Sanguinaires. Sur place,
il a également rencontré Antoine Aiello, directeur de Stella Mare, le centre d’études et de recherches de l’Université de Corse.Au milieu de l’après-midi de ce vendredi, Frédéric Cuvillier s’est rendu à la Collectivité Territoriale de Corse pour s’entretenir avec le président de l’exécutif Paul Giacobbi pour aborder le sujet de la SNCM.
J .F.
Gérard Romiti, président du Comité National des Pêches Maritimes et des élevages Marins :
"La pêche corse doit être vue comme un secteur économique"
Aux côtés du Secrétaire d’Etat durant sa visite sur les différents sites de Corse, Gérard Romiti, président des Comités National et Régional des pêches Maritimes a fait le point sur les différents points soulevés avec Frédéric Cuvillier, mais pas seulement.
Source :
Comité National des Pêches
- C’est important une telle visite ministérielle pour la pêche insulaire ?
- Très. Cela représente une certaine reconnaissance de notre spécificité méditerranéenne. Nous avons fait le point complet sur la pêche insulaire et surtout la mise en place de nouvelles mesures. J’ai aujourd’hui, en tant que représentant national et régional, le devoir de préparer l’avenir de notre profession, le futur des pêcheurs pour les vingt ans à venir. Il n’y a pas que les difficultés dues au mauvais temps ou aux grèves, il s’agit avant tout de mettre un terme à cette saignée, à cette disparition de nos pêcheurs. La pêche doit vivre dignement de son travail et l’on se doit de trouver les moyens, aussi bien avec la Collectivité Territoriale qu’avec le gouvernement et avec l’Europe. Avec la pêche et l’aquaculture, il faut que l’on puisse capter cette manne et à ce sujet, le ministre est avec nous, a condition de préparer quelque chose de solide, de bien ficeler nos dossiers pour qu’ils soient pris en considération.
Aujourd’hui, nous sommes un exemple en Méditerranée, car nos stocks ne sont pas en péril malgré les problèmes qui se posent ci et là dans certaines zones, comme par exemple l’oursin. En effet, A ce niveau, les pêcheurs ont payé le prix fort et vont continuer à le payer car si actuellement on ne les pêche plus que cinq mois durant, nous allons passer à quatre mois la saison prochaine pour permettre une meilleure reproduction. A ce propos, nous associons également le projet de Stella Mare, l’Université de Corse, Ifremer, nous allons faire en sorte de pérenniser les entreprises et les voir comme un secteur économique.
- Lorsque vous vous adressez au ministre, que pense-t-il de cette « désertification » de nos petits ports de pêche en Corse ?
- Le Ministre va faire en sorte de régler un certain nombre de problèmes liés à cela qui, il est vrai, touche la profession. A ce sujet, il sort du Conseil des Ministres et dit haut et fort : il faut qu’il y ait une ambition maritime française, surtout en Corse. Un certain nombre de points importants seront mis en place comme par exemple le Pescatourisme qui représente une valeur ajoutée d’importance. Il existe actuellement sur l’île une vingtaine de porteurs de projets qui seraient greffés sur un tourisme intelligent. Il s’agit là d’un excellent développement mais il va sans dire que le pêcheur doit pêcher 50% de ses revenus. C’est impératif. Mon rôle aujourd’hui c’est d’installer le pêcheur du futur sur le bateau du futur. Avec les nouveaux fonds européens, nous allons hypothéquer les 15 prochaines années. Le pêcheur professionnel sera la véritable sentinelle de la mer.
- Quelle est la situation actuelle de la pêche en Corse ?
- Les chiffres sont malheureusement inquiétants. Nous venons de perdre à ce jour une dizaine d’unités. Nous sommes actuellement 198 patrons sur les 1050 kilomètres de côtés et 42 ports de pêche. Voyez que ce n’est la pression de pêche qui a pu faire disparaître certaines espèces. Il y a autre chose. La Corse c’est 1500 tonnes de poissons et 70 tonnes de langoustes et crustacés. Il faut que ce secteur de la pêche soit vu comme étant un secteur économique. Une famille de pêcheurs en mer fait vivre près de trois familles induites à terre.
- Vous avez évoqué la pêche à la langouste ?
- Tout à fait. Nous avons évoqué ce sujet et notre plan de gestion porte ses fruits. Le retour au casier ne sera sans doute pas possible. Nous allons sans doute innover sur des filets qui soient bio dégradable. C’est à l’étude pou un meilleur respect de l’environnement. »
(1) Remaniement dans le gouvernement Valls : Ce mardi 26 août, François Hollande et Manuel Valls ont dévoilé la nouvelle composition du gouvernement, suite à la démission de Manuel Valls et sa reconduction au poste de Premier ministre. Concernant l'environnement, Ségolène Royal est maintenue à son poste de ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie. En revanche, Alain Vidalies est nommé secrétaire d'Etat aux Transports, à la Mer et à la Pêche. Il remplace Frédéric Cuvillier qui a refusé de continuer dans ses fonctions, malgré la demande du Président de la République et du Premier ministre.
Frédéric Cuvillier jette l'éponge, faute de «capacité d'action» face à Ségolène Royal
Dernier communiqué de presse en tant que Secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche : Blog Frédéric CuvillierLe secrétaire d'État aux Transports a renoncé à participer au gouvernement Valls II et sera remplacé par Alain Vidalies.
Source :
Le Figaro par Marc de Boni publié le 26/08/2014 à 19:51
«Dans la configuration qui m'a été proposée, j'estime ne pas disposer de cette capacité d'action et de l'autonomie nécessaire à la réussite d'une politique cohérente». Comme les trois autres ministres sortants Frédéric Cuvillier n'a pas attendu l'annonce du nouveau gouvernement Valls pour faire savoir les raisons de son départ. Celui qui avait accepté à reculons de travailler sous la tutelle de la ministre de l'Écologie Ségolène Royal a donc estimé ne pas avoir les marges de manoeuvres nécessaires pour accomplir sa mission.
En conflit avec sa ministre de tutelle sur plusieurs sujets et notamment sur l'écotaxe, Frédéric Cuvillier n'a jamais fait mystère de ses réticences à travailler avec Ségolène Royal. En avril dernier, François Hollande avait dû appeler lui-même à plusieurs reprises le secrétaire d'État sortant pour l'enjoindre d'intégrer l'équipe gouvernementale. Il avait finalement accepté en expliquant: «Il est difficile de dire non au président de la République».
Retour à Boulogne-sur-Mer
L'élu du Pas-de-Calais militait auprès du gouvernement pour obtenir un ministère qui lui soit propre. Il déplore ce mardi le manque d'envergure des attributions qui lu ont été proposées, «les infrastructures, les transports et la mer» devant être «la clé de voûte du pacte de solidarité décidé par le Président de la République», selon lui. Il reçoit sur ce point le soutien tardif d'une autre ancienne ministre, Michèle Delaunay.
Occupé par un séminaire dans sa ville de Boulogne-sur-Mer, le secrétaire d'État aux Transports raconte être tombé des nues en apprenant l'imminence du remaniement. Lundi, il confiait à la Voix du Nord : «Je sentais bien que quelque chose se tramait mais j'envisageais plus un remaniement technique que ce qui vient de se produire». L'unique membre du gouvernement à avoir obtenu de déroger à la règle du non-cumul des mandats pourra donc se consacrer à sa ville, comme il souhaitait le faire dès l'issue des municipales. Il s'en réjouit sur Twitter et dans dans son communiqué: «Je souhaite désormais consacrer toute mon énergie à une ville et à une région objets de mes passions»....
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 10 juillet 2014, ce sont plus de 700 bateaux pêchant le maquereau, allant du petit ligneur côtier au grand chalutier pélagique, qui sont entrés en réévaluation MSC. Au total, en 2013, ils ont capturé 450 000 tonnes de maquereau, soit environ 83% des quotas recommandés par le CIEM.
Source :
MSC
Ces pêcheries plurinationales se sont regroupées sous la Mackerel Industry Northern Sustainability Alliance (MINSA), un groupe créé pour répondre à la discorde autour du maquereau de l'Atlantique Nord-Est. À l’origine de ce désaccord, le dépassement continu du TAC (total admissible de captures) pour le stock de maquereau de l'Atlantique Nord-Est, qui a conduit, en avril 2012, à la suspension de la certification MSC pour toutes les pêcheries de maquereau d’Atlantique Nord-Est.
En se regroupant pour ne suivre qu’un seul audit de réévaluation, les différentes pêcheries montrent bien leur confiance quant à la résolution de ce désaccord. Ce rassemblement fait écho à un mouvement similaire qui a eu lieu en juin pour le hareng atlanto-scandinave.
La réévaluation concerne les pêcheries suivantes :
- Maquereau de l’Atlantique du Scottish Pelagic Sustainability Group (SPSG) (Royaume-Uni)
- Maquereau de l’Atlantique nord-est DPPO (Danemark)
- Maquereau IPSA d’Irlande
- Maquereau, chalut pélagique IPSG (Irlande)
- Maquereau, chalut pélagique, senne coulissante et ligne de l’Atlantique nord-est (Norvège)
- Maquereau de l’Atlantique nord-est de la Pelagic Freezer-Trawler Association (Pays-Bas)
- Maquereau de l’Atlantique nord-Est de la Swedish Pelagic Producers Organisation (Suède)
Une coopération unique
Ian Gatt du Scottish Pelagic Sustainability Group et coordinateur du MINSA a déclaré : "C'est un énorme engagement de la part du MINSA de se lancer dans une certification conjointe pour le maquereau, le poisson le plus précieux de l'Atlantique Nord-Est. Une telle coopération de cette échelle n'a jamais été vue de ce côté de l'Atlantique et démontre bien notre volonté de pêche durable et bien gérée pour le maquereau. Le MINSA se réjouit que FCI réalise l’évaluation de ce groupement de pêcheries compte tenu de sa solide expérience dans l’évaluation de pêcheries pélagiques".
"Cette coopération internationale est une excellente réponse face à cette situation difficile", précise Camiel Derichs, le directeur Europe du MSC, "En travaillant ensemble, ils améliorent la gestion de la pêcherie et font de réelles économies vis-à-vis du coût de l’évaluation MSC. Les pêcheries du MINSA sont à la pointe des meilleures pratiques depuis un certain temps. Il est bon de les voir poursuivre cette voie en décidant de se lancer ensemble pour la réévaluation MSC. Cette réévaluation montre bien que les pêcheries sont confiantes quant à la résolution de la situation autour du maquereau de l'Atlantique Nord-Est".
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La connaissance des engins de pêche permet de minimiser les impacts sur les fonds marins
Les engins de pêche utilisés pour capturer les espèces benthiques et démersales ont un impact variable sur les fonds marins. Comprendre les impacts directs et indirects des pratiques de pêche sur les habitats benthiques est important afin d’assurer la viabilité des océans de la planète.
Dans le volume 2, Chris Grieve et al. explore les meilleures pratiques de mesure, de gestion et d'atténuation des impacts benthiques de la pêche. L'examen porte sur un grand nombre d'engins de pêche les plus largement utilisés. Les auteurs y donnent une description de chaque engin et de son interaction avec l'environnement.
Historiquement, l'amélioration des engins de pêche visait à maximiser les captures. Aujourd’hui, pour répondre aux préoccupations de l'industrie et des ONG, la recherche se concentre davantage sur des modifications d’engins visant à minimiser les impacts sur les fonds marins et les prises accessoires.
Dans l’article, Analyse des impacts sur les habitats des engins de pêche mobiles et statiques qui interagissent avec les fonds marins, les auteurs écrivent : «Les travaux de recherche sur les habitats benthiques sont en plein essor et deviennent disponibles pour les décideurs et les gestionnaires de ressources. La prise de conscience de la nécessité de gérer activement les composants complexes des écosystèmes marins et de comprendre les impacts directs et indirects de la pêche augmente".
La classification des types d’engin de l’Organisation Mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture (FAO) est en cours d’actualisation pour intégrer les récents développements dans ce domaine et sera prochainement publiée. Parmi les améliorations récentes, nous pouvons citer les avancées en technologie de la fibre, la mécanisation de la manutention des engins, l'amélioration des performances des navires et la motorisation, le traitement informatique pour la conception des engins, les aides à la navigation et la détection de poissons.
Cette analyse, ainsi que trois documents publiés dans le
volume 2 des Séries Scientifiques, guident le MSC dans son développement stratégique sur les meilleures pratiques mondiales.
D'autres documents publiés sur la réduction des prises accessoires et les recommandations pour la gestion des stocks de saumon ont également joué un rôle important dans l'orientation de la Révision du Référentiel Pêcherie, un processus qui permet au Référentiel MSC de répondre aux meilleures pratiques scientifiques actuelles.
Dr David Agnew, directeur de l’équipe Référentiel du MSC déclare : «Pour vraiment apprécier les impacts mondiaux de la pêche, il est nécessaire d’augmenter la connaissance scientifique. Au MSC, nous révisons régulièrement nos Référentiels pour assurer leur rigueur et pertinence. Grâce à nos Séries Scientifiques, nous continuons de partager de nouvelles connaissances et contribuons à l'effort mondial de recherche sur la pêche durable ".
Le portail de recherche halieutique a été lancé en Novembre 2013 pour partager les connaissances scientifiques qui alimentent le Référentiel MSC. Le résultat de la révision du Référentiel sera publié le 1er Août 2014, intégré aux Exigences de certification des pêcheries MSC 2.0
Cliquer Ici pour télécharger le document "Review of habitat dependent impacts of mobile and static fishing gears that interact with the sea bed"Pour plus d’informations : MSC ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Consultation publique : Plan d'action pour le milieu marin
Programmes de surveillance des plans d’action pour le milieu marin en consultation du 22 août au 21 novembre 2014
Du 22/08/2014 au 21/11/2014
Source :
MEDDE
Le quatrième élément des plans d’action pour le milieu marin est le programme de surveillance. Il fait l’objet de la présente consultation du public qui se tient pour une durée de trois mois à compter du 22 août 2014. Ainsi, pour la ou les sous-régions marines de votre choix, vous êtes invité à donner votre avis sur le programme de surveillance sur la base d’un résumé accompagné d’un questionnaire.
La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 appelée « directive-cadre stratégie pour le milieu marin » conduit les États membres de l’Union européenne à prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
Cette directive environnementale développe une approche écosystémique de la gestion des activités humaines impactant le milieu marin, en lien avec les directives « habitats-faune-flore » et « oiseaux » et la directive-cadre sur l’eau. Elle vise à maintenir ou rétablir un bon fonctionnement des écosystèmes marins (diversité biologique conservée et interactions correctes entre les espèces et leurs habitats, océans dynamiques et productifs) tout en permettant l’utilisation des biens et des services marins par les générations futures dans une perspective de développement durable.
En France, la directive a été transposée dans le code de l’environnement (articles L. 219-9 à L. 219-18 et R. 219-2 à R. 219-17) et s’applique aux zones sous souveraineté ou juridiction française hors outre-mer, divisées en 4 sous-régions marines :
- la Manche – mer du Nord,
- les mers celtiques,
- le golfe de Gascogne,
- la Méditerranée occidentale.
Cliquez
Ici pour participer à la consultation publique
---------------------------------------
Herbiers = Zones de frayèresCes bateaux qui font couler de l’ancre
![]()
Considérés de manière souvent abusive comme un espace de totale liberté, la mer et les fonds marins souffrent chaque été d’une surfréquentation des mouillages forains ; ces parties de plans d’eau naturellement protégées des vents dominants où les bateaux de plaisance viennent jeter l’ancre, parfois pendant plusieurs jours.
Cette affluence est particulièrement sensible en haute saison dans le coeur marin du Parc national des Calanques où selon les derniers comptages (août 2013), près de 1 200 bateaux peuvent stationner simultanément sur un même site. Avec des effets dommageables pour l’environnement qui se manifestent non seulement en surface (rejets d’eaux usées et de déchets solides) mais aussi et surtout sur le fond (labourage dévastateur du coralligène et de l’herbier de posidonies par les ancres et leur chaîne).
Le week-end du 15 août n’a pas dérogé à la règle, attirant des centaines de bateaux à moteur et de voiliers dans les secteurs les plus emblématiques que sont les calanques de Sormiou et de Morgiou et les deux archipels du Frioul et de Riou.
Une situation préoccupante à laquelle l’établissement public gestionnaire du site classé entend remédier au plus vite en multipliant notamment les « mouillages organisés ». Ces amarrages collectifs dont les premiers exemplaires ont été mis en place au début de la décennie, permettent en effet de réguler la fréquentation en limitant à la fois le nombre de bateaux et la durée de leur stationnement, avec notamment la possibilité de rendre ce dernier payant.
Selon les sites concernés, ces points d’amarrage sont constitués de bouées de surface (identifiables à leur couleur blanche), de bouées immergées entre deux eaux ou encore d’arceaux sous-marins directement fixés à la roche. Mais si cette technique a fait la preuve de son efficacité, sa diffusion reste lente. Une cinquantaine de mouillages organisés sont aujourd’hui installés ou en passe de l’être entre le Frioul et La Ciotat mais la plupart restent concentrés autour de l’Ile Verte et de la calanque de Port Miou, alors que l’on dénombre près d’une centaine de mouillages forains en coeur de parc.
« Définir une politique d’organisation des mouillages est l’un des grands chantiers qui figurent dans la charte du parc, tient à rappeler Émilie Drunat, coordinatrice du Pôle usages et activités de l’établissement public. Mais cela ne peut se faire qu’en concertation avec les autres services de l’État comme la DDTM ou la préfecture maritime, les communes concernées, les plaisanciers et les professionnels du nautisme. Nous devons déterminer avec eux les conditions de gestion et d’utilisation de ces mouillages (s’ils doivent rester gratuits ou devenir payants) mais aussi nous assurer que la pression touristique que nous retirerons d’un site, ne viendra pas se reporter sur un autre jusque-là épargné. Et pour cela, il est nécessaire de mieux connaître et comprendre la fréquentation des calanques ».
(...)
-------------------------------
Plongeurs et plaisanciers: une si difficile cohabitation...
Malgré les bouées signalant leur présence, les adeptes de la chasse sous-marine ne se sentent plus en sécurité dans la mer. Vidéo à l’appui, ils dénoncent l’attitude irresponsable des plaisanciers.Source : Var matin
Des vidéos (à visionner ici ou là) à vous couper définitivement l'envie de vous mettre à l'eau. C'est la façon choisie par les adeptes de la chasse sous-marine pour exprimer leur peur de se faire découper en deux par un bateau à moteur.
Président de la Fédération de Chasse Sous-Marine Passion (FCSMP), l'Ollioulais Pascal Mathieu est catégorique : «Dans le Var, comme dans les Alpes-Maritimes, où qu'on plonge, après 9 heures du matin, on est en danger !»
Ferré par des leurres
La faute à un trop grand nombre de plaisanciers. Notamment l'été. La faute surtout à leur méconnaissance de la réglementation en matière de navigation à proximité d'une bouée signalant la présence de plongeurs.
Ne lésinant pas sur les moyens - «je pêche toujours avec deux bouées, plus mon embarcation semi-rigide» -, Pascal Mathieu ne compte pourtant plus le nombre de fois où il a frôlé l'accident. «Une fois, un plaisancier a failli me couper le bateau en deux. Une autre, un voilier m'a emporté une bouée. J'étais à moins de 15 mètres de distance. Quant aux pêcheurs à la traîne, plusieurs fois leurs leurres m'ont accroché la combinaison !»
Mais la palme revient sans doute aux pilotes de scooters des mers. «Certains se servent des bouées de chasseurs sous-marins pour effectuer des virages serrés», affirme Pascal Mathieu.
(...)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Pour sa dernière journée, le Festival international du film insulaire de Groix (56) met à l'honneur quatre documentaires sur les pêcheurs des îles du Ponant et d'ailleurs. Rendez-vous avec ceux qui ont le « sel dans le sang ».
Pendant 14 ans, le réalisateur Christophe Champay a suivi le patron pêcheur bellilois Jean-Noël André (notre photo), « dernier des Mohicans », représentant d'une pêche traditionnelle qui disparaît peu à peu. Pour preuve, après 50 ans de mer, il a raccroché les filets l'an dernier, même s'il n'a pu s'empêcher de racheter un bateau.
Le 28-minutes qui lui est consacré devait, au départ, n'être qu'une archive familiale (Jean-Noël André est l'oncle de l'épouse de Christophe Champay) mais le besoin de rendre hommage aux hommes de mer aura été plus fort. C'est Sophie Champay qui parle avec le plus d'emphase de son « tonton pêcheur, cinquième et dernier enfant d'une veuve de marin pêcheur », qui a consacré sa vie à l'océan et à la « chasse au poisson bleu. Il a le sel dans le sang ».
Métiers en voie de disparition
La sardine, trésor des îles du Ponant, c'est à la bolinche que Jean-Noël l'a attrapée toute sa vie. Un coup d'oeil à la « volaille » (les goélands) et cap sur le banc de poissons. En quelques instants, il faut positionner le bateau, dérouler un filet de 300 m autour d'une bouée et refermer la poche qui plonge à 70 m de fond avant de la remonter.
« Malheureusement, beaucoup ignorent tout ce qui se passe pour ramener le poisson dans l'assiette, regrette la nièce. Et lorsque tous les petits pêcheurs auront disparu, il nous restera quoi ? Le foncier : le caillou et de jolies maisons aux volets fermés... ».
Christophe Champay a déjà prévu de réaliser d'autres portraits de métiers en voie de disparition, « pour ne pas laisser disparaître la mémoire des pêcheurs »...
(...)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Traumatismes du marin
Dans l’entre-deux-guerres, La Rochelle a dénombré jusqu’à 2 500 marins pêcheurs en activité. Des parias qui survivaient sans congés, exposés aux déferlantes et à la maladie.
Ils sont originaires d'Auray, d'Etel, des îles du golfe du Morbihan, de Douarnenez, de Tréboul. Ils sont Groizillons, Sarzeautins, ou Lorientais. Tous Bretons, tous marins. Repoussés de leur région par la crise sardinière qui s'abat à la fin du XIXe siècle, ils vont constituer l'ossature des équipages des chalutiers industriels rochelais.
En 1909, le « Mars » a embarqué 63 hommes dans le roulement de ses équipages pour ses campagnes de pêche en haute mer. 80 % de ces inscrits maritimes sont Bretons. Ca n'est qu'un exemple parmi d'autres. La moyenne n'est pas moins faible à bord des « Tadorne », « Germaine », « Vénus », « Shamrock », « Suze-Marie », « Antioche », et autre « Cormoran »… Ces équipages se recrutent dans des ports peuplés de vieilles familles de pêcheurs. Des hommes expérimentés, rudes à la tâche, qui se retrouvent à 12 en moyenne sur ces unités qui vont forger le renom de cette filière rochelaise. La Rochelle est le premier port de pêche du golfe de Gascogne durant l'entre-deux-guerres, le second de France, derrière Boulogne-sur-Mer.
354 navires en 1920
En 1920, petites et grandes unités confondues, 354 navires sont armés au Vieux Port. Dix ans plus tard, ils sont près du double, et sur la période, la population des marins pêcheurs a augmenté de 135 %. Ils sont près de 2 500. Ce sont les grandes heures des armements industriels, notamment les Pêcheries de l'Atlantique du Norvégien Dahl, et les Chalutiers de La Rochelle, de l'Arcachonnais Castaing, deux grandes maisons qui, réunies, représentent 45 % de la flotte des chalutiers rochelais.
La survie des parias
Ces unités sont à la mer tout le temps, par tous les temps. Elles effectuent 16 à 20 marées par an, chacune d'une durée moyenne de deux semaines. La vie du marin ? Une survie de paria. L'armateur fournit une nourriture monotone, l'hygiène laisse à désirer. On se soulage par-dessus le bastingage et l'on s'alimente de pain, biscuit, haricots secs, conserves et poisson. Pauvres denrées évidemment, avariés pour l'essentiel après une semaine passée au large.
À terre, les cinq ou six tavernes du quartier Saint-Jean-du-Pérot sont autant de lieux de défoulement, durant les quelques heures de relâche permises. Certains s'empressent d'envoyer leur paie à la famille avant de risquer de l'engloutir au comptoir. Ce sont les mêmes qui trouvent chaleur et humanité à l'Abri du marin, ce foyer dont le restaurant Le Bar André, sur le Vieux Port, conserve aujourd'hui la mémoire gravée dans sa pierre de façade. Le marin y est écouté, il y lit son courrier, et se lave sans restriction d'eau douce...
(...)
La grande grève de 1963
(...)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Martinique : Filet dérivant
La pêche aux volants et aux balaous en danger ?
EUROPE. Une proposition d'interdiction totale de la pêche au filet dérivant, venant de Bruxelles, pourrait menacer l'avenir des professionnels spécialisés dans cette activité.
Source :
France Antilles par Christian Tinaugus
À coup sûr, c'est une proposition émanant de la commission européenne qui risque de provoquer un sérieux raz de marée dans le monde marin. Bruxelles prône en effet une interdiction de la pêche au filet maillant dérivant. Le filet maillant dérivant, c'est un filet équipé de nappes de filets, reliées ensemble à des ralingues, maintenu à la surface ou en dessous par le biais de flotteurs, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Ces filets sont déjà interdits au-delà de 2,5 km de long depuis 1992 ; et quelle que soit leur taille pour la capture des grands migrateurs (thons, espadons) depuis 2002. Mais ce sont des abus (en Italie notamment, au thon rouge) conduisant à des captures accessoires de mammifères marins, tortues de mer et oiseaux marins qui ont motivé l'Europe à décider une interdiction totale dès 2015.
En Martinique, à l'instar des pratiquants de la pêche estuairienne dans l'Hexagone, ce sont les marins pêcheurs spécialisés dans la capture de poissons « volants » (pêche saisonnière) ou de « balaou » notamment sur les côtes caraïbe et atlantique, qui seraient les plus pénalisés, au total une cinquantaine de professionnels. Il s'agit d'une pêcherie « très salvatrice » pour cette catégorie des gens de la mer. D'où l'inquiétude des responsables du secteur, sûrs et convaincus des dégâts collatéraux que causerait la décision européenne si elle était appliquée.
Lors de la dernière commission DOM, son rejet avait été clairement exprimé. D'autant que lors de sa consultation publique entre mars et septembre 2013, la commission européenne avait annoncé son intention d'évaluer la nécessité de revoir le régime d'encadrement des pêcheries exploitées au moyen de petits filets maillants dérivant (inférieurs à 2,5km), de mesurer l'impact sur l'environnement et notamment sur les espèces protégées.
Emplois menacés
Chez les responsables de la pêche, on redoute la conséquence d'une telle mesure : un très lourd impact socio-économique risquant d'entraîner l'arrêt d'activité pour une cinquantaine de professionnels à très court terme et près de 100 à l'horizon 2020, affectant 150 emplois directs et 200 à 300 emplois indirects.
Les représentants de la profession estiment que d'autres solutions sont possibles. Ainsi, le principe de régionalisation de la gestion des pêcheries européennes acté dans le cadre de la nouvelle politique commune de la pêche doit être appliqué en procédant à une consultation formelle des comités régionaux de pêche et entre organismes autorisés afin de déterminer les enjeux liés à l'usage du filet dérivant dans la région et les mesures correctives les plus appropriées à chaque zone géographique.
Les parlementaires et l'ensemble des politiques martiniquais ont été interpellés sur le sujet par le Comité régional des pêches. Le dossier est actuellement dans les mains du Comité national des pêches.
C.T.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 21 Août 2014Pêche : l’inquiétante chute des stocks de poissons en Europe
La quantité de poissons pêchés sur le Vieux Continent a été divisée par deux en trente ans. Du fait de la surpêche et de certains facteurs environnementaux, la ressource peine à se régénérer.
Source :
Les Echos par Joel Cossardeaux
L’Union européenne a beau durcir les quotas de pêche lancés à la fin des années 1990, rien n’y fait ou presque : le niveau des stocks de poissons, à plusieurs heureuses exceptions près, ne remonte pas. « Les résultats espérés ne sont pas au rendez-vous », indique Didier Gascuel, directeur du pôle halieutique d’Agrocampus Ouest et coauteur d’une toute récente étude sur l’évolution de la ressource dans les mers d’Europe (hors Méditerranée), publiée dans la revue scientifique « Fish and Fisheries » .
La morue de mer du Nord et de la mer Celtique, la sole du golfe de Gascogne et de la Manche Est, pour ne citer que les espèces qui intéressent le plus la France, sont toujours au plus bas. « Sur les 124 stocks soumis à quota, 49 sont toujours en diminution, autant sont à niveau constant et seulement 29 augmentent », détaille Didier Gascuel. La plie de la mer du Nord et le merlu, dont les biomasses ont triplé depuis dix ans, comptent parmi ces espèces rescapées de la surexploitation des mers d’Europe, laquelle a fait sentir ses premiers effets dès les années 1950.
Depuis, les pêcheurs ont fait amende honorable en réduisant fortement leur prélèvement. « Au cours des douze dernières années, la pression de pêche a été divisée par deux », rappelle l’étude. La quantité de poissons capturés équivaut aujourd’hui aux niveaux des années 1950. La tendance n’est sûrement pas à la hausse. Les experts scientifiques mandatés par l’UE préconisent pour le prochain Conseil des ministres européens de la Pêche, prévu fin novembre-début décembre, de diminuer en 2015 de 6,5 % les quotas de pêche par rapport à leurs recommandations de 2014.
Remarque : Les deux illustrations (Carte + Graphique) ne sont pas tirées de l'étude dirigée par Didier Gascuel, mais des données statistiques de la FAO sur les captures dans l'Atlantique Nord-Est. L'étude publiée dans « Fish and Fisheries » concerne aussi la Zone 27 de la FAO mais elle s'appuie sur l'état des stocks de poisson et non sur les captures...
Les effets du réchauffement climatique
Les dégâts causés par la surpêche ont été tels que les espèces risquent encore longtemps d’en payer les conséquences. « La restauration de la productivité des écosystèmes marins sera longue et complexe », juge l’étude. La raison ? « Le potentiel de reproduction naturel des stocks a été endommagé. Le recrutement a été divisé par deux en vingt ans », explique le directeur du pôle halieutique.
Un autre facteur « très inquiétant » joue, selon lui, sur l’évolution des stocks : les habitats côtiers, comme les zones de vasières, diminuent ou se dégradent. Or ces lieux sont essentiels dans le cycle de vie des espèces. S’y ajoute enfin le réchauffement climatique. Ce phénomène a un effet sur la qualité et la quantité du plancton qui constitue la base alimentaire des larves de poissons.
« Il faut s’intéresser sérieusement à ces impacts autres que la pêche, laquelle a fait beaucoup d’efforts et doit les poursuivre », estime Didier Gascuel. La France n’est pas le meilleur élève, mais elle s’applique. Elle n’a dépassé cette année ses quotas que de quelques dizaines de tonnes. Le développement d’aires marines protégées pour revenir à un bon état écologique des milieux marins est une autre réponse. Encore insuffisamment apportée par les Etats au goût des experts.
Cliquer
Ici pour accéder à l'étude dirigée par Didier Gascuel
"Fishing impact and environmental status in European seas: a diagnosis from stock assessments and ecosystem indicators"
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 20 Août 2014
Au fond, la baie se meurt
“Plonger dans la baie de La Baule, c’est à pleurer, s’emporte Eric Lauvray, président de l’association. Mais personne ne s’en préoccupe.”
Plusieurs signes inquiétants de dégradation de la baie sont venus troubler la quiétude de juillet. L'association Estuaires Loire Vilaine dénonce des fonds marins qui se meurent. Jean-Claude Ménard et Eric Lauvray qui plongent depuis trente ans en presqu’île, n’ont jamais vu des fonds aussi dégradés...
Source :
L'écho de la presqu'île par Christophe Lusseau
Des eaux vertes en juillet un peu partout ; certaines plages interdites momentanément à la baignade ; des secteurs de pêche à pied victimes d’une pollution indéterminée (le Traict du Croisic par exemple) ; une mortalité inquiétante de crevettes et autres plies… Les signes d’une dégradation du milieu maritime en presqu’île guérandaise ne manquent pas. Et les alertes récurrentes des membres de l’association Estuaires Loire Vilaine n’y font rien. “Plonger dans la baie de La Baule, c’est à pleurer, s’emporte Eric Lauvray, président de l’association. Mais personne ne s’en préoccupe.”
Les bars désertent
Créée il y a quelques années par deux plongeurs apnéistes, qui voyait les fonds marins du littoral se dégrader, Estuaires Loire Vilaine a, depuis, multiplié les études concrètes et scientifiques sur la disparition progressive des laminaires dans la baie. “Cette algue est l’indicateur numéro 1 de la santé des fonds, assure Jean-Claude Ménard, l’autre fondateur. Elles abritent et nourrissent les espèces. Lorsqu’elles disparaissent, elles sont remplacées par des moules qui colonisent les lieux.”
Et si crevettes et plies meurent, “c’est que l’oxygène produit dans la colonne d’eau autour des laminaires disparaît”. Sans crevettes et micro organismes, plus de chaîne alimentaire pour les poissons. “Les bars ont, par exemple, déserté les lieux”, note Eric Lauvray, qui les pêche en apnée depuis 30 ans.
Phyto ou algue
La couleur verte de l’océan, c’est le phytoplancton, qui se nourrit des nitrates (engrais) émanant des terres agricoles des bassins versants de la Loire et de la Vilaine. “Et quand ce n’est pas le phytoplancton, ce sont les algues vertes qui débarquent sur les plages.” Ces ulves, qui ont fait passer quelques nuits blanches aux élus ces dernières années, ne sont pas très loin. “Un peu au large et qui ne demandent qu’à être ramenées par la houle”, prévient Jean-Claude Ménard.
Mais si les algues vertes, c’est du concret, la dégradation des fonds l’est beaucoup moins. “Il faut venir plonger avec nous pour constater, alerte le président Lauvray. Il va falloir que chacun prenne ses responsabilités.” A commencer peut-être par les pêcheurs professionnels, “qui sont les premiers à voir que le poisson disparaît”.
Pollution silencieuse
(...)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La promotion médiatique d’un manifeste « écocapitaliste »
Cet article inédit est extrait du dossier «
Médias et écologie» paru dans le n°10 du magazine trimestriel d'Acrimed, Médiacritique(s)
Source :
Acrimed par Jean-Baptiste Comby, le 3 mars 2014
Le 24 octobre dernier paraissait le dernier livre de la navigatrice Maud Fontenoy, sobrement intitulé Ras-le-bol des écolos. Retour sur la façon dont les journalistes ont assuré la promotion de l’ouvrage – ou comment, sous couvert d’expertise et grâce à de solides relais médiatiques, les conceptions néo-libérales de l’écologie se propagent insidieusement dans le débat public.
On peut parler d’une médiatisation élevée relativement aux fortunes médiatiques moins heureuses que connaissent la plupart des ouvrages qui paraissent sur le même thème. Cependant, tous les médias n’ont pas relayé cette publication. Sans que le comptage soit parfaitement exhaustif, on a relevé, sur une période de dix jours, quatre interviews et trois références dans des médias nationaux généralistes de grande audience. Précisons également que ce sont des journalistes généralistes (dont le rôle est souvent plus d’animer et de présenter que d’investiguer), et non des journalistes spécialistes de l’actualité environnementale, qui ont participé à la promotion de ce manifeste pour une écologie « libérale » comme la qualifie Bruce Toussaint (I-Télé, 23 octobre 2013).
Cette forte médiatisation du dernier ouvrage commis par Maud Fontenoy montre, s’il en était besoin, qu’il n’est guère nécessaire d’avoir accumulé un savoir spécialisé pour faire office d’expert dans les médias généralistes. On sait depuis l’essai de Pierre Bourdieu, Sur la télévision, que le jeu médiatique aboutit régulièrement à consacrer des experts et expertises qui n’ont pourtant reçu aucun crédit dans le champ scientifique. Tant que le soi-disant spécialiste peut se targuer de quelques diplômes, de quelques ouvrages et d’une problématique qui va dans le sens du courant (des) dominant(s), il jouit aisément des révérences de l’élite des journalistes qui, par là même, l’érige en référence. Plus récemment, le documentaire Les Nouveaux Chiens de garde montrait de quelles façons les médias consacrent un microcosme d’experts à la botte des pouvoirs (économique et politique). Mais avec Maud Fontenoy, l’inconsistance des visages médiatiques de l’expertise, et leur subordination aux intérêts dominants, apparaît en pleine lumière.
Il y a en effet de quoi rester perplexe quand on met en parallèle les motifs de sa popularité, l’ambition de son message et la manière dont certains journalistes généralistes le relaient. Célèbre pour ses performances sur les océans [1], la navigatrice instrumentalise ce qui apparaît aux yeux de beaucoup comme des « exploits » pour s’instituer en égérie de la cause environnementale. Mais pas n’importe quelle égérie.
Médiacritique(s) n°10 (janvier 2014)
Dossier « Médias et écologie »
Les journalistes, l’écologie et le capitalisme
Le consumérisme vert, une nouvelle vulgate médiatique
Tartufferies médiatiques
La promotion médiatique d’un ouvrage « écocapitaliste »
France 2 s’enthousiasme pour le pétrole de schiste
Le Point et les éoliennes : retour sur un massacre
Hervé Kempf : « Adieu Le Monde, vive Reporterre »
Âgée de 36 ans, fille d’un chef d’entreprise ayant fait fortune dans l’immobilier, celle qui se propose de secourir la planète est complaisamment dépeinte comme une femme moderne, dynamique, entreprenante, positive, altruiste, consciente et réaliste. Sa fondation, qui mise sur l’éducation à l’environnement des plus jeunes pour, nous dit-on, regarder l’avenir — et ne surtout pas se retourner sur les éventuels faux pas d’un passé dépassé — lui permet ainsi de renouveler l’histoire qu’elle raconte aux journalistes. Ces derniers sont d’autant plus fascinés par cette ambassadrice ambitieuse de l’environnement qu’elle entretient des fréquentations dans le gratin tant culturel — Marion Cotillard, Læticia Hallyday et Luc Besson parrainent sa fondation — que politique (puisqu’elle murmurerait aux oreilles de Borloo et Sarkozy).
On pourrait comprendre, à défaut d’y souscrire, que les journalistes considèrent celle qui a traversé les océans comme un témoin légitime de leur dégradation. Passons donc sur le fait qu’ils l’interrogent sur l’importance de la protection des ressources maritimes, voire sur les vertus de la ténacité pour affronter des défis à la hauteur de ceux représentés par la destruction tous azimuts des écosystèmes naturels. Mais on se frotte carrément les yeux quand I-télé, France Info, Le Point, RTL ou Direct Matin en viennent à considérer Maud Fontenoy comme une experte des relations entre l’économique et l’écologique. Car on a beau chercher dans sa trajectoire : rien ne vient asseoir son autorité en la matière. Hormis ses deux années de droit et quelques suppositions [2], aucune trace d’une quelconque habilitation à défendre solidement l’idée selon laquelle, comme elle le répète de micros en micros, « le rentable peut-être durable ».
C’est pourtant cette « autorité » qui lui assure une certaine visibilité médiatique, et dont elle profite pour se livrer régulièrement à un plaidoyer en faveur d’un « capitalisme vert » [3]. Il est vrai que, si Maud Fontenoy a fait ses preuves, ce n’est pas seulement sur les océans mais dans les médias, puisqu’elle a animé une émission chaque matin, en août 2007, sur Europe 1, ainsi qu’une émission hebdomadaire sur LCI, en septembre de la même année.
On ne saurait laisser entendre que les journalistes dominants ne sont pas des gens sérieux, cultivés, rigoureux, et à qui « on ne la fait pas ». Ces qualités proverbiales de l’éditocratie auraient sans doute dû nous mettre à l’abri du coup de force symbolique de la navigatrice, (auto)proclamée experte de l’économie verte. Mais dans un monde médiatique habitué depuis plus de 20 ans à privilégier ceux qui savent peu sur tout à ceux qui savent beaucoup sur peu, il ne paraît plus incongru de demander très sérieusement à une aventurière des mers comment, selon elle, le capitalisme peut sauver la planète des périls écologiques....
Suite de l'article de Jean-Baptiste Comby :
Acrimed^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 18 Août 2014 Brest : la coquille infectée par une toxine inquiète les pêcheursDepuis le mois de mars 2014, le taux de toxine dans les coquilles explosent, empêchant leur consommation
Brest : les coquilles contaminées par une toxine
Reportage : C. Tempéreau, N. Corbard, J. Bénard
Les pêcheurs de coquille Saint-Jacques sont inquiets. L'hiver prochain, leur pêche pourrait en effet être compromise car les mollusques de la rade de Brest sont contaminés par une toxine produite par une algue.
Les coquillers sont à quai, au port de Brest. Et inquiets. En octobre prochain, ils largueront les amarres mais ne pourront pêcher de coquilles Saint-Jacques.
Infectées par une toxine
Depuis la fin du mois de mars, les coquilles sont contaminées par une toxine paralysante produite par une algue, la Pseudo-Nitzschia. On en trouve 700 mg par kilo de chair, alors que son taux devrait être inférieur à 20 mg pour que les Saint-Jacques soient consommables. Cette toxine provoque des troubles digestifs et neurologiques chez les consommateurs. Et contrairement à d'autres coquillages qui arrivent à s'en débarrasser rapidement, les Saint-Jacques peuvent rester toxiques pendant près d'un an.
Cette contamination était déjà apparue en 2004 et 2008 et interroge les pêcheurs qui se demandent pourquoi ce coquillage est plus impacté que d'autres. Des recherches scientifiques plus approfondies devraient être menées.
Besoins en recherche
Florian Breton, directeur de l'écloserie du Tinduff, estime que « la recherche sur la toxine devrait être davantage développée », afin de mieux comprendre son fonctionnement. Pierre Karleskind, vice-président de la Région en charge de la mer et du littoral, a rencontré lundi des pêcheurs brestois pour « faire le point sur les investissements nécessaires » afin de lutter contre la contamination de la rade. Il a évoqué la création, à la fin de l'année ou début 2015, d'un réseau de partenariats scientifiques des pêcheurs. « Il y a énormément d'organismes scientifiques en Bretagne, mais il faut mieux les cordonner », précise l'élu.
Diversification de la pêche
Pierre Karleskind a également discuté avec les pêcheurs brestois des moyens pour les aider à se diversifier. « On a la chance d'avoir plusieurs espèces en rade de Brest », affirme Erelle Pellé. Elle souligne le retour, depuis une dizaine d'années, du pétoncle noir. En France, il n'existe que deux gisements de pêche pour ce mollusque, à Brest et à la Rochelle. Plusieurs pêcheurs brestois cherchent donc à valoriser et développer sa culture.
D'après les articles d'
Emilie Colin sur France 3 Bretagne et de Sarah Nattier dans Ouest France :
Finistère. La pêche à la saint-jacques menacée par une toxine^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 16 Août 2014Corse : Pêcheur de langoustes dans la baie d'Ajaccio
Source :
TF1
Loïc Terrier est pêcheur de langoustes dans la baie d'Ajaccio. "Un métier fabuleux à conseiller aux jeunes", estime-t-il. C'est une pêche traditionnelle qu'il pratique, une passion transmise par son grand-père, et qu'il perpétue dans son embarcation qui a 46 ans et qui ne l'a "jamais laissé en carafe". Le soir venu, il prépare ses menus avec Nadine, dans son restaurant, et sert ce met vanté depuis des siècles.
Mise au point
Langouste rouge : les pêcheurs veulent restaurer le stock européen
![]()
L’article paru dans le Télégramme : "
Langouste. Le sanctuaire sénan" et le Ouest-France du Vendredi 8 août 2014 tresse des couronnes au Parc Marin d’Iroise (PNMI) qui avec l’aide de l’Ifremer peut « désormais envisager l’avenir de la langouste rouge avec sérénité ».
Source :
CDPM 29 par René-Pierre Chever
Cet enthousiasme fait chaud au cœur. Cependant il aurait été de bon ton de le partager avec les autres acteurs impliqués dans la restauration du stock de langouste rouge : les pêcheurs et leurs structures professionnelles.
Le cantonnement de la chaussée de Sein a été mis en place en 2006 par les pêcheurs d’Audierne et leur Comité Local des Pêches, alors présidé par Guillaume Normand, (soit un an avant la loi instituant le PNMI). Roland Gargadennec, nouveau président, après la disparition en mer de Guillaume Normand, devenu depuis vice-président du Comité Départemental des Pêches Maritimes, a repris le flambeau et défend toujours ce cantonnement. Dès le début des années 2000 les pêcheurs d’Audierne ont eu le soutien du Comité local des Pêches Maritimes du Nord Finistère et du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne pour mettre en œuvre cette opération.
Les pêches expérimentales relatées dans les journaux sont couronnées de succès aujourd’hui grâce à la vigilance constante de la « communauté » de pêcheurs d’Audierne et du Conquet qui fait preuve d’une grande responsabilité en empêchant quiconque de braconner dans « leur » cantonnement. Comme le savent ceux qui doivent restaurer les stocks en mer « la gestion des pêches est un sport de combat ». Négliger cet aspect en ne rappelant pas l’implication des pêcheurs dans le maintien du cantonnement de la chaussée de Sein est une erreur. Nul contrôle du PNMI ne pourrait arriver à ce résultat basé sur l’auto discipline, le bon sens et le respect de la nature dans le cadre d’une pêche commerciale.
Après la mise en place de ce cantonnement spécifique les professionnels se sont lancés dans la mise en place d’un plan de gestion pour la langouste rouge, progressif et pratique. La Commission nationale gros crustacé a pris une première mesure d’augmentation de la taille commerciale de la langouste rouge en 2009. La limite inférieure du céphalothorax est passé d’une taille de 95 mm (poids total environ 550-600 grammes) à 110 mm (poids total environ 800-850 grammes). Depuis, toutes les langoustes inférieures à cette dimension doivent être rejetées à l’eau. Pour les spécialistes de la langouste c’est une perte immédiate importante, qui a été acceptée.
En 2012 la Commission nationale des gros crustacés a décidé une nouvelle mesure de préservation de la biomasse en interdisant la pêche les trois premiers mois de l’année. L’application de cette décision a été encore une fois possible sur l’ensemble de la façade Manche et Atlantique grâce à l’implication des structures professionnelles nationale et de terrain.
Ces dispositions ne sont pas parfaites...
Suite :
CDPM 29^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La pêche se réinvente
Le chalut Vigneron-Dahl et la chambre frigorifique constituent deux avancées majeures pour la flottille rochelaise. De nouveaux moyens pour augmenter la productivité.
Source :
Sud Ouest par Philippe Baroux - 16/08/2014
Bénéficier d'une position géographique enviable au centre d'un golfe de Gascogne regorgeant de poissons dits nobles, à chair blanche (raie, sole et merlu), est un atout certain. Tandis qu'en arrière du port se dessine une carte de France irriguée par un réseau ferroviaire des plus denses. Chargée dans le train, la marchandise rochelaise sera ainsi livrée le lendemain à Paris, Orléans, Vichy voire Toulouse, Avignon et Perpignan ; le surlendemain, à Lyon, Genève, dans le Jura ou en Alsace.
Un site bien placé et bien desservi. Dans la première moitié du XXe siècle, c'est sur ces bases, conjuguées à la diversité de ses débarquements et à la progression de la consommation de poisson frais, que le port de pêche de La Rochelle se construit, face à ses concurrents de la façade atlantique, Lorient et Arcachon, et sans rogner sur les plates-bandes du leader, Boulogne-sur-Mer, où sont travaillées des espèces différentes, hareng, merlan, et maquereau. La Rochelle expédie 13 800 tonnes de poisson en 1919, 35 700 tonnes en 1925 - année record (1).
Les panneaux divergents
Pour importants que soient ces éléments dans le rayonnement rochelais, ils ne suffisent pas, à eux seuls, pour expliquer la construction, d'une place forte de la pêche hauturière. On ne saurait prendre en compte cet élan rochelais sans mesurer toute la capacité créative des acteurs locaux de la filière. Lesquels conjuguent opportunisme et inventivité pour accroître les performances à la mer des chalutiers à vapeur et améliorer la conservation du poisson, deux autres clés du développement de la pêche industrielle dans l'entre-deux-guerres.
De la rencontre, en 1920, entre l'armateur rochelais Oscar Dahl, et l'ingénieur Jean-Baptiste Vigneron, va ainsi naître l'une des inventions majeures de la période : le chalut Vigneron-Dahl. L'engin de pêche va augmenter notablement la productivité des navires.
Armateur à Sète, Jean-Baptiste Vigneron a mis au point et breveté en 1912 une technique permettant d'ouvrir large la gueule du chalut tiré par un seul navire...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dans le marin du 15 août, Dix pays sanctionnés pour dépassement de quota
La Commission européenne a annoncé, le 11 août, les déductions sur les quotas de pêche 2014, pour sanctionner les dépassements en 2013. La France doit ainsi « rembourser » 18 tonnes de sébastes, 17 tonnes de flétan noir et 2 tonnes de plie : bien moins que les 554 tonnes d’églefin l’an dernier.
Les pays les plus sanctionnés sont le Danemark (7 851 tonnes, surtout lançons, puis maquereau et hareng) ; le Royaume-Uni (6 670 tonnes, surtout du maquereau, puis hareng et églefin) ; la Pologne (5 215 tonnes de sprat, et du saumon). À plus petite échelle (par ordre décroissant) : le Portugal, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France, l’Irlande et la Grèce.
Le nombre de déductions, qui concerne 45 stocks halieutiques, a baissé de 22 % en un an. La commissaire Maria Damanaki se félicite de cette amélioration du respect des quotas. Les déductions sont majorées en cas de « récidive », de dépassement supérieur à 5 %, ou de stock sous plan pluriannuel. Source :
Le MarinPour en savoir plus : communiqué de la commission du 11 août :
Lutte contre la surpêche: la Commission européenne annonce des déductions sur les quotas de pêche de 2014Tout le monde semblait satisfait de cette amélioration...
Jusqu'à la parution d'un article sur le sujet dans le Monde (20 août)« Les Etats n'arrivent pas à contrôler les quantités de poissons pêchés », dénonce Javier Lopez, biologiste marin au sein de l'ONG Oceana. Les dépassements sont particulièrement graves pour certains stocks d'aiglefin, considérés comme « épuisés » par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), une organisation scientifique indépendante, sans oublier les raies manta, espèces classifiées en « danger » par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
La situation n'est pas plus rose pour le sébaste atlantique, un poisson d'eau profonde dont la biomasse totale reste inconnue. L'année dernière la France en a pris dans ses filets 80 % de plus que les chiffres préconisés par les scientifiques. (ou 18 tonnes de surplus ou "pêche illégale" ndlr)Les dépassements de quotas 2013 seront déduits des quotas 2014
Cliquer
Ici pour télécharger le Poster "Tac et Quotas de pêche 2014"
La Méditerranée surexploitée
Un rapport de la Commission européenne rendu public en juin montre que la situation est plus grave en Méditerranée que dans l'Atlantique : « Au moins 96 % des stocks de poissons benthiques et au moins 71 % de stocks de poissons pélagiques comme la sardine et l'anchois y sont surexploités », constataient les auteurs.
« Les pays de la Méditerranée, comme l'Italie et la Grèce, ont toujours refusé de se soumettre à des plans de gestion durable de la ressource avec des limites de capture, explique Javier Lopez. Mais au lieu de contrôler les captures, on se contente de contrôler les nombres des bateaux, le nombre des jours de pêche et l'effort de pêche, voir la puissance du moteur du bateau... »
Les choses pourraient évoluer favorablement. Lors de la dernière réunion de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, en mai 2014, un accord a été signé entre les Etats riverains. Il prévoit l'adoption dans les prochaines années d'un plan de gestion avec des quotas de captures pour chaque espèce. Reste à savoir s'il sera respecté. d'après Le Monde :
L'Europe abaisse les quotas de pêche pour 2014 Pour plus d'informations sur la pêche minotière :
Seafish
Les autres sujets du marin :
* Les incidences de l’embargo russe sur l’économie maritime,
* La Toxine ASP qui menace les coquilles dans la rade de Brest,
* La lutte contre les fraudes de la filière des produits de la mer,
* Les dépassements de quota de dix pays européens,
* Thon. la SAPMER pâtit des prix,
* Surveillance. Le centre national monte en puissance à Etel,
* Les pêcheurs dénoncent l'abus d'autorité de Damanaki,
* Chalut : un faible impact révélé par caméra,
* Méditerranée. Des thons dans la lagune de Thau...
Cliquer
Ici pour lire le marin ou aller dans le
Kiosk
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Eurofish Magazine Issue 4 2014 (July / August)
July / August 2014 EM 4
Country profiles: Spain and IcelandCliquer Ici pour accéder à la publication
Spain
Spain: The Spanish fisheries and aquaculture sector is one of the largest in Europe by most measures; employment, production, fleet tonnage, value of output from the processing sector, or trade. The size of the sector meant Spain was also the largest recipient of aid from the European Fisheries Fund in the 2007-2013 programming period. Some of this aid has been used to reduce the size of the fleet to make it commensurate with the resource, while some has been used to fund fisheries local action groups, which are working to improve the economies of remote fishing communities. The popularity of fish in Spain (consumption per capita is the second highest in the EU) necessitates the import of approximately 1.5 m tonnes of fish and seafood each year. The processing industry uses domestic production as well as imports to produce a range of products for the Spanish market as well as for export, and has been successful at finding new markets even during the crisis years...
Iceland
The fisheries sector is a vital part of the Icelandic economy. It contributed 10.7% to GDP in 2013 and contributes to 42% of export value. The industry directly employs 9,000 people, 5.3% of the workforce, and the number of jobs in fisheries has risen by 25% in the past five years. The management of the industry is guided by extensive research on fish stocks and the marine ecosystems. The industry is governed by a system of individual transferable quotas (ITQs) that give each vessel a fraction of the total allowable catch based on the vessel’s history and species caught. Recent years have seen many companies merge and so the 50 biggest operators now account for 86% of the TAC, up from 74% in 2002. The 2013 fleet was made up of 1,700 vessels—decked, undecked and trawlers. The main species caught include cod, herring, haddock and capelin....
And...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 14 Août 2014 Thonier-senneur. Les tortues marines passent entre les mailles des filets géants Thonier-senneur "Glénan" en action de pêche sur
YoutubeLa pêche à la senne se déroule à bord de thoniers-senneurs, des navires puissants pouvant atteindre plus de 100 mètres de longueur, utilisant des filets (les "sennes") de plus de 1,5 km de long et ciblant les thons tropicaux. Afin d’optimiser les captures, cette pêche industrielle au thon utilise notamment des dispositifs de concentration de poisson (DCP), des systèmes flottants au milieu de l’océan servant à attirer les grands poissons pélagiques et particulièrement les thons tropicaux. Ces méthodes sont souvent accusées de générer des captures accidentelles importantes.
Les tortues marines passent entre les mailles des filets
Bonne nouvelle ! Dans une étude parue le 12 aout 2014 dans la revue scientifique
"Biological Conservation", publiée par Elsevier Science, un groupe de chercheurs de l’Ifremer, de l’IRD, de l’IEO et de l’AZTI ont pu affirmer que "l’impact de la pêche à la senne était très faible sur les captures des six espèces de tortues marines présentes dans les océans indien atlantique".
Souvent pointés du doigt au sujet de pêches accidentelles massives et catastrophiques, ces grands navires, les thoniers-senneurs, et leurs filets d'1,5 km de long, ne peuvent finalement pas être accusés de balayer les tortues marines sur leur passage en cherchant à pêcher les thons tropicaux.
Les scientifiques ont ainsi analysé 15 913 données collectées entre 1995 et 2011 par des observateurs embarqués à bord des thoniers-senneurs européens. Pour l’océan Atlantique et l’océan Indien, cela représente respectivement 10,3% et 5,1% de la totalité de cette activité de pêche réalisée pendant cette période. En parallèle, de 2003 à 2011, 14 124 observations liées aux dispositifs de concentration de poisson (DCP) ont été réalisées pour vérifier si les tortues étaient prises dans les filets des DCP.
Le résultat de l’étude n’est pas une surprise pour les chercheurs : "Globalement, l’impact de la pêche à la senne est très faible sur les captures des six espèces de tortues marines présentes dans ces océans. Seulement un petit nombre de tortues restent coincées dans les filets" explique Jérôme Bourjea, premier auteur de la publication. "En plus, 75% des tortues pêchées accidentellement ont été relâchées vivantes".
Pour plus d'informations sur les programmes auxquels la délégation Ifremer Océan Indien participe :
Article RPA :Les engins de pêche s'affichent en poissonnerie (obligatoire à partir de décembre 2014)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 13 Août 2014Vogue, vogue Prud’homie, nouvelle sentinelle Slow Food
"Sentinelle", reconnaissance ("label") de l'association Slow Food (1)
La Prud’homie méditerranéenne de pêcheurs, qui existe en France depuis bien dix siècles déjà, qui la connaît? Très peu de personnes… celles qui par chance ou par voisinage la côtoie… Alors que dire des étrangers, européens et au-delà !
Source :
Slow Food France
Pourtant, aujourd’hui où tout le monde s’accorde à dire que, dans le royaume de la production alimentaire, la pêche est le domaine le plus complexe, le plus difficile à comprendre et à gérer, celui pour lequel on ne sait pas par quel hameçon le prendre, voilà un modèle qui a fait ses preuves, qui colle au territoire, qui pérennise des savoirs et des métiers, qui permet de gérer les difficultés au cas par cas avec justesse et souplesse , sans apport des deniers du contribuable, et tout en assurant de vraies retombées économiques locales … Pourquoi donc est-il aussi largement méconnu et ignoré ?
En France, en ce qui concerne la pêche, la côte Méditerranée est découpée en « couloirs » marins se jouxtant les uns les autres. 33 couloirs pour être précis. Chacun de ces couloirs est géré par une communauté de pêcheurs, qui élit en son sein 3 à 5 prud’hommes, auxquels elle confère l’autorité de gérer et sanctionner l’activité de pêche, selon des règles établies par l’ensemble de la communauté. Ces règles donnent la priorité aux plus petits métiers, ceux dont la capacité de capture est la plus faible, pour « permettre à chacun de vivre de son métier », et aux techniques les plus contraintes dans le temps et dans l’espace afin « d’éviter qu’un métier n’en chasse un autre ». En limitant les droits d’usage par métier, les règlements poussent les pêcheurs à la polyvalence, leur permettant de laisser reposer alternativement les espèces et les zones, et de s’adapter aux variabilités de la ressource et de la demande sur le marché local.
![]()
Cette institution prouve, depuis dix siècles, que, contrairement aux idées reçues et promues par les adeptes de la privatisation des biens communs, la tragédie des communs n’est pas inéluctable. Au contraire, lorsque les conditions le permettent (l’attitude de l’autorité de tutelle et les conditions de marché jouant un rôle clé), l’on peut mettre en place une stratégie des communs, qui non seulement préserve la ressource, mais assure une juste répartition, en créant plus d’emplois, plus de vie et plus de culture sur nos territoires.
C’est pour cela que Slow Food est fière d’annoncer la création de la Sentinelle de la Prud’homie Méditerranéenne de Sanary, qui met l’accent sur un patrimoine immatériel incroyable et unique, et qui embrasse la complexité à travers la seule logique durable : une logique de territoires.
Notre objectif est de faire en sorte que plus personne – du public général à nos dirigeants français et européens – ne méconnaisse cette institution irremplaçable, et que les anciens qui incarnent ce patrimoine vivant en soient fiers chaque jour, afin qu’ils ne renoncent pas à passer le flambeau à la nouvelle génération. Nous voulons aussi aider les pêcheurs à tisser des réseaux locaux afin de renforcer les filières courtes.
Alors si vous en avez la possibilité, parlez-en à vos voisins, à vos élus locaux, nationaux et européens, et courez chercher votre poisson sur l’étal du patron pêcheur. Vous ne trouverez pas plus frais ni plus varié !
Infos pratiques: La taille des bateaux va de 5 à 12m. Chaque pêcheur de Sanary vend son poisson devant son bateau, place de la liberté sur le port, de 8h à 13h.
Plus d’informations sur la sentinelle Slow Food :
Prud'Homie de Sanary dans le Var
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Méditerranée. Les petits métiers au thon rouge apprécieront !
On pourra dire que pendant tout son mandat, Maria Damanaki aura été à la botte des ONGE anti-pêche...
A quelques semaines de son départ de Bruxelles (1), la commissaire européenne à la pêche le démontre une nouvelle fois en publiant sur son blog des conseils de pêche durable tendancieux :
« Pocket guide to your beach holidays ».
Des recommandations relevées par le marin du 8 août 2014 dans sa rubrique « ça ne manque pas de sel »
Extrait de « Pocket guide to your beach holidays » : « si vous passez quelques jours de vacances dans la région (Méditerranéenne ndlr), essayez par exemple d’éviter de manger du thon rouge alors que la saison de pêche est déjà terminée... » Ce qui est faux : les petits métiers disposent encore de quotas de pêche en Méditerranée !
Des recommandations pour les consommateurs qui « relèvent plus d'un représentant d'ONG environnementale extrémiste que d'un commissaire à la pêche de l'UE, » selon les organisations professionnelles qui ont vivement réagi, notamment en Espagne :
(1) Commission européenne : la presse relève que le ministre grec de la défense, M. Dimitris Avramopoulos, a été désigné dimanche candidat de la Grèce à un poste de commissaire européen. Selon la presse, le nouveau président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, qui connaît le ministre grec de la défense depuis plusieurs années, serait intervenu de façon décisive dans ce choix. Source :
Ambassade de France en Grèce (28 juillet 2014)
Pour suivre l'actualité de la pêcherie de Thon rouge (petits métiers) :Facebook Thon rouge de Ligne Beaucoup d'informations actualisées (régulièrement) et des vidéos....Le thon rouge suivi par satellites
CNES
Ajoutée le 24 juil. 2014
Des scientifiques de l'IFREMER tentent de mieux comprendre les déplacements du thon rouge à la surface de globe, une espace menacée dont les stocks sont en nette amélioration. Ils utilisent pour cela les fameuses balises Argos.
Crédits : CNES.
http://www.cnes.frPromotion en Poissonneries et Grandes Surfaces Les plus belles recettes^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 11 Août 2014
Fonds structurels : Adoption de l’accord de partenariat par la Commission européenne
Cet accord de partenariat détermine de quelle manière seront investis dans l’économie réelle de la France pour la période 2014-2020 des montants de 15,9 milliards d'euros au total pour la politique de cohésion (FEDER + FSE) et de 11,4 milliards d’euros pour le développement rural "Agriculture" (FEADER). La France bénéficiera d’une enveloppe de 0,588 milliard d’euros au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). L'adoption de l'accord de partenariat français par la Commission européenne lui permet désormais de travailler sur les programmes opérationnels régionaux et nationaux qui définissent les stratégies des régions et de l'Etat.
L’accord de partenariat avec la France, qui régit la mobilisation des fonds structurels pour la nouvelle période 2014-2020, a été adopté par la Commission européenne le 8 août 2014.
Cet accord est le résultat d’un an de concertation du partenariat national, composé de 350 organismes de la société civile, des acteurs économiques, des partenaires sociaux, des collectivités et de l’Etat. Le document soumis pour approbation à la Commission a été rédigé par l’Etat et les régions.
Il valide le champ d’intervention de la programmation 2014-2020 des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI)(1)
Priorités d’intervention
L’accord de partenariat acte les axes prioritaires d’intervention que sont notamment :
- les transferts de connaissance en R&D,
- l’amélioration de l’entrepreneuriat et de l’innovation dans les entreprises,
- l’amélioration de la compétitivité,
- la réduction de la pauvreté par un meilleur accès aux services et un soutien à l’économie sociale,
- ou encore l’amélioration de la qualité de vie des zones urbaines et rurales grâce à des projets intégrés avec forte implication des villes et un soutien de la transition vers une économie pauvre en carbone et en ressources.
Les accords de partenariat sont une nouveauté de la nouvelle période de programmation. L’objet de cette obligation réglementaire est de s’assurer que, comme leur nom l’indique, tous les partenaires ont été consultés et que les programmes font l’objet d’un consensus, qui devrait garantir une meilleure mise en œuvre.
Pour la première fois, ce sont les autorités locales, en particulier les conseils régionaux, qui seront chargées de la majeure partie de la mise en œuvre des FESI. Ce qui explique que l’accord concerne 75 programmes au total, d’une portée nationale ou régionale.
Budget
Pour 2014-2020, le montant total alloué à la France (FEDER et FSE) pour financer la politique de cohésion avoisine les 15,9 milliards d’euros (prix actuels), y compris 310 millions d’euros au titre de l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ). L’allocation spéciale aux régions ultrapériphériques représente 443,3 millions d’euros.
La part du budget des Fonds structurels et d’investissement allouée au FSE s’élève à 41,7%. Environ 31,7% de ce budget FSE sont affectés à l’inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté, soit au-dessus des 20% minimum requis.
L’allocation du FEADER a augmenté en France jusqu’à 11,4 milliards d’euros et sera essentiellement dédiée à l’augmentation de la compétitivité du secteur agricole et aux aspects environnementaux et climatiques propres aux zones rurales.
Enfin, la France disposera d’un budget de 588 millions d’euros au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
Concentration thématique
La France répond particulièrement bien aux objectifs de concentration thématique sur la recherche et l’innovation, les TIC, la compétitivité et l’innovation dans les entreprises ainsi que l’économie sobre en carbone puisque le minimum requis est dépassé.
Il en va de même pour la prévention et l’atténuation des changements climatiques, avec 37,1% d’allocation des fonds contre 20% requis. En ce qui concerne les actions intégrées pour le développement durable en milieu urbain elles dépasseront les 5% de part requise par le règlement Feder.
Avec cette adoption, les programmes opérationnels pourront à leur tour être adoptés par la Commission européenne dans les mois à venir.
Selon Johannes Hahn, commissaire chargé de la politique régionale : Le plan d’investissement adopté par la France aujourd’hui lui permettra de continuer à avancer sur la voie de la reprise économique et de la relance de la croissance dans les dix prochaines années.”
Selon Dacian Cioloș, commissaire chargé de l'agriculture et du développement rural : «Cet accord de partenariat avec la France constitue une avancée importante pour concevoir et mettre en œuvre une politique de développement rural réussie en France, pour favoriser la coordination et les synergies avec les autres Fonds de l’UE et ainsi améliorer l’efficacité des investissements. Disposant d’un grand potentiel et de nombreux atouts, l’agriculture française et ses zones rurales sont toutefois confrontées à des défis considérables. L’accord de partenariat reconnaît le rôle important que l’agriculture et l’industrie agroalimentaire peuvent jouer dans la relance économique, tout en créant les conditions pour protéger les ressources naturelles du pays et remédier aux problèmes sociaux dans les zones rurales. Il appartient maintenant à la France de proposer des plans de développement rural ambitieux, équilibrés et bien ciblés qui puissent offrir la possibilité aux agriculteurs et aux zones rurales de relever ces défis.»
Selon Maria Damanaki, commissaire européenne chargée des affaires maritimes et de la pêche : «Grâce au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), nous voulons créer les conditions qui permettront aux entreprises, communautés locales et pêcheurs français de rendre leurs activités plus durable sur le plan social, économique et environnemental. Nous voulons aider les secteurs français de la pêche et de l'aquaculture à renforcer leur compétitivité, stimuler l'emploi et la mobilité des travailleurs, et promouvoir l'efficacité des ressources. La France pourra ainsi contribuer à la croissance économique et créer les nouveaux emplois dont l'Europe a besoin.»
(1) Les FESI se composent du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen (FSE), du Fonds européen agricole de développement rural (FEADER) et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 8 Août 2014
ça va faire du bruit !!!
À la une du marin du 8 août : la mise en service du FPSO « Clov »
Le marin consacre cette semaine son sujet d’ouverture à la mise en service du FPSO Clov, unité de production, de stockage et de déchargement de gaz et de pétrole, sur le champ du même nom au large de l’Angola. Ce bijou technologique à plus de 5 milliards d’euros, est la quatrième usine du genre que Total met en service dans la région.
Également dans ce numéro du marin :
Maria Damanaki donne ses conseils de pêche durable ;
La colère des conchyliculteurs en Charente-Maritime ;
Rejets. Eviter la distorsion entre pêcheurs ;
Concarneau. La flotte compte un nouveau chalutier ;
Saumon : Résultats records pour Marine Harvest ;
Inde. 600 pêcheurs disparus après une tempête ;
L'écolabel MSC sera refusé en cas de travail forcé ;
Justice. Lourdement condamné, l'"Alphaver" va faire appel ;
La démarche de Planète mer auprès des pêcheurs de loisir ;
Greenpeace. L'"Arctic Sunrise" a quitté le port russe de Mourmansk ;
Le projet d’extension du canal de Suez ;
La volonté de Scania France de s’implanter durablement dans les moteurs marins ;
Découverte. Un océan enfoui dans le manteau terrestre…
Cliquer
Ici pour lire le marin ou aller dans
lekiosk (e-marin)
Pollution sonore marine : les preuves s'accumulent
Une nouvelle étude démontre l'impact négatif de la pollution sonore sur la survie des anguilles. Ces dernières semaines plusieurs publications ont rapporté des effets, jusqu'ici insoupçonnés, du bruit des navires sur les créatures marines
Longtemps ignoré des scientifiques, l'impact de la pollution sonore marine commence à être étudié avec intérêt. Et ses conséquences, parfois surprenantes, font l'objet de plusieurs articles dans des revues de référence. Il y a quelques semaines, nous évoquions déjà le bénéfice qu'en tiraient certaines espèces invasives et les effets délétères du bruit des moteurs de bateaux sur le lièvre de mer. Cette fois, c'est de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) qu'il s'agit.
Moins de réponses face aux prédateurs
L'étude est publiée dans la revue Global Change Biology par des chercheurs des universités d'Exeter et de Bristol, au Royaume-Uni. Elle démontre que les anguilles exposées au bruit que font les navires ont des difficultés à réagir face à une attaque de prédateur.
Ainsi, 50% des spécimens étudiés ne régissent pas ou peu lors d'une attaque et parmi celles qui le font, 25% ont un temps de réaction plus long. "Nos résultats démontrent que les événements acoustiques aigus, comme le bruit d'un bateau de passage, peuvent avoir de graves répercussions sur les animaux" insiste Steve Simpson, biologiste marin et auteur principal de l'étude.
Stress. Pour comprendre ce qui peut causer cette perte de comportement cruciale dans la défense contre les prédateurs, les chercheurs ont observé divers paramètres physiologiques. Ils ont ainsi trouvé que les anguilles exposées au bruit des moteurs avaient des niveaux de stress accrus se manifestant par une augmentation de la fréquence ventilatoire et un métabolisme accéléré.
En danger critique d'extinction
(...)
Relevés sismiques réalisés à coups de canons à air comprimés
Un village inuit veut bloquer la prospection pétrolière en Arctique
Cela «viole les droits fondamentaux des habitants du Nunavut», ce territoire autonome inuit du Grand Nord canadien, a affirmé l'avocat représentant Clyde River (Photo de Martin Chamberland)
Un petit village inuit de l'Arctique canadien a saisi lundi la justice afin de bloquer la prospection pétrolière qui doit être menée à coups de relevés sismiques au large de ses côtes, y voyant une menace pour la faune polaire.
Située sur la côte orientale de l’Île de Baffin, face au Groenland et à 2000 km du Pôle Nord, la localité de Clyde River doit assister au débarquement de navires de prospection pétrolière dès l’année prochaine grâce au feu vert accordé fin juin par l’Office national de l’Énergie du Canada (ONÉ).
Lors de consultations publiques préalables, les Inuits s’étaient inquiétés des dangers que feraient peser sur l’environnement ces relevés sismiques réalisés à coups de canons à air comprimés et, le cas échéant, la production pétrolière elle-même.
L’ONÉ, un organisme fédéral, avait d’ailleurs notamment reconnu l’année dernière que ces tests très bruyants devant permettre de cartographier en deux dimensions le sous-sol océanique « pourraient avoir des répercussions sur la baleine boréale ». Cela n’a toutefois pas suffi pour bloquer la demande de relevés sismiques déposée par trois sociétés: TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS), Petroleum GeoServices (PGS)et Multi Klient Invest AS (MKI).
Cela « viole les droits fondamentaux des habitants du Nunavut », ce territoire autonome inuit du Grand Nord canadien, a estimé dans un communiqué Nader Hasan, l’avocat représentant Clyde River.
« Étant donné que des relevés sismiques peu réglementés pourraient avoir des conséquences catastrophiques sur les communautés inuits, le village de Clyde River, l’association Nammautaq des trappeurs et chasseurs de Clyde River et le maire de Clyde River, Jerry Natanine, ont demandé à la cour d’appel fédérale de réviser la décision de l’ONÉ », est-il indiqué.
Les eaux convoitées par les groupes pétroliers sont riches en narvals, baleines boréales, morses et phoques, des mammifères marins qui « sont la base de l’alimentation et la culture inuit », écrivent les autochtones, jugeant que « les tests sismiques peuvent être fatals », notamment en « perturbant le chemins de migration » de ces animaux.
« Si les compagnies pétrolières nous enlèvent ça, il ne nous restera plus rien », a plaidé le maire de la petite localité polaire, Jerry Natanine.
L’Arctique contiendrait 22% des réserves d’hydrocarbures restant à découvrir sur la planète selon des estimations américaines datant de 2008, mais les promesses énergétiques nées du recul de la banquise tardent à se concrétiser: le géant norvégien Statoil a notamment renoncé à deux forages dans le Grand Nord depuis juin, car pas assez viables commercialement.
Ile d'Oléron : ils découvrent une balise américaine pour enregistrer les cris des baleines
Une balise américaine dévolue à l'enregistrement du cri des baleines a été trouvée ce jeudi sur la plage de Saint-Trojan (île d'Oléron). Des habitants de la commune, un père et son fils, ont fait cette découverte alors qu'ils se promenaient.
Source :
Sud Ouest par Yvon Vergnol
« Sur la balise, il y avait une plaque d'identité et un numéro de téléphone au Etats-Unis, que j'ai aussitôt appelé. C'est l'université américaine Cornell, dans l'Etat de New-York, qui aurait mis cette balise à l'eau à Boston à l'automne 2005, pour repérer à la fois les déplacements des baleines franches et enregistrer leurs cris », raconte le père, parfaitement bilingue.
Pour l'instant, on ignore si cette bouée de 47 kg est une bouée flottante et dérivante, ou si elle a été prise dans un chalutier et rejetée en mer. Son retour aux Etats Unis est d'ores et déjà organisé. "Ils souhaitent la récupérer, pour sa valeur peut être, mais surtout pour ce qu'elle contient."
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La sardine à la « grek »
Quand la sardine boudait les eaux bretonnes, les quartiers du Vieux Port rochelais se peuplaient de marins bretons. Des marins expérimentés et durs à la mer.
Source :
Sud Ouest par Philippe Baroux
C'est un monde à part. Mais un monde, à part entière. Il a conservé sa langue, ses coutumes, et ses habits traditionnels. Il n'est pas rare d'apercevoir de hautes coiffes de dentelle, sur le cours des Dames, parmi les marins qui réparent leurs filets de pêche. C'est de cette époque que le quartier Saint-Jean-du-Pérot tire son surnom de « quartier grek », avec un « k ». Les îliens de Groix, les Groizillons, le peuplent alors. Ces femmes sont réputées pour faire une grande consommation de café qu'elles préparaient dans une… « greg », une cafetière dans leur parler.
Cette empreinte bretonne se lit aussi, sur les façades des bistrots du quartier Saint-Sauveur. Au bon Breton, La Ville de Vannes, le Bar de Bretagne, pour n'évoquer que ces enseignes, où le matelot payé de sa marée risque souvent d'engloutir sa part au comptoir (1).
Une enclave bretonne
Aux abords du Vieux Port, La Rochelle est une enclave. Un condensé de Bretagne où les Rochelais de souche demeurent étrangers, répugnant à s'aventurer dans les quartiers où vit cette main-d'œuvre. Des marins qui ont fui la crise économique de leur région natale, pour entendre les propositions que formulent les armateurs à la pêche industrielle. Ils sont établis à La Rochelle qui devient, alors, le premier port du golfe de Gascogne, et le deuxième du littoral français, derrière Boulogne. Dans ces années 20, l'activité de ces chalutiers, en acier, propulsés à la vapeur, est florissante. Les armateurs recrutent leurs équipages parmi les Bretons. Ce marin « était dur à la mer, rien à voir avec les Rochelais… c'était marche où crève », raconte un collègue aunisien, dans la thèse qu'Henri Moulinier vient de consacrer à l'histoire de la pêche industrielle rochelaise, entre 1871 et 1994.
969 marins bretons en 1909
Quelques chiffres sont éclairants. En 1909, 746 des 969 marins, que l'on retrouve sur les ponts des 23 chalutiers industriels rochelais, sont nés au nord de La Loire.
Suite de l'article de Philippe Baroux dans
Sud Ouest
(1) D'après « Essor et déclin de la pêche industrielle à La Rochelle », thèse soutenue par le Rochelais Henri Moulinier, le 27 juin dernier, à l'université de La Rochelle.
Prochain volet : Les traumatismes du marin
Révolution. Le chalutage industriel, qui fait une percée majeure dans l'Angleterre du XIXè siècle, essaime navires et techniques à La Rochelle, à partir de 1904. Craggs, puis Dahl, Castaing et bien d'autres armateurs ont acheté des chalutiers à vapeur, et assis une économie forte. Dans le sillage de ces pionniers et jusque dans les années 60, La Rochelle sera ainsi l'un des tout premiers ports de pêche de France.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Thau : des thons dans l’étang, ce n’est pas si étonnant
Il ne s'attendait pas à une telle prise. Samedi dernier, au large de Bouzigues, un ostréiculteur a découvert, dans une de ses tables, non pas une huître géante, mais un thon. Un spécimen de 25 kg pris au piège des filets protégeant les coquillages des dorades. Des thons dans l'étang ? "Ce n'est pas un phénomène exceptionnel, expose Jean-Marie Ricard, le prud'homme de l'étang. Surtout en juillet et août, quand les eaux de l'étang sont plus chaudes. Il arrive que des thons rouges qui se trouvent au large, dans la fosse de Frontignan, traversent le port et arrivent dans l'étang. D'autres entrent par la passe de Marseillan."
Source :
Midi LibreDe trois à cinq pièces, dont l'une de 200 kg ?
Depuis le début de l'été, Jean-Marie Ricard n'en a pas aperçu lui-même de ses propres yeux. Mais, rapporte-t-il, "j'ai recueilli des témoignages formels attestant la présence d'au moins trois thons dans l'étang, dont l'un pèse assurément plus d'une centaine de kilos." Plusieurs professionnels font toutefois état d'un banc composé de cinq pièces, dont une mesurerait plus d'un mètre et une autre cinquante centimètres. Un retraité des Phares et Balises affirme, de son côté, avoir vu un thon d'environ 200 kg du côté de Marseillan, le 17 juillet dernier.
Pierre d'Acunto, lui, se dit "surpris" par ces "intrus" : "Je n'ai pas souvenir de présence de thons dans l'étang, y compris de mon père. Dans le port et les canaux, oui. Il arrive que des thons suivent des chalutiers jusqu'à la criée. Actuellement, les thons se rapprochent des côtes. Il y a de la biomasse de petites sardines et de petits anchois. Peut-être que ces thons ont suivi une chasse et se sont ainsi retrouvés dans l'étang où là, ils peuvent jouir d'une certaine tranquillité". Tout en se repaissant d'autres sardines et anchois, ou bien d'aiguilles, de muges... "Les eaux sont bien grasses, il y a de quoi manger", confirme Philippe Fassanaro, enseignant au lycée de la Mer. Tous les professionnels sont en tout cas du même avis : "Des thons dans l'étang, c'est sûrement bon signe pour l'espèce."
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
À la une du « marin » du 1er août 2014 : Guerre des mines, la menace fantôme
Le marin consacre son sujet d’ouverture aux mines navales et à la menace qu’elles représentent. Ces mines ne cessent de se perfectionner et de se déployer à la faveur d’un coût minime au regard des victimes qu’elles peuvent faire. Bénéficiant d’avancées technologiques remarquables, leur développement oblige le déminage, lui aussi, à s’améliorer.
Également dans ce numéro du marin :
Les bonnes captures du thon germon ;
Saint-Jean-de-Luz : Les résultats de la criée s'envolent ;
Méditerranée. Des scientifiques grecs veulent plus de contrôles ;
Parc éolien. Coup d'envoi des travaux au large de Fécamp ;
Cap Corse. La mission d'étude du parc marin est lancée ;
Mortalités ostréicoles. 4,5 millions d'aides débloqués ;
Nitrates. Forte augmentation des communes en zones vulnérables ;
Dragage. les nouvelles normes pour les PCB ;
Nouvelle-Calédonie. La Cour d'appel de Nouméa crée une "Zone grise"...
Cliquer
Ici pour lire le marin ou aller dans
lekiosk
70ème anniversaire du Débarquement : l'écobilan explosif de la guerre
Il y a 70 ans ans, jour pour jour, 6.939 navires accompagnés d'avions et près de 160.000 soldates alliés, Britanniques, Américains et Canadiens débarquaient sur les plages de Normandie pour libérer l'Europe et la France de l'occupation allemande et contribuer à la chute du nazisme. C'était le D-Day pour le Débarquement.
Source :
Sud Ouest par Cathy Lafon
Dans toutes les mémoires
Au soir du 6 juin, l'opération militaire, d'une envergure sans égale dans l'Histoire, avait déjà fait près de 40.500 pertes (tués, blessés disparus et prisonniers) chez les militaires alliés et allemands. Elle a également réussi grâce au courage de ces civils, hommes et femmes de tous âges qui, après avoir résisté durant la guerre, ont aidé les Alliés, au prix de leur vie, à libérer la Normandie, puis Paris et enfin la France. Une telle somme d'actes d'espoir, d'héroïsme et de solidarité prend tellement de sens aujourd'hui, à l'heure de la montée des eurosceptismes, des nationalismes, des replis sur soi et du conflit russo-ukrainien sur le sol européen, que Ma Planète ne pouvait ignorer l'hommage mondial rendu au courage des héros et héroïnes du D-Day, dans toutes les mémoires aujourd'hui.
Bon, alors, et l'écologie dans tout ça ?
Un million de tonnes d'armes chimiques sous la mer
On y pense rarement, mais les guerres ont aussi leurs écobilans. Plus les techniques militaires et les armes progressent et plus les guerres sont désastreuses, pour les souffrances infligées aux hommes et les dégâts environnementaux créés, qui se retournent aussi un jour ou l'autre contre les hommes. Au fond des océans, les pollutions chimiques des armements utilisés durant les deux conflits mondiaux du XXème siècles constituent ainsi de véritables bombes potentielles. Le documentaire "Armes chimiques sous la mer", réalisé par Bob Coen, Eric Nadler et Nicolas Koutsikas, l'a montré sur Arte, en février dernier. L'enquête sur ce sujet explosif, classé secret défense jusqu'en 2017, a révélé l'existence d'un million de tonnes d'armes chimiques dormant aujourd'hui sous les mers. Poubelles quotidiennes de nos déchets, les océans sont aussi la poubelle de l'Histoire et notamment celle des deux grands conflits mondiaux. En plusieurs vagues, de 1917 à 1970, pour se débarrasser des stocks d'armes explosifs et hautement toxiques, les armées des grandes puissances mondiales les ont déversés dans les océans. Ni vu, ni connu. Le pire étant que, selon les régions du monde, ces bombes et munitions explosives ne sont que très peu cartographiées, voire pas du tout.
"Pas d'armistice pour les déchets de guerre"
On peut compter sur l'association Robin des bois pour briser les omertas environnementales. L'ONG s'est ainsi attaquée à faire l'éco-inventaire détaillé des 15% des 600.000 tonnes de bombes larguées entre juin 1940 et mai 1945 qui n'ont pas explosé et sont généralement toujours enfouies. De 2008 à 2013, près de 14.000 munitions ont ainsi été récupérées. Mais pas en mer, ou soixante-deux dépôts sous-marins sont hors de tout contrôle... Dans l'Atlantique-Manche, cinq régions ont ainsi été passées au crible par l'ONG, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, avec leurs cartographies, pour dresser l'inventaire des déchets de guerre en Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine. Le résultat, explosif, est à consulter sur le site internet de Robin des bois, en cliquant ICI
La seconde guerre mondiale a tué, et, hélas, peut encore tuer.
Cliquer
Ici pour accéder au dossier de Robin des Bois : Inventaire des déchets de guerre - Régions Atlantique-Manche
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
À la une du « marin » du 25 juillet 2014 : Les pêcheurs pied au plancher sur l’obligation de débarquement
Le marin consacre son sujet d’ouverture à l’interdiction des rejets à la pêche. La nouvelle politique commune de la pêche (PCP) obligera, dans les années à venir, à débarquer toutes les captures, en commençant par les pêcheries pélagiques. Cette obligation remet à l’ordre du jour des dispositifs de sélectivité qui minorent les captures d’espèces non ciblées ou d’individus trop petits. De nouvelles idées émergent aussi.
Également dans ce numéro du marin : la filière nautique face à un sérieux coup de froid ; un entretien avec Alain Cadec, président de la commission de la pêche au Parlement européen ; le dernier voyage du Costa Concordia sous surveillance corse ; le bon bilan semestriel des ferries sur le fret dans le détroit ; le projet Ocean Fresh Water et ses 500 emplois de marins français à la clef ; Perrigault avale le terminal Porte océane ; l’État condamné pour la mort d’un cheval liée aux algues vertes ; les conchyliculteurs charentais manifestent leur colère ; et un dossier sur La Réunion.
Cliquer
Ici pour lire le marin ou aller dans le kiosk
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Europe : la malouine Isabelle Thomas désignée rapporteur du dossier pêche profonde
Information Ouest-France/Le marin, la députée européenne Isabelle Thomas, vient d’être désignée rapporteur de l'épineux dossier de la pêche en eaux profondes.
L'ancien rapporteur n'ayant pas été réélu, la députée européenne Isabelle Thomas a hérité du texte comprenant le compromis qu'elle avait contribué à construire. C'est donc elle qui représentera le Parlement européen lors du Trilogue (Commission européenne, ministres des pêches et Parlement).
« Je défendrai bien sûr le compromis adopté par le Parlement européen le 10 décembre dernier. Ce compromis a été très difficile à obtenir, comme à chaque fois que les points de vue sont très opposés. Mais nous sommes parvenus à un résultat équilibré qui prend en compte à la fois les impératifs écologiques et les impératifs économiques et sociaux », indique Isabelle Thomas. Une nomination qui risque de faire des vagues chez les opposants au chalut de grands fonds.
Plus d'informations sur Ouest-France entreprises et Le Marin, du 25 juillet 2014.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Qui veut la peau du chalut ?
Début juillet, 8 ONG signent une lettre ouverte demandant à la France de revoir ses positions sur le chalutage profond. Une attaque inacceptable pour Olivier Le Nézet, président du comité régional des pêches.
Dans cette lettre ouverte, signée notamment par WWF, Greenpeace ou encore Bloom, 8 ONG environnementales demandent à Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie d’intervenir pour l'interdiction du chalutage profond afin de « protéger la biodiversité marine des grandes profondeurs ». Un appel faisant suite aux données rendues publiques le 2 juillet par l'Ifremer, et réclamées par les ONG depuis 2009. D'après les ONG, ce document révéle que « le nombre de navires ayant une activité au chalutage de fond en eaux profondes est faible », et l'interdiction du chalutage au delà de 800 mètres ne concernerait qu'un seul navire français. « Aujourd’hui, Frédéric Cuvillier défend l’activité d’un seul bateau. Et encore, celui-ci ne pêche en profondeur qu’un tiers de son temps », commente Claire Nouvian, présidente de l'ONG Bloom. « Cette situation n'est plus tenable », termine François Chartier, de Greenpeace.
Une campagne difficile à accepter du côté des professionnels
« Tout d'abord, il faut souligner que ce ne sont que 8 ONG qui signent cette lettre ouverte », insiste Olivier Le Nézet, président du comité régional des pêches. « Beaucoup d'autres (Robin des Bois, Bluefish, ou encore France Nature Environnement) ne partagent pas leur point de vue. »
Selon lui, la lutte menée par ces 8 ONG sur la profondeur révèlent une volonté de grappiller petit à petit l'arrêt d'une technique de pêche. Commencer par interdire le chalutage de plus de 800 mètres serait une première victoire, pour ensuite lutter pour l'augmentation des interdictions. Une ligne de pensée partagée par Jacky Bonnemains, président de l'ONG Robin des Bois, lors de son intervention aux Assises de la pêche et des produits de la mer 2014 : « il ne faut pas faire de concession avec les ONG. Si aujourd'hui les pêcheurs plient à 800 mètres, demain ce sera 600, et ainsi de suite. »
Un but inavoué ?
Les pêcheurs veulent rencontrer Ségolène Royal
Suite et texte intégral sur :
pdm-seafoodmag^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dans le marin du 18 juillet 2014, « Energies marines : le poker venteur »
Nous avons dégradé le littoral. Allons-nous maintenant transformer la mer côtière en zone industrielle ?
Les éoliennes offshore font couler beaucoup d’encre, de promesses incertaines et de risques certains pour la biodiversité, les activités de pêche et la sécurité maritime.
La fuite en avant des faiseurs de miracles débouche sur le gigantisme.
A peine l’Haliade 150 d’Alstom est elle implantée à terre sur un site pilote en bord de Loire que des usines de production sont promises à Cherbourg et à Saint Nazaire, que des milliers d’emplois virtuels sont créés et que 288 monstres marins de 175 m de haut et 150 m de diamètre s’imposent en baie de Seine, en face de Fécamp et de Saint-Nazaire.
Aucune étude d’impact sérieuse et contradictoire n’est disponible sur les effets acoustiques du battage des pieux de fondation, sur l’effet barrière des implantations cumulées pour les mammifères marins, les oiseaux et les poissons. En exploitation, le bilan mortel pour les oiseaux trompés par les pollutions lumineuses et décapités par les pales est écarté. On verra plus tard.
En exploitation, les risques pour la sécurité maritime restent cachés et la cohabitation entre les mégas porte-conteneurs et les mégas usines à vent n’est pas étudiée.
La résistance des pales face au givre, à la foudre, aux dépôts salins et à la fatigue des matériaux composites n’est pas connue.
Les projets d’usines hydroliennes sont encore plus fumeux et bluffeurs. On cherche désespérément sur l’océan mondial un groupuscule d’hydroliennes ayant sur plusieurs années prouvé sa robustesse et sa rentabilité mais déjà grâce au génie français et aux mécanismes d’aides de l’Etat il est planifié d’en installer par centaines en Bretagne et dans le Cotentin. Une nouvelle expulsion des pêcheurs travailleurs de la mer et nourrisseurs de la terre est en vue.
Robin des Bois considère qu’il est illusoire et dangereux pour l’environnement, pour la sécurité maritime, la sécurité des pêcheurs et pour l’intérêt général d’enclencher immédiatement des installations industrielles offshore sans passer par le stade de la validation expérimentale, de la maturation et de l’inter-comparaison entre les diverses techniques en gestation.
Le saut technologique de l’énergie offshore est un saut dans l’inconnu. Ces programmes ronflants ressemblent dans leur schéma de propagation foudroyante et de manipulation de l’opinion publique à celui des surgénérateurs nucléaires : Courseulles / Fécamp / Saint Nazaire / Superphénix / mêmes acteurs, mêmes procédés.
Au bout du compte, ce sera à l’Etat de démanteler les installations périmées et aux régions de se débrouiller avec des milliers de tonnes de matériaux non recyclables.
Les autres sujets du marin :
* Premier échange de vues sur les Tacs et quotas 2015 ;
* les CCI gestionnaires des ports attaquées par l’État ;
* la flottille étaploise encore réduite ;
* les pêcheurs veulent être reçus par Ségolène Royal pour parler des espèces de grands fonds ;
* l’interview d’Odette Herviaux, sénatrice du Morbihan, suite à la remise de son rapport sur la gestion des ports ;
* les conchyliculteurs et pêcheurs très inquiets face aux mortalités dans l’étang de Thau ;
* l’accord UE-Maroc officiellement ratifié ;
* Sénégal : Un nouveau gouvernement sans Haïdar El Ali ;
* Conserves. Une charte de bonnes pratiques mise en place par les fabricants
* et un dossier consacré à la Guadeloupe : Les pêcheurs font le dos rond / L’anarchie des DCP devra cesser / 3 projets aquacoles malgré la crise /...
Cliquer Ici pour lire le marin ou aller dans le kiosk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 18 Juillet 2014
Une proposition de loi des écologistes pour interdire la pêche au chalut en eaux profondes
![]()
Le groupe écologiste à l’Assemblée nationale, emmené par Laurence Abeille, a déposé aujourd’hui une proposition de loi pour interdire la pêche au chalut en eaux profondes.
Source :
Groupe écologiste à l'assemblée nationale
Les écologistes se sont toujours opposés à cette méthode de pêche particulièrement néfaste aux écosystèmes marins. Ils le sont encore plus après la publication par plusieurs ONG, la semaine dernière, d’une analyse des données rendues publiques de l’IFREMER.
Cette analyse prouve ce que les écologistes dénoncent depuis longtemps : le chalutage en eaux profondes est un secteur très faible sur le plan économique -une douzaine de chalutiers en France - mais qui a un impact très fort sur la biodiversité marine et sur la survie d’espèces menacées d’extinction.
La France avait jusqu’au 15 juillet pour confirmer auprès de la Commission européenne sa position sur le règlement relatif à la pêche profonde. La ministre Ségolène Royal a transmis à la commission les données de l’IFREMER en demandant « d’accélérer l’expertise pour prendre une décision », tout en reconnaissant que le chalutage profond pose « de graves problèmes environnementaux ». Les écologistes saluent la volonté de la Ministre de se pencher sérieusement sur ce problème, et ils rappellent par cette proposition de loi que la seule décision de bon sens est d’interdire cette méthode de pêche.
LE TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI
Madame, Monsieur,
La pêche en eaux profondes fait l’objet de débats intenses depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale ont organisé conjointement, le 26 novembre 2013, une table-ronde sur ce sujet qui a permis de confronter les différentes approches sur cette problématique.Illustration :Les partenariats Gagnant-Gagnant de PEW
Un impact important sur la biodiversité
La pêche en eaux profondes se déroule entre 400 et 1 800 mètres de profondeur. La pêche dans ce type de milieu nécessite une gestion particulière, puisqu’elle impacte des écosystèmes très fragiles. Les eaux profondes abritent en effet des espèces dont les caractéristiques biologiques les rendent particulièrement vulnérables à la surpêche : croissance lente – certains poissons peuvent vivre 100 ans, reproduction très fragile avec une maturité sexuelle tardive et un faible taux de fécondité. Ces eaux abritent également de très nombreuses espèces de coraux très vulnérables.
Plusieurs dizaines de publications scientifiques internationales démontrent les impacts de la pêche en eaux profondes, notamment du chalutage, sur la biodiversité. Ces publications alertent notamment sur la faible résilience des stocks de poissons d’eau profonde. Surtout, l’absence de cartographie fine des zones sous-marines oblige les pêcheurs à travailler sans références. Ainsi les stocks pour de nombreuses espèces n’ont jamais été évalués.
Le 2 juillet dernier, l’IFREMER a rendu publiques les données qu’elle possède sur l’impact de la pêche en eaux profondes sur la biodiversité. Ces données objectives et officielles, analysées par plusieurs ONG de défense de l’environnement[1], montrent que les prises accessoires sont massives et concernent des espèces menacées d’extinction. Dans la zone de pêche de l’Atlantique Nord-Est, les chalutiers européens capturent entre 20 et 50 % de prises accessoires, composé d’une centaine d’espèces non ciblées. Par exemple, en 2012, les requins évoluant en eaux profondes ont ainsi représenté 6% des captures totales des chalutiers français pêchant en eaux profondes et plus de 30% des rejets totaux ; 232 770 kilos de requins évoluant en eaux profondes, interdits de capture et de débarquement et pour la plupart menacés d’extinction, ont ainsi été rejeté morts dans l’océan puisque considérés comme prises accessoires.
![https://twitter.com/Bloom_FR/status/489687482620203008/photo/1]() Les ONG donnent l’exemple du squale chagrin de l’Atlantique, espèce en danger d’extinction dans l’Atlantique Nord-Est, qui figure parmi les 10 espèces les plus capturées par les chalutiers en volume et qui est la troisième espèce la plus rejetées parmi les prises accessoires des chalutiers.
Les ONG donnent l’exemple du squale chagrin de l’Atlantique, espèce en danger d’extinction dans l’Atlantique Nord-Est, qui figure parmi les 10 espèces les plus capturées par les chalutiers en volume et qui est la troisième espèce la plus rejetées parmi les prises accessoires des chalutiers.
Une activité économique mineure
En France, 37 permis ont été attribués pour pratiquer ce type de pêche. Les captures d’espèces profondes représentent environ 1,5 % de l’ensemble des captures de pêche de l’Union européenne.
Le New Economics Foundation (NEF), institut de recherche britannique, a publié en 2013 une étude sur la rentabilité de ce type de pêche. En tenant compte des émissions de gaz à effet de serre, plus importantes pour ce type de pêche, du coût des prises accessoires et des subventions, notamment européennes, l’étude conclut à la non-rentabilité économique du chalutage en eaux profondes. La somme des coûts environnementaux et énergétiques du chalutage profond se situe entre 389 à 494 euros par tonne de poisson pêché.
Les données rendues publiques par l’IFREMER le 2 juillet dernier montrent que « le nombre de navires ayant une activité au chalutage de fond en eaux profondes est faible ». En 2012, seuls 12 chalutiers français pêchaient plus de 10% de leur temps par plus de 600 mètres de fond et seulement 10 pêchaient par plus de 800 mètres de profondeur plus de 10% de leur temps.
Aucun navire n’avait passé plus de 60% de son temps de pêche au-delà de 800 mètres de profondeur.
L’activité économique est donc très limitée, et bien loin des 400 navires évoqués par le Comité national des pêches maritimes en novembre 2013.
Ainsi, le chalutage en eaux profondes étant un secteur très faible sur le plan économique et ayant un impact très fort sur la biodiversité et sur la survie d’espèces menacées d’extinction, cette proposition de loi vise à l’interdire.
Article unique
L’article L. 945-4 du Code rural et de la pêche maritime est complété par un 23° ainsi rédigé :
« 23° De pratiquer le chalutage en eaux profondes. Un décret en Conseil d’état définira les conditions d'application du présent alinéa.»
[1] Bloom, Deepsea conservation coalition, Fondation Goodplanet, Greenpeace, Les amis de la Terre, Oceana, WWF
Bretagne. La pêche veut rencontrer la ministre Ségolène Royal
Coup de colère, mercredi, du président du Comité des pêches de Bretagne face au « harcèlement » contre le chalut de grand fond.
Olivier Le Nézet monte une nouvelle fois au créneau contre les ONG (organisations non gouvernementales). Après avoir bataillé pour défendre le chalutage de grands fonds, pratique qui a obtenu un sursis de la Commission et du Parlement européens, « et l'engagement du Président de la République au salon de l'Agriculture de 2014 », le président du comité des pêches breton « en a marre des attaques répétitives des écologistes ».
Campagne des ONG
Depuis une dizaine de jours, plusieurs ONG, dont Bloom, Greenpeace et WWF, ont en effet relancé leur campagne contre le chalut de grand fond (+ 800 m) et adressé une lettre ouverte à la ministre de l'Écologie. « C'est reparti avec des arguments qui ne tiennent pas. Ce que visent certaines ONG, c'est la fin de tout chalut de fond, quelle que soit la profondeur. » Et, pour un pêcheur breton, « pas question de laisser faire et dire n'importe quoi ». Olivier Le Nézet souhaite donc que la pêche française soit reçue, « avant la fin de l'été », par la ministre de l'Écologie.
« Nous voulons lui parler d'une activité qui a fait de gros efforts en matière d'environnement, mais aussi en matière économique et sociale. » Et de mettre en avant, « la bonne volonté montrée par les pêcheurs pour ne pas freiner le développement des énergies marines renouvelables ». Autre souci pour le pêcheur : la suppression des détaxes accordées à la pêche sur le gasoil. La Commissaire européenne à la Pêche, Maria Damanaki, en a évoqué l'idée récemment, avec l'appui de la Commission océan mondial, soutenue par la fondation écologiste américaine Pew. Principaux navires visés par ce projet : les chalutiers, dont les coûts d'exploitation exploseraient.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 17 Juillet 2014
Les sauveteurs de la SNSM veillent sur vous cet été
France 3 AquitaineLes côtes ont leurs anges gardiens
L’année dernière, la SNSM a secouru près de 6 000 personnes...
Les bénévoles de la SNSM réalisent des exercices de sauvetage avec la Marine nationale. Un travail de précision pour être prêt à secourir au large des côtes oléronnaises..
Source :
Sud Ouest par Elia Dahan
Il est 10 heures, sur le port de la Cotinière. Quelques passants flânent, d'autres prennent un café en terrasse. À bord du bateau de la SNSM (Société nationale de sauveteurs en mer), les marins s'affairent. Jean-Jacques, Michel et les deux Dominique s'apprêtent à quitter le port.
Au programme ce matin : un exercice d'hélitreuillage avec les hommes de la Marine nationale, basés à La Rochelle. « Nous faisons ces exercices une fois par mois, explique Michel. C'est rare qu'on les fasse de jour, les trois quarts du temps c'est de nuit. » Ex-marin pêcheur, le sexagénaire est bénévole à la SNSM depuis 2001. À bord, il est le plus ancien. « Comme on a navigué toute notre vie, on aime bien ce que l'on fait, annonce-t-il. C'est une bonne action et je trouve cela important de pouvoir rendre service en aidant les gens. » Une philosophie partagée avec ses trois acolytes. L'équipage de la journée est composé de marins pêcheurs à la retraite et d'un ancien mécanicien de bateaux, Dominique. « 95 % des sauveteurs ici sont d'anciens marins », sourit Michel....
(...)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 16 Juillet 2014
« Je souhaite m’assurer que les générations futures auront du poisson dans leur assiette »
Entretien exclusif.
Maria Damanaki, Commissaire européen aux Affaires maritimes et à la Pêche, confirme son souhait de rester à la Commission pour un second mandat de cinq ans. Elle se montre toujours aussi ferme sur les filets dérivants et la fin du chalutage en eau profonde.
Quel bilan dressez-vous de ces cinq années ?
Nous avons une nouvelle politique commune de la pêche (fin des rejets en mer et de la surpêche entre 2015 et 2020). Avec des stocks en bonne santé, les pêcheurs européens pourront capturer par an plus de 2 millions de tonnes de plus de poissons. Lorsque je suis arrivée à la Commission, en 2009, 5 stocks de poissons étaient pêchés à des niveaux durables en Atlantique. Nous en avons maintenant 27, et peut-être 30 l’an prochain.
Souhaitez-vous rester au sein de la Commission ?
Oui, je souhaite exercer un second mandat de commissaire (à la pêche ou ailleurs), mais c’est au gouvernement grec d’en décider. Il n’a pas encore désigné son futur commissaire.
En France, les professionnels vous reprochent d’être proches de certaines ONG. Que répondez-vous ?
Mon rôle est de trouver un équilibre entre les différents intérêts. Je souhaite m’assurer que les générations futures auront du poisson dans leur assiette. Je n’ai pas un intérêt particulier à interdire telle pêcherie ou tel engin. Un exemple : entre 2005 et 2009, la pêche à l’anchois a été fermée dans le golfe de Gascogne car il n’y avait plus de poisson. La ressource est revenue et nous proposons pour 2014/2015 une hausse de 18% des quotas ! Mais je comprends les difficultés que connaissent nos pêcheurs. C’est pourquoi nous voulons les aider.
Les Etats membres auront-ils suffisamment de fonds européens pour moderniser les bateaux de pêche ?
L’interdiction des rejets pose des problèmes aux pêcheurs. Comment les aider à s’adapter ?
Des quotas plus élevés ?
Vous avez proposé en avril d'interdire en 2015 les filets maillants dérivants. Accepteriez-vous une dérogation pour la petite pêche ?
L’interdiction des chaluts en eau profonde est toujours sur la table. Comment voyez-vous l’évolution du dossier ?
La France demande une mise sous quota du bar ? Des données scientifiques montrent que le stock ne va pas bien. Que préconisez-vous ?
Allez-vous proposer de modifier le plan anguille, depuis le retour des civelles dans les estuaires en France ?
L’Espagne a été sanctionnée pour avoir dépassé son quota de maquereaux. La Commission enquête-t-elle sur d’autres cas similaires ?Toutes les réponses de Maria Damanaki aux questions de Lionel Changeur dans
: Ouest France Remarque : Une question que Lionel Changeur aurait pu poser à Maria Damanaki qui a dit un jour que la pêche illégale était un crime...
Pourquoi la Commission européenne s'attaque-t-elle à une multitude de petits pays : Belize, Fidji, Togo, Panama, Vanuatu, Sri Lanka, Cambodge, Guinée, Philippines, Papouasie,... Et laisse agir en toute impunité tous ces gros trafiquants internationaux qui "déversent" des produits défiant toute concurrence sur le premier marché des produits de la mer dans le monde qu'est l'UE (des importations qui tirent vers le bas le prix des poissons issus des pêcheries françaises et européennes) ?..Une analyse de l'expert Francisco Blaha :
Is the EU IUU Regulation working?
A partir de cette étude de Gilles Hosch and Shelley Clarke (2013) sur le trafic de Saumon et de Colin d’Alaska entre la Russie et la Chine avant exportation sur le marché européen : “Traceability, legal provenance & the EU IUU Regulation” et de l'étude du Parlement européen (2013) :
Compliance of imports of fishery and aquaculture products with EU legislation Le marché du Colin d'Alaska serait tellement "pourri" que dans son dossier "Pêches françaises 2014", Le Marin passe sous silence cette espèce du Pacifique Nord, alors que le Colin d'Alaska (ou Lieu d'Alaska) fait partie du Top 5 des espèces les plus consommées en France. C'est le poisson phare de l'industrie halio-alimentaire, espèce consommée essentiellement sous forme de panés, plats cuisinés, surimi et autres préparations...
Sinon, cliquer
Ici pour accéder au dossier du Marin "Pêches Françaises 2014"
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 15 Juillet 2014
Lorient. Les cartes marines, travail de fond du Lapérouse
Le bâtiment hydrographique a fait escale pour le 14 Juillet, à Kergroise. Il a ouvert son bord à un public particulièrement heureux et curieux.
Source :
Ouest France par Gildas Jaffré.
Sagement amarré au quai des paquebots, à Kergroise, le bâtiment hydrographique et océanographique de la Marine nationale, le Lapérouse a fait escale tout le week-end, ouvrant son bord aux visites du public. Celui-ci n'a pas boudé l'invitation, et les curieux n'ont pas manqué de multiplier les questions sur les missions d'un tel navire.
« J'ai travaillé pour des questions économiques de défense sur deux territoires, à Brest et Lorient », explique Guillaume, 29, ans, jeune Lorientais très motivé, dans la file d'attente, au pied de la passerelle. « Je suis sensible à ces questions et je trouve que c'est une bonne initiative de présenter de tels navires. La Marine, il faut la mettre en avant, surtout à Brest, Lorient, Toulon. Les sites historiques de la Marine et aussi les navires du Shom (Service hydrographique et océanographique de la Marine, n.d.l.r) qui ne sont pas souvent mis en évidence, mais qui font des travaux importants pour la recherche et qui sont utiles à tout le monde. »
Des sonars à la place du fil à plomb...
Du matériel scientifique de pointe...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dans le marin du 11 juillet 2014, Alain Cadec préside la commission de la pêche du Parlement européen
C’était prévu, c’est fait : la présidence de la commission de la pêche du Parlement européen a bien été attribuée à Alain Cadec, lors du vote intervenu le lundi 7 juillet.
Le député originaire de Saint-Brieuc, élu sur la liste UMP dans la circonscription grand ouest, est membre du Parti populaire européen (PPE), à qui la présidence de cette commission était promise, depuis les négociations intergroupes de la semaine précédente.
Le bureau de la commission compte 4 vice-présidents : Isabella Lovin (Verte suédoise) Jaroslaw Walesa (démocrate chrétien polonais) Werner Kuhn (démocrate chrétien allemand) et Renata Briano (groupe socialiste, Parti démocrate italien). La première réunion de la nouvelle commission se tiendra le mardi 22 juillet.
![]()
Âgé de 61 ans, Alain Cadec était vice-président de la même commission lors du mandat précédent, de 2009 à 2014. Dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche, il a été rapporteur du règlement sur le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche (Feamp), son bras financier.
Qui est qui : les présidents des commissions parlementairesLundi 7 juillet, les commissions du Parlement européen se sont réunies à Bruxelles pour élire leurs présidents et vice-présidents pour deux ans et demi. Découvrez qui est qui dans notre infographie.
Les 20 commissions et les deux sous-commissions du Parlement européen sont chargées du travail législatif. Chacune a un président et jusqu’à quatre vice-présidents. Source : Europarlement
Dans un communiqué, Alain Cadec estime que son élection (à l'unanimité), la seule présidence pour un membre de l’UMP, est « un signal fort pour l'influence française en Europe ». Elle lui permet en effet de siéger à la conférence des présidents, organe décisionnel fondamental du Parlement. « C'est primordial pour l'influence française en Europe. »...
Les autres sujets du marin :
-Fronde sur la réforme des quotas de pêche ;
-Droits à produire. La petite pêche soutient la Fedopa ;
-Granville. Première criée à étiqueter Pavillon France ;
-Bretagne. Les pêcheurs noyés de réunions ;
-Feamp. Les élus de Méditerranée demandent des mesures fortes ;
-Aides gas-oil. Des Méditerranéens se retournent contre l'Etat ;
-Anchois du golfe de Gascogne. une hausse de 18% proposée ;
-Pays bigouden. La coopérative, précieux soutien pour les pêcheurs ;
-Selpal. Un programme de sélection pour les palangres de Méditerranée ;
-Six armateurs au thon rouge condamnés à Montpellier ;
-Thon. Un nouvel accord en vue avec Madagascar pour 2015 à 2018 ;
-Cherbourg. Cinq palangriers embarqués pour le Mozambique ;
-Carburant. Maria Damanaki prône la fin des détaxes ;
-Grands fonds. Nouvelles attaques des ONG environnementales ;
-Projet Nemo d’énergie thermique des mers aidé par l’Europe ;
-Ailes marines confirme les fondations de type jacket dans la baie de Saint-Brieuc ;
-Sécurité. Un airbag pour éviter les naufrages ;
-Bugaled Breizh. "Contre l'oubli et pour la poursuite du combat" ;
-Tribune d'Isabelle Thomas : "Politique commune de la pêche : le rôle du député européen"
-et un dossier consacré à la Martinique.
Cliquer
Ici pour lire le marin ou aller dans le
Kiosk (en ligne)
--------------------------------
Parlement européen : la France est marginalisée
Les Français n’obtiennent quasiment aucun poste clé à Strasbourg. Un prix à payer pour le vote en faveur du Front National, mais aussi pour trop d’amateurisme. Le fossé entre Bruxelles et Paris s’élargit.
Source :
Les Echos par Anne Bauer / Correspondante à Bruxelles | Le 08/07 à 19:24
Les euro-députés français sont au placard. Dans le nouveau Parlement européen, on cherche à la loupe les postes « qui comptent » attribués à la France.
Que trouve-t-on ? Deux présidences de commissions, une vice-présidente (*) et un questeur au bureau du Parlement, le lieu stratégique où s’organisent la vie, les finances et l’agenda de l’institution européenne. C’est peu au moment où les députés ont la charge de co-décider de très nombreuses politiques européennes. A droite, le député UMP Alain Cadec prend la tête de la Commission de la pêche, et Elizabeth Morin-Chartier monte au bureau du Parlement. Au centre, Jean Arthuis remplace son ami Alain Lamassoure à la présidence de la Commission des Budgets et Sylvie Goulard devient coordinateur au sein de la Commission des affaires économiques. Enfin chez les Socialistes et les Verts, il n’y a aucun poste saillant, sinon une vice-présidence de bureau attribuée à Sylvie Guillaume (PS). « On a le succès qu’on mérite », commente un observateur, en rappelant que la France a envoyé 24 députés Front national à Bruxelles. Comme ils n’ont pas réussi à former un groupe politique, ils n’ont pas pu participer à la répartition des postes de responsabilité qui sont accordés à Bruxelles proportionnellement aux nombres d’élus par groupe.
Néanmoins, jamais la France, pays fondateur de l’Union, n’avait à ce point perdu du terrain. Dans la précédente législature, Joseph Daul (président du groupe PPE) et Daniel Cohn-Bendit (co-président des Verts) étaient des figures clés de la vie politique du Parlement . Aujourd’hui, aucun Français ne préside un groupe politique. La dispersion des votes a joué contre les Français : l’UMP n’est que le 3ème groupe constitutif du PPE (centre droit) derrière les Allemands et les Polonais, les Socialistes français ne sont que les sixièmes, les Verts ont perdu les deux tiers de leurs forces. S’ajoute l’inexpérience des nouveaux élus mais aussi la désinvolture de certains (des candidatures ont été barrées pour manque de sérieux...).
La France a donc désormais moins de responsabilités que la Pologne, l’Espagne, l’Italie, et même la Grande-Bretagne, qui est une vraie « force critique ». Ainsi plusieurs députés britanniques président des commissions importantes, comme celle du marché intérieur remportée par une Tory, Vicky Ford
(*) En réalité, il y a 8 vice-présidents français :
Élection des présidents et vice-présidents des commissions parlementaires
Pour en savoir plus :
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le 5 Juillet 2014
Le secrétaire d'Etat à la Mer et à la Pêche, Frédéric Cuvillier, a annoncé à Lorient la nomination à venir d'un responsable chargé de simplifier les procédures administratives auxquelles sont soumis les pêcheurs.
L'interview de Frédéric Cuvillier, Secrétaire d'Etat à la Mer et à la Pêche
"Je vais nommer un responsable d'Etat pour la simplification dans le domaine de la pêche et du maritime" Le secrétaire d'Etat s'exprimait au terme d'une table ronde avec des professionnels du secteur, organisée à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau simulateur de navigation au Centre européen de formation continue maritime (CEFCM).
Olivier Le Nezet a également fait état des difficultés de la profession en matière de renouvellement de la flotte de pêche française, alors que la ressource se porte de mieux en mieux. Il a notamment réclamé la mise en place d'un schéma national de développement de la filière, alors que la France bénéficiera d'ici à 2020 de 588 millions d'euros d'aides allouées par la Commission européenne pour la mise en oeuvre de la nouvelle politique commune des pêches.
Un processus d’innovation permanent s’inscrivant dans le respect du savoir-faire traditionnel des conserveries françaises, que les fabricants s’attachent à défendre et à perpétuer. Tout en assurant la compétitivité de leurs entreprises, qui contribue au développement de l’économie littorale nationale, à travers 10 000 emplois directs et indirects.


















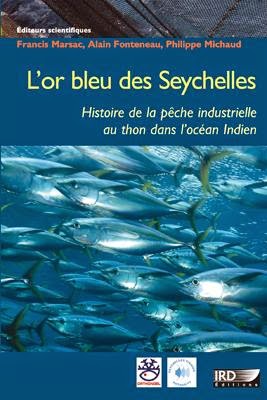


 Seychelles : Exportation des cartons de conserve de thon par pays pour les années 2006 et 2007
Seychelles : Exportation des cartons de conserve de thon par pays pour les années 2006 et 2007


















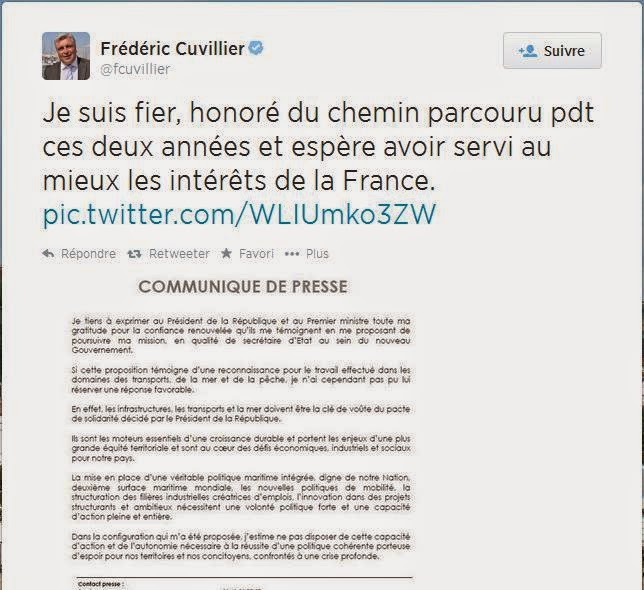








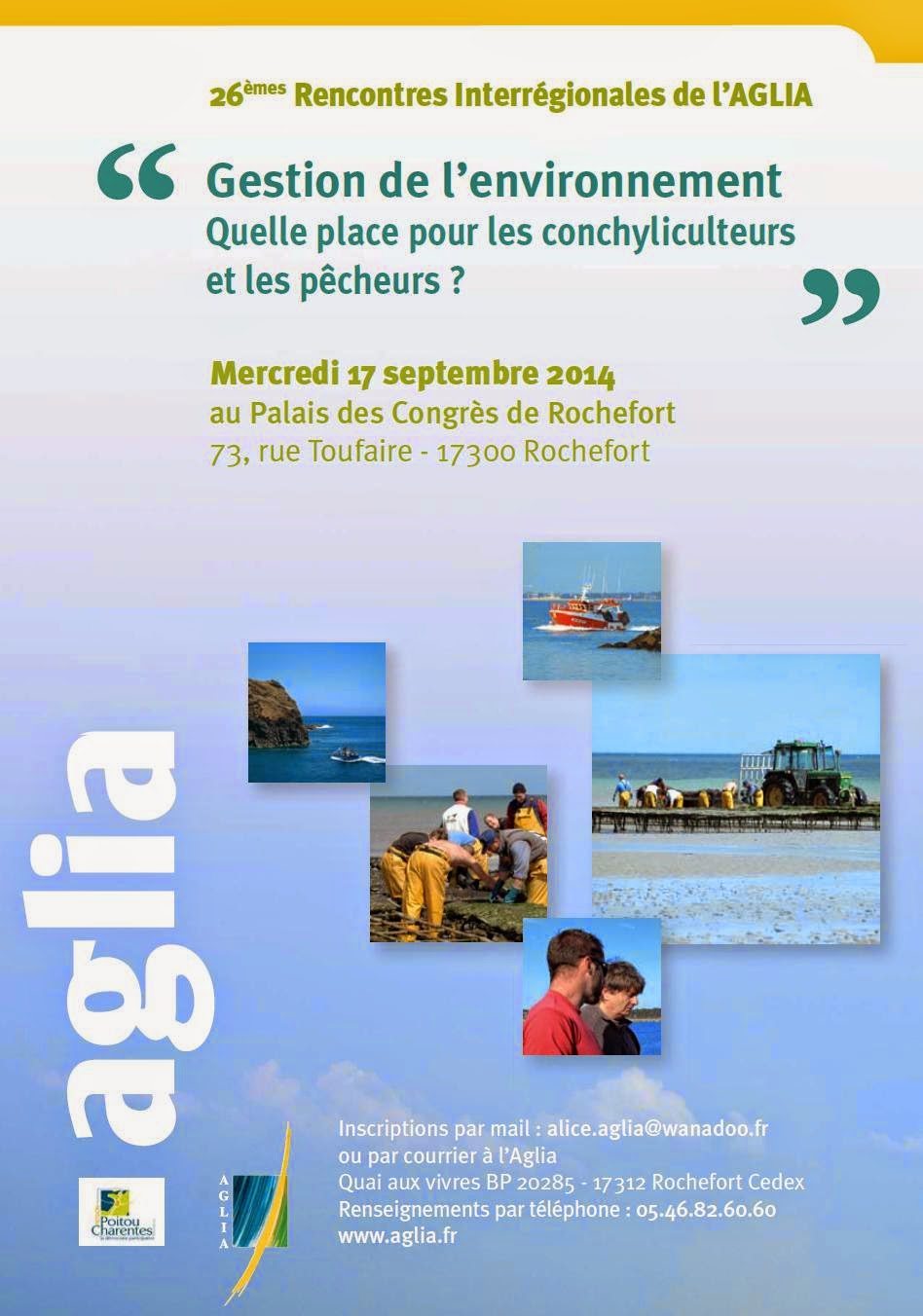




























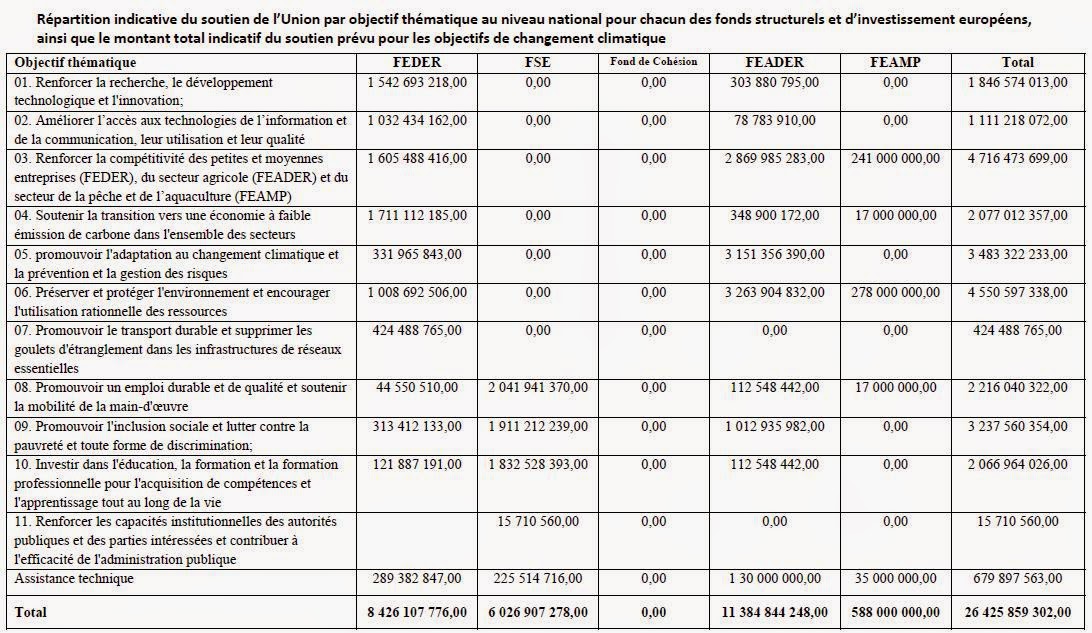







![http://www.sudouest.fr/2014/08/05/la-rochelle-ostreiculteurs-et-conchyliculteurs-crient-leur-colere-aux-pouvoirs-publics-1634039-4628.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20140806-[zone_info]](http://3.bp.blogspot.com/-EKUsKdOoCSo/U-IQAavdcaI/AAAAAAAAjDs/4osBS45apzU/s1600/Huitre+La+Rochelle+Manifestation+Pr%C3%A9fecture+charente-maritime+5+aout+2014+Sud+Ouest+Philippe+Baroux.jpg)
![http://www.sudouest.fr/2014/08/05/la-rochelle-ostreiculteurs-et-conchyliculteurs-crient-leur-colere-aux-pouvoirs-publics-1634039-4628.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20140806-[zone_info]](http://4.bp.blogspot.com/-Jy2e8amr2Kk/U-IQzLQiCrI/AAAAAAAAjD0/zyyDDLO-lWw/s1600/Huitre+La+Rochelle+Manifestation+Pr%C3%A9fecture+charente-maritime+5+aout+2014+G%C3%A9rald+Viaud+Sud+Ouest+Philippe+Baroux.jpg)




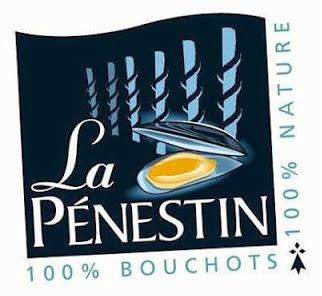
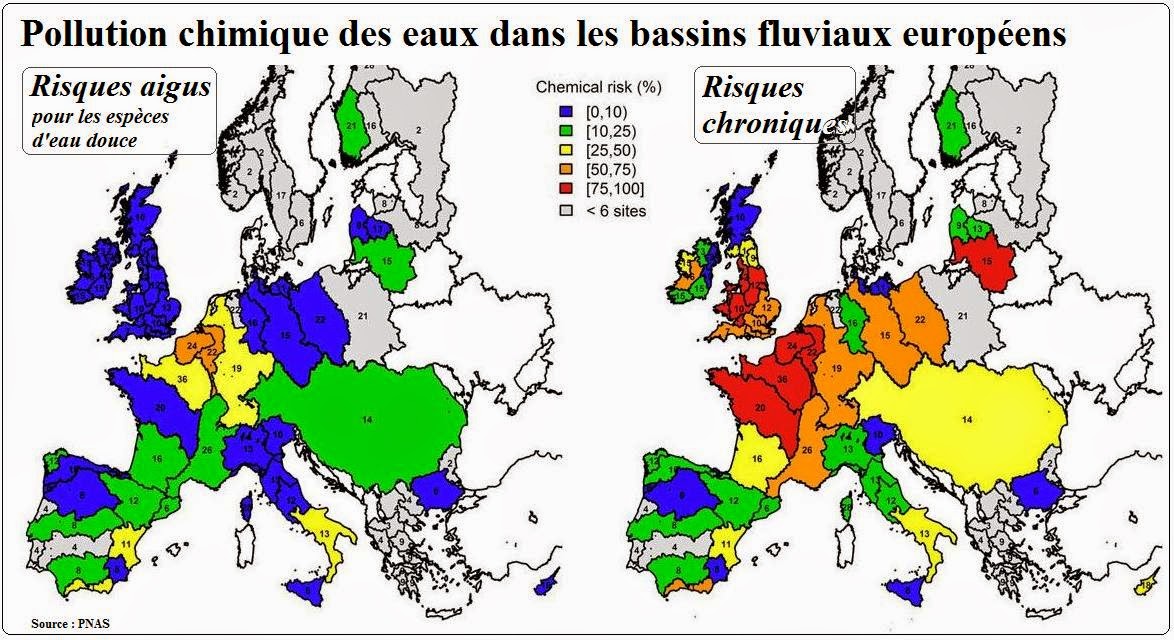






























































































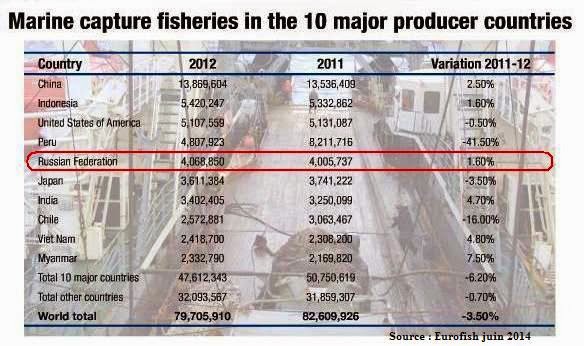

























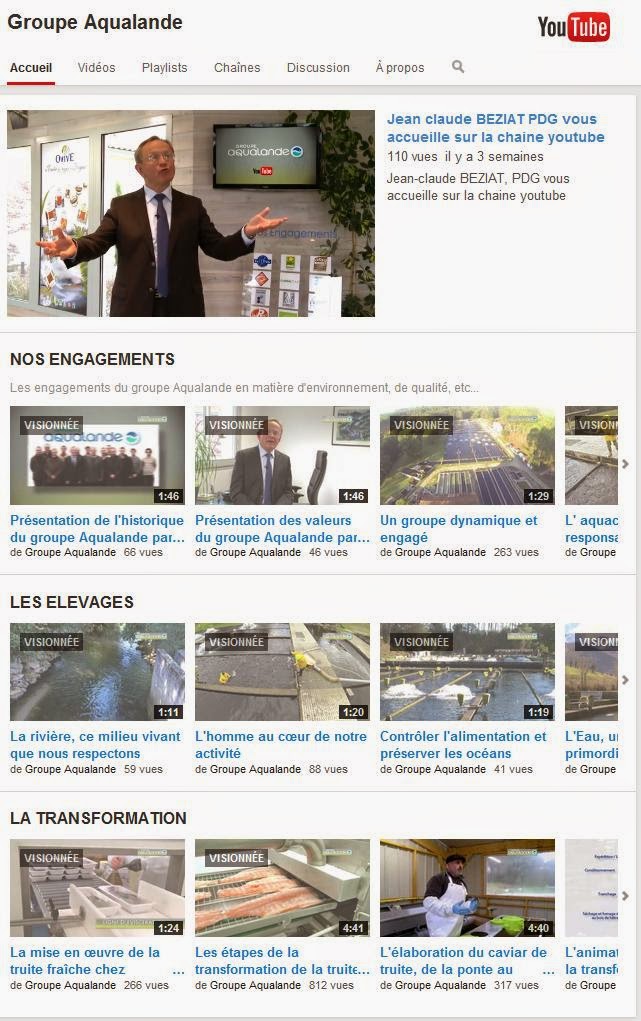
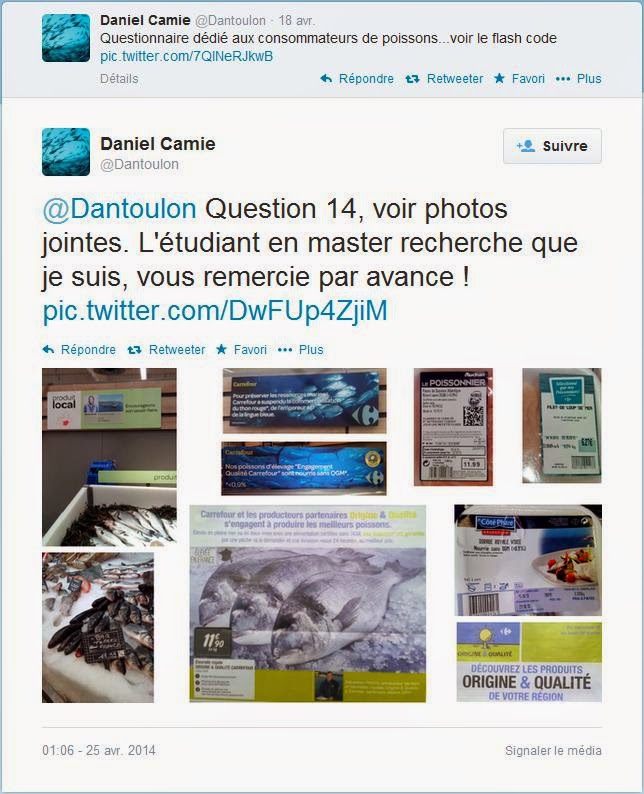
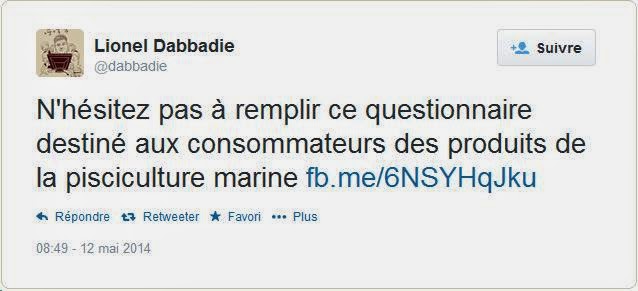













%2Bdefimedia.jpg)